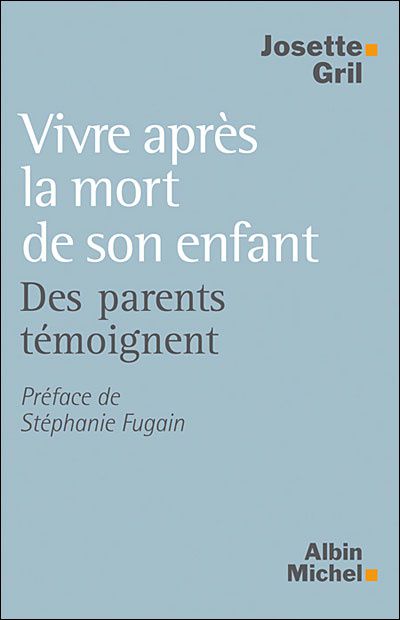Ce texte est un extrait du quatrième chapitre de Mécréance et discrédit de B.Stiegler, t.2, éd. Galillée, publié comme document de travail pour la préparation de la réunion d'Ars Industrialis Souffrance et consommationi.
L’INDIVIDU DÉSAFFECTÉ DANS LE PROCESSUS DE DÉSINDIVIDUATION PSYCHIQUE ET COLLECTIVE

"On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans. Rimbaud
Qui veut noyer son chien prétend qu’il a la rage."
24. L’hypermarché
L’économie politique de la valeur espriti est celle de l’économie libidinale – où la valeur, en général, ne vaut que pour qui peut désirer : elle ne vaut que pour autant qu’elle est inscrite dans le circuit du désir, qui ne désire que ce qui demeure irréductible à la commensurabilité de toutes les valeurs. Autrement dit, la valeur ne vaut que pour autant qu’elle évalue ce qui n’a pas de prix. Elle ne peut donc pas être intégralement calculée : elle comporte toujours un reste, qui induit le mouvement d’une différance (terme de J.Derrida), dans laquelle seulement peut se produire la circulation des valeurs, c’est à dire leur échange : la valeur ne vaut que dans la mesure où elle est inscrite dans le circuit d’individuations et de transindividuations qui ne peuvent individuer que des singularités.
-L'humain réduit au mode de vie "hyper"... Un paradigme de la pensée unique-
Or, dans l’économie politique hyperindustrielle, la valeur doit être intégralement calculable , c’est à dire qu’elle est condamnée à devenir sans valeur : tel est le nihilisme. Le problème est que c’est alors le consommateur qui non seulement se dévalue (car il est évalué, par exemple par le calcul de sa life time value) mais également qui se dévalorise – ou, plus précisément, qui se désindividue. Dans une telle société, qui liquide le désir, lequel est pourtant son énergie en tant qu’énergie libidinale, la valeur est ce qui s’anéantit et qui anéantit avec elle ceux qui l’évaluant s’évaluent. C’est pourquoi c’est la société en tant que telle qui apparaît finalement à ses membres, eux-mêmes dévalorisés (et mélancoliques), comme étant sans valeur – et c’est aussi pourquoi la société fantasme d’autant plus bruyamment et ostentatoirement des " valeurs " qui ne sont que leurres, discours de compensations et lots de consolation. Tel est le lot d’une société qui ne s’aime plus.
La scène de cette dévaluation dévalorisante n’est pas simplement le marché : c’est l’hypermarché, caractéristique de l’époque hyperindustrielle, où les marchandises gérées just in time par le code-barre et les acheteurs dotés de cartes de crédit à débit différé deviennent commensurables. Telle est la Zone d’activité commerciale des hypermarchés de Saint Maximin, non loin de Creil, construite par la société Eiffage – qui vient d’acheter une des sociétés d’autoroutes récemment privatisée par le gouvernement français – , une ZAC où Patricia et Emmanuel Cartier allaient passer les samedis après-midi avec leurs enfants. Jusqu’au jour où ils finirent par décider de tuer ces enfants, pour les conduire, expliqua leur père, vers une " vie meilleure " - une vie après la mort, une vie après cette vie qui n’était plus faite que de désespoir, si désespérante qu’elle poussa ces parents à injecter à leurs enfants des doses mortelles d’insuline.
" On devait tous mourir. " Ils avaient l’intention de mettre … fin à leurs jours pour " partir vers un monde meilleur ". " On a longtemps gardé l’espoir ". [Florence Aubenas, Libération, 17 octobre 2005] C’étaient de grands consommateurs. L’avocate de la partie civile, l’aide sociale à l’enfance, Me Pelouse Laburthe, reprochait pèle mêle à Patricia et Emmanuel Cartier de trop fumer, de laisser boire trop de Coca aux enfants… , de leur offrir trop de jeux vidéo. [Florence Aubenas, Libération, 17 octobre 2005]
Et puis, accablés de dettes – ils étaient détenteurs d’une quinzaine de cartes de crédit – , ils ont décidé, un peu comme les parents du Petit Poucet abandonnèrent leurs enfants dans la forêt, d’injecter l’insuline à leurs petits puis de se suicider : ils espéraient les retrouver ensuite dans ce " monde meilleur ". Seule Alicia, 11 ans, après trois semaines de coma, est morte de l’injection.
Cela signifie-t-il que ces parents n’aimaient pas leurs enfants ? Rien n’est moins sûr. Sauf à dire que tout était fait pour qu’ils ne puissent plus les aimer – s’il est vrai qu’aimer, qui n’est pas synonyme d’acheter, bien que les hypermarchés veuillent faire croire à leurs acheteurs que si j’aime, j’achète, et que je n’aime que dans la mesure où j’achète, et que tout s’achète et se vend, aimer, donc, n’est pas qu’un sentiment : c’est un rapport, une façon d’être et de vivre avec l’être aimé, et pour lui. Aimer est la forme la plus exquise du savoir-vivre.
Or, c’est un tel rapport exquis que l’organisation marchande de la vie a détruit dans la famille Cartier : de même que les enfants, comme j’ai essayé de le montrer dans le chapitre précédent, sont progressivement et tendanciellement privés de la possibilité de s’identifier à leurs parents par le détournement vers les objets temporels industriels de leur identification primaire, puis de leurs identifications secondaires, tout comme sont elles-mêmes détournées les identifications secondaires de leurs parents, précisément en vue de leur faire adopter des comportements exclusivement soumis à la consommation (et chaque membre de la famille Cartier avait son propre téléviseur), de même, et réciproquement, les parents, ainsi incités à consommer tant et plus par toute la puissance des télévisions, des radios, des journaux, des campagnes d’affichages publicitaires, des prospectus dans les boîtes aux lettres, des éditoriaux et des discours politiques ne parlant que de " relance de la consommation ", sans parler des banques, se trouvent expulsés de la position où ils pourraient aimer leurs enfants réellement, pratiquement et socialement. Il en résulte le mal-aimer d’un terrifiant mal-être, qui devient peu à peu un désamour généralisé – auquel Claude Lévi-Strauss lui-même n’échappe pas.
Notre époque ne s’aime pas. Et un monde qui ne s’aime pas est un monde qui ne croit pas au monde : on ne peut croire qu’en ce que l’on aime. C’est ce qui rend l’atmosphère de ce monde si lourde, étouffante et angoissante. Le monde de l’hypermarché, qui est la réalité effective de l’époque hyperindustrielle, est, en tant que machines à calculer des caisses à code-barre où aimer doit devenir synonyme d’acheter, un monde où l’on n’aime pas. Mr et Mme Cartier pensaient que leurs enfants seraient plus heureux s’ils leur achetaient des consoles de jeux et des téléviseurs. Or, plus ils leur en achetaient, et moins eux et leurs enfants étaient heureux, et plus ils avaient besoin d’acheter encore et toujours plus, et plus ils perdaient le sens même de ce qu’il en est de l’amour filial et familial : plus ils étaient désaffectés par le poison de l’hyperconsommation. Depuis 1989 qu’ils s’étaient mariés et avaient fondé cette famille, on leur avait inculqué, pour leur malheur, qu’une bonne famille, une famille normale, c’est une famille qui consomme, et que là est le bonheur.
Les parents Cartier, qui ont été condamnés à dix et quinze ans de prison, sont au moins autant des victimes que bourreaux : ils ont été victimes du désespoir ordinaire du consommateur intoxiqué qui, tout à coup, ici, passe à l’acte, et à cet acte terrifiant qu’est l’infanticide, parce que le rattrape la misère économique qu’engendre aussi la misère symbolique. Peut-être fallait-il les condamner. Mais il ne fait à mes yeux aucun doute que s’il est vrai que l’on devait les condamner, un tel jugement, qui doit précisément analyser et détailler les circonstances atténuantes du crime, ne peut être juste que pour autant qu’il condamne aussi et peut-être surtout l’organisation sociale qui a pu engendrer une telle déchéance. Car une telle organisation est celle d’une société elle-même infanticide – une société où l’enfance est en quelque sorte tuée dans l’œuf.
25. Intoxication, désintoxication
La consommation est une intoxication : c’est ce qui devient de nos jours évident. Et c’est ce que souligne un article écrit par Edouard Launet durant le procès contre Patricia et Emmanuel Cartier. Ceux-ci vivaient à proximité de Saint Maximin, … la plus grande zone commerciale d’Europe , …à la fois eldorado et terrain vague, abondance et misère sociale. Le marché, rien que le marché, et ces petits shoots d’adrénaline que procure l’achat d’un téléviseur ou d’un canapé. [Edouard Launet, Libération, 17 novembre 2005] … jours avant le drame de Clichy sous bois qui déclencha des émeutes dans toute la France pendant trois semaines, dans l’hypermarché Cora, lieu d’un " grand brassage social " où se mêlent les petites gens de Beauvais, dont les Cartier, et les Parisiens " aisés " qui passent leurs week-end dans des résidences secondaires, autour de Gouvieux et de Chantilly, dans cet hypermarché où 40 000 personnes passent chaque jour par les 48 caisses et leurs machine à code-barre, Jean-Pierre Coppin, chef de la sécurité du magasin … observe : " On sait qu’on est assis sur le couvercle de la marmite ".
Car la consommation immédiate de la vie provoque de nos jours souffrance et désespoir, au point qu’un profond malaise règne désormais dans la société de consommation. Comme je l’avais déjà signalé , une enquête commandée par la grande distribution à l’institut IRI fit apparaître la figure de l’" alter-consommateur ", tandis que proliféraient d’autres symptômes de cette crise de la civilisation hyperindustrielle – à travers les mouvements antipub et anticonsommation, à travers la baisse de la vente des produits de marques, etc . On m’a plusieurs fois objecté, depuis, qu’en réalité, il n’y avait pas de baisse avérée de la consommation (bien que l’enquête de l’IRI eut été déclenchée à la suite d’une baisse des ventes des produits de grande consommation), et qu’il n’y avait donc pas de crise non plus : les alter-consommateurs, c’est à dire ceux qui se disent mécontents de consommer, et désireux de vivre autrement, sont en effet souvent parmi les plus grands consommateurs – quasiment des hyperconsommateurs. Le malaise ne serait donc qu’une fausse mauvaise nouvelle.
Mais il n’y a aucune contradiction dans le fait qu’un hyperconsommateur dénonce la consommation, pas plus que dans les réponses à l’enquête qu’avait menée Télérama sur les pratiques télévisuelles des Français et les jugements qu’ils portent sur les programmes, et qui faisait apparaître que si 53% d’entre eux considèrent que les programmes de télévision sont détestables, la plupart de ceux-ci regardent cependant ces programmes qu’ils jugent si mal. Il n’y a là aucune contradiction parce qu’il s’agit dans les deux cas de systèmes addictifs, et l’on sait bien qu’un système est addictif précisément dans la mesure où celui qui est pris dans ce système le dénonce et en souffre d’autant plus qu’il ne peut pas en sortir – ce qui est le phénomène bien connu de la dépendance.
Le " shoot d’adrénaline " que procure un achat important est produit par le système addictif de la consommation, et il en va du téléspectateur interrogé par Télérama, et qui condamne les programmes que cependant il regarde, comme de l’héroïnomane qui, parvenu au stade où la consommation de la molécule de synthèse ne lui procure plus que des souffrances, parce qu’elle a bloqué sa production naturelle de dopamine, sérotonine, enképhalines et endorphine, ne trouve un apaisement temporaire que dans une consommation supplémentaire de ce qui cause cette souffrance – consommation immédiate de la vie qui ne peut qu’aggraver encore le mal, jusqu’à le transformer en désespoir. C’est pourquoi, tout comme le téléspectateur qui n’aime plus ses programmes de télévision, si l’on demande à un intoxiqué ce qu’il pense de la substance toxique dont il dépend, il en dira le plus grand mal ; mais si on lui demande de quoi il a besoin désormais, il répondra, encore et toujours : de l’héroïne.
Encore et toujours, du moins tant qu’on ne lui a pas donné les moyens de se désintoxiquer.
La stupéfaction télévisuelle, qui fut d’abord le haschich du pauvre, et remplaça l’opium du peuple, est devenue une drogue dure depuis qu’ayant détruit le désir, elle vise le pulsionnel – puisque il n’y a plus que les pulsions lorsque a disparu le désir qui les équilibrait en les liant. C’est le moment où l’on passe de la consommation heureuse, celle qui croit au progrès, à la consommation malheureuse où le consommateur sent qu’il régresse et en souffre. À ce stade, la consommation déclenche des automatismes de plus en plus compulsifs et le consommateur devient dépendant du shoot consommatoire. Il souffre alors d’un syndrome de désindividuation qu’il ne parvient plus à compenser qu’en intensifiant ses comportements de consommation, qui deviennent du même coup pathologiques.
Il en va ainsi parce que d’autre part, dans la société hyperindustrielle où tout devient services, c’est à dire relations marchandes et objets de marketing, la vie a été intégralement réduite à la consommation, et les effets de désindividuation psychique se répercutent intégralement sur l’individuation collective, étant donné que, dans les processus d’individuation psychique et collective, l’individuation psychique ne se concrétise que comme individuation collective et transindividuation, et que la réciproque est vraie. Quand tout devient service, la transindividuation est intégralement court-circuitée par le marketing et la publicité. La vie publique est alors détruite : l’individuation psychique et collective y est devenue la désindividuation collective. Il n’y a plus de nous, il n’y a plus qu’un on, et le collectif, qu’il soit familial, politique, professionnel, confessionnel, national, rationnel ou même universel n’est plus porteur d’aucun horizon : il apparaît totalement vide de contenu, ce que l’on appelle, chez les philosophes, la kénose, ce qui signifie aussi que l’universel n’est plus que le marché et les technologies qu’il répand sur la planète entière – au point que la République, par exemple, ou ce qui prétend la remplacer, ou l’épauler, ou la réinventer, par exemple l’Europe, ne sont ni aimée, ni désirée.
26. La désaffection
La société hyperindustrielle est intoxiquée, et la première question politique est celle de sa désintoxication. L’intoxication est produite par des phénomènes de saturation, qui affectent en particulier les fonctions supérieures du système nerveux : la conception (l’entendement), la sensibilité et l’imagination, c’est à dire la vie intellectuelle, esthétique et affective – l’esprit dans toutes ses dimensions. Là est la source de toutes les formes de la misère spirituelle. Appelons cognitive et affective ces formes de saturation typiques de la société hyperindustrielle.
Tout comme il y a de la saturation cognitive (on étudie depuis plus de dix ans déjà les effets du cognitive overflow syndrom qui ont pour résultat paradoxal – paradoxal pour une conception platement informationnelle de la cognition – que plus on apporte d’information au sujet cognitif, moins il connaît ), il y a en effet de la saturation affective. Les phénomènes de saturation cognitive et affective engendrent des congestions individuelles et collectives, cérébrales et mentales, cognitives et caractérielles, dont on peut comparer les effets paradoxaux aux congestions urbaines engendrées par les excès de circulation automobile, dont les embouteillages sont l’expérience la plus banale, et où l’automobile, censée faciliter la mobilité, produit au contraire la paralysie et le ralentissement bruyant et polluant, c’est à dire toxique. Comme la saturation cognitive induit une perte de cognition, c’est à dire une perte de connaissance, et un égarement des esprits, une stupidité des consciences de plus en plus inconscientes, la saturation affective engendre une désaffection généralisée.
Saturation cognitive et saturation affective sont donc des cas d’un phénomène plus vaste de congestion qui frappe toutes les sociétés hyperindustrielles, de Los Angeles à Tokyo en passant désormais par Shangaï. Lorsque Claude Lévi-Strauss dit s’apprêter à quitter un monde qu’il n’aime plus en donnant l’exemple de l’explosion démographique, il le présente un cas de cette intoxication généralisée :
L'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne.
Dans tous ces cas de congestion, l’humanité semble confrontée à un phénomène de désassimilation comparable à ce que Freud décrit chez les protistes, en référence aux travaux de Woodruff :
Les infusoires sont conduits à une mort naturelle par leur propre processus vital. … L’infusoire, laissé à lui-même, meurt d’une mort naturelle du fait d’une élimination imparfaite des produits de son propre métabolisme. Il se peut qu’au fond tous les animaux supérieurs meurent aussi d’une même incapacité à éliminer. [Freud, Essais de psychanalyse, Payot, 1981, p. 106]
De plus, et j’y reviendrai au dernier chapitre, la sclérose que peut devenir le surmoi, et comme morale, peut aussi engendrer une telle auto-intoxication . Cependant, l’intoxication produite par la saturation affective (indubitable élément de causalité du crime de Patricia et Emmanuel Cartier) constitue un cas de congestion intrinsèquement plus grave et plus préoccupant que tous les autres : affectant les capacités de réflexion et de décision des individus psychiques et collectifs, mais aussi leurs capacités à aimer leurs proches aussi bien que leurs semblables, leurs capacités à les aimer effectivement, pratiquement et socialement, conduisant nécessairement, du même coup et à terme, à des phénomènes très graves de haine politique et de conflits violents entre groupes sociaux, ethnies, nations et religions, elle rend proprement inconcevable quelque issue que ce soit aux autres cas de congestion qui intoxiquent toutes les dimensions de la vie sur la planète toute entière.
La saturation affective est ce qui résulte de l’hypersollicitation de l'attentioni, et en particulier de celle des enfants, qui vise, par l’intermédiaire des objets temporels industriels, à détourner leur libidoi de ses objets d’amour spontanés vers les objets de la consommation exclusivement, provoquant une indifférence à leur parents et à tout ce qui les entoure, et une apathie généralisée, et surchargée de menace – dont les monstrueux héros d’Elephant, le film de Gus Van Sant, sont comme les symboles, ou les diaboles.
Au Japon, où je me trouve en ce moment même en train d’écrire ce chapitre, la réalité congestionnée de la désindividuation psychique et collective entraîne passages à l’acte, mimétismes télévisuels et criminels, et absence de vergogne, c’est à dire d’affection (et, à deux jeunes criminels japonais, auxquels on demandait de dire leur repentir pour leurs victimes, respectivement une femme de 64 ans, et de tout jeunes enfants d’une école maternelle, ceux-ci répondirent n’éprouver aucun regret ), tandis que sont apparus les hikikomori et les otaku, qui constituent deux cas typiques de jeunes individus désaffectés, des cas qui ont pris des proportions particulièrement préoccupantes : on considère que les hikikomori sont plus d’un million, dont des centaines de milliers de jeunes enfants totalement déscolarisés, très profondément coupés du monde, vivant dans une sorte d’autisme social, recroquevillés dans leur milieui familial et télévisuel, et absolument hermétiques à un milieu social qui est lui-même en bonne partie ruiné :
Vie de famille bouleversée, M. Okuyama, 56 ans, raconte : "Nous avons été obligés de déménager en mai dernier car il devenait trop dangereux de rester avec lui en raison de la violence de mon fils". Malgré la volonté des parents, la communication est quasi-absente. "J'essaie de le rencontrer une fois par semaine et d'avoir une discussion normale avec lui, mais c'est très difficile. Il ne parle que par insultes et mots inintelligibles", explique son père. "J'ai peur aussi: il est deux fois plus fort que moi". [http://antithesis.club.fr]
La plupart du temps totalement coupés du système scolaire, il arrive qu’ils passent à l’acte, alimentant ainsi l’importante et inquiétante rubrique des faits divers dans les journaux japonais :
En 2000, un garçon de 17 ans qui vivait reclus chez lui depuis 6 mois après avoir été victime des harcèlements et de brimades à l'école (ijime) a détourné un bus avec un couteau de cuisine et a tué une passagère.
On appelle également otaku les jeunes gens qui ne vivent plus que dans un monde clos, virtuel, jeu, bande dessinée (le mot otaku désignant initialement un héros manga), à l’intérieur duquel seulement ils peuvent rencontrer leurs semblables : d’autres otaku, également désaffectés, c’est à dire désindividués aussi bien psychiquement que socialement, parfaitement indifférents au monde autrement dit :
Dans son dernier roman, " Kyosei Chu " - titre que l'on pourrait traduire par " le Quotidien d'un ver " -, Ryu Murakami analyse de quelle manière les adolescents, refusant d'affronter la réalité, se construisent un univers purement fictif inspiré des bandes dessinées ou des dessins animés. Un univers dans lequel ils pénètrent grâce aux gadgets de plus en plus sophistiqués dont les abreuve l'industrie japonaise. Incapables de communiquer avec les autres, ils passent l'essentiel de leur temps devant une console de jeux ou un ordinateur et sortent peu de chez eux. [Bruno Birolli, Le Nouvel Observateur, Hors Série n°41, 15 juin 2000]
Certains otaku pratiquent des cultes d’objets, en particulier d’objets de consommation :
Ils organisent leur existence autour d'une passion qu'ils poussent à l'extrême. Cela peut être un objet ; ainsi cet otaku qui stocke dans sa chambre de vieux ordinateurs achetés par l'Internet, ou cette gamine qui possède plusieurs centaines de sacs Chanel. Certains de ces cultes bizarres posent problème, comme celui qui s'est subitement développé autour de Juyo, le porte-parole de la secte Aum, coupable de l'attentat au gaz sarin qui a fait douze morts dans le métro de Tokyo en mai 1994.
Nous, les urbains (et nous tous, ou presque tous, nous sommes devenus des urbains), nous souffrons de cette congestion psychique et collective, et de la saturation affective qui nous y désaffecte, lentement, mais inéluctablement, de nous-mêmes et des autres, et qui nous désindividue ainsi, psychiquement aussi bien que collectivement, nous éloignant de nos enfants, de nos amis, de nos chers et de nos proches, des nôtres, qui ne cessent de s’éloigner, et de tout ce qui nous est cher, qui nous est donné par la charis, par la grâce (grâce à) du charisme, du grec kharis, et d’un charisme du monde en quelque sorte, dont procède toute caritas, qui nous est ainsi donné y compris et sans doute d’abord (primordialement, d’emblée) comme idées, idéaux et sublimités : nous, nous autres, nous qui nous sentons nous éloigner des nôtres, nous nous sentons irrésistiblement condamnés à vivre et penser comme des porcs.
Ceux d’entre nous qui ont la chance de vivre encore dans les centre-ville des métropoles, et non dans leurs bans périurbains, tentent de survivre spirituellement en fréquentant assidûment musée, galeries, théâtres, salles de concert, cinémas d’art, etc. Mais ceux-là souffrent alors d’un autre mal : celui de la consommation culturelle, où il faut absorber toujours plus de marchandises culturelles, comme si une autre forme d’addiction s’installait là aussi, sans que ne puisse plus jamais s’installer le temps lent d’une véritable expérience artistique, le temps de l’amateuri, qui a été remplacé par le consommateur souffrant d’obésité culturelle hébétée.
Lorsque nous avons la chance, quand nous l’avons, de pouvoir partir à la campagne – pour autant que nous ne nous retrouvions pas, le samedi après-midi, venant de Gouvieux ou de Chantilly, dans l’hypermarché Cora de Saint Maximin, la plus grande ZAC d’Europe toute proche de la belle abbaye de Royaumont – et que nous y " respirons ", dans la campagne, donc, nous suspendons ces sollicitations affectives innombrables, permanentes et systématiques, qui caractérisent la vie contemporaine où tout devient services, désormais presque totalement soumise au marketing, y compris " culturel ". Nous retournons alors aux sollicitations affectives primaires de la verdure, des fleurs, des animaux, des éléments, de la solitude, de la marche, du silence et du temps lent – lenteur et silence aujourd’hui perdus : le caractère absolument incessant de l'adresse aux sens, et qui a précisément pour but de ne jamais cesser, induit une saturation telle qu’est venu le temps de la désaffection – et de la désaffectation.
Cette perte de conscience et d’affect, induite par les saturations cognitive et affective, qui constitue la réalité effrayante de la misère spirituelle, au moment où la planète doit affronter et résoudre tant de difficultés, est ce qui caractérise l’esprit perdu du capitalisme. Il y a aujourd’hui des êtres désaffectés comme il y a usines désaffectées : il y a des friches humaines comme il y a des friches industrielles. Telle est la redoutable question de l'écologie industrielle de l'esprit. Et tel est l’énorme défi qui nous échoit.
27. Turbulences
Au-delà de la désaffection, qui est la perte d’individuation psychique, la désaffectation est la perte d’individuation sociale, et c’est ce qui, à l’époque hyperindustrielle, menace les enfants turbulents tendant à devenir des individus désaffectés. Or, les enfants turbulents, depuis la réalisation par l’Inserm d’une étude largement inspirée de la classification américaine des pathologies et des méthodes cognitivistes associant psychiatrie, psychologie, épidémiologie, sciences cognitives, génétique, neurobiologie et éthologie, font l’objet d’une qualification nosologique appelée " trouble des conduites " . [Rapport de l'INSERM : "Troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent"]
À ce " trouble des conduites " sont associés systématiquement des troubles de l’attention. Or, l’attention est aussi, comme le soulignait Rikfin, la marchandise la plus recherchée – par exemple par TF1 et son PDG Patrick Le Lay, lequel explique d’ailleurs que l’attention en quoi consiste le " temps de cerveau disponible ", qui constitue l’audiencei quantifiable des télévisions, est parfaitement contrôlable et contrôlée, puisque, grâce aux techniques de l’audimat, c’est le seul produit au monde où l’on " connaît " ses clients à la seconde, après un délai de 24 heures. Chaque matin, on voit en vraie grandeur le résultat de l’exploitation de la veille. [Les dirigeants face au changement, p. 93]
La désaffection produite par la saturation affective, qui est donc aussi une désaffectation, c’est à dire la perte de place et de reconnaissance sociales résultant de la perte d’individuation qui frappe l’individu désaffecté, et qui se traduit aussi en cela par le processus de désindividuation collective, tient précisément à ce que la captation de l’attention détruit l’attention – c’est à dire également cette qualité d’être attentionné, qui est sociale, et non seulement psychologique, et qui s’appelle, très précisément, la vergogne, sens qu’a particulièrement bien conservé le mot espagnol vergüenza .
Il en va ainsi parce que l’attention est ce qui agence et ce qui est agencé par les rétentions et les protentions, tandis que celles-ci sont désormais massivement et incessamment contrôlées par les processus rétentionnels et protentionnels télévisuels, tels que, dès le stade de l’identification primairei chez l’enfant, puis comme identifications secondaires chez l’adulte, ils visent à substituer, aux rétentions secondaires collectives élaborées par le processus de transindividuation en quoi consiste la vie d’un processus d’individuation psychique et collective, des rétentions secondaires collectives entièrement préfabriquées selon les résultats des études de marché et des techniques de marketing prescriptrices des campagnes de publicité aussi bien que des cahiers des charges des designers, des stylistes, des développeurs et des ergonomes réalisant ensemble la socialisation accélérée de l’innovation technologique.
C’est pourquoi l’étude qui a inventé cette pathologie du " trouble des conduites " très inspirée par les catégorisations nord-américaines est largement sujette à caution dans la mesure où elle néglige gravement cet état de fait : que l’attention est devenue une marchandise. Or, le " trouble des conduites ", qui qualifie un comportement au cours duquel sont transgressées les règles sociales, est considéré comme un trouble mental qu’accompagnent différents symptômes, et en particulier, donc, le déficit de l’attention et le " trouble oppositionnel avec provocation " :
L’une des pathologies psychiatriques les plus fréquemment associées au trouble des conduites est le trouble déficit de l’attention/hyperactivité, ainsi que le trouble oppositionnel avec provocation.
Les enfants ou adolescents qui y sont sujets souffrent également souvent de dépression et d’anxièté, et ils passent facilement à l’acte suicidaire.
L’enquête prétend avoir dégagé une probabilité empiriquement constatable d’expression du trouble en association avec les cas suivants :
Antécédents familiaux de trouble des conduites, criminalité au sein de la famille, mère très jeune, consommation de substances, etc. …
Dès lors, le groupe d’experts recommande un repérage des familles présentant ces facteurs de risque au cours de la surveillance médicale de la grossesse.
Il suggère également de développer une étude épidémiologique auprès d’un échantillon représentatif des enfants et des adolescents en France… [et de] réaliser également des études ciblées sur des populations à haut risque (milieu carcéral, éducation spécialisée, zones urbaines sensibles).
La véritable question est du côté des effets destructeurs de l’individuation psychique aussi bien que collective provoqués par la saturation affective et les diverses formes de congestions qui intoxiquent la société contemporaine, et en particulier, la télévision, qui ravage les facultés attentionnelles aussi bien des enfants et des adolescents et de leurs parents, ainsi que des adultes en général, et en particulier des hommes politiques – et sans doute aussi des chercheurs de l’Inserm qui regardent la télévision.
L’étude, qui part d’hypothèses cognitivistes conférant aux facteurs génétiques et donc héréditaires un rôle essentiel, n’ignore certes pas qu’il faut évaluer la part de la susceptibilité génétique et la part de la susceptibilité environnementale spécifiques au trouble des conduite.
Et, tout en préconisant de rechercher des " gènes de vulnérabilité ", elle recommande aussi d’ étudier l’influence de l’attitude parentale.
Si l’on n’en est pas à suggérer de stériliser les parents présentant des facteurs de risque, on ne peut cependant pas s’empêcher de penser que plusieurs Etats d’Amérique du Nord, le pays dont la classification des pathologies mentales inspire ici manifestement ce travail de l’Inserm, pratiquèrent avant la guerre ce genre de stérilisation, et que l’horreur nazie révélée fit cesser cependant.
Mais surtout, pourquoi ne pas proposer d’étudier l’influence de la télévision et des innombrables techniques d’incitation à la consommation qui causent précisément le syndrome de saturation affective ? La télévision est bien mentionnée :
Les études récentes confirment que l’exposition à la violence télévisuelle à l’âge de 8 ans est hautement prédictive de comportements agressifs à long terme. Cette relation est maintenue indépendamment du quotient intellectuel et du statut socioéconomique des sujets , mais uniquement comme véhicule de scènes de violence.
Mais l’influence de la télévision n’est justement pas appréhendée pour ce qu’elle est : comme effet d’un objet temporeli industriel qui permet de capter l’attention que l’ennemi du beau appelle " le temps de cerveau disponible ". Quel crédit apporter, dès lors, à une étude psychopathologique qui prétend décrire des phénomènes de perte d’attention, et qui ne prête elle-même aucune attention aux techniques de captation de l’attention ?
La question de l’environnement psychosocial est celle du processus d’individuation psychique et collective tel qu’il est surdéterminé par le processus d’individuation technique, surtout à l’époque où la technique est devenue pour une très grande part un système industriel de technologies cognitives et de technologies culturelles, c’est à dire de ce que j’appelle, avec mes amis de l’association Ars Industrialis , les technologies de l’esprit. Dès lors, les dysfonctionnements des processus d’individuation psychiques, collectifs et sociaux doivent plus être traités comme des questions de sociopathologie que de psychopathologie.
28. De la psychopathologie à la sociopathologie
Qu’il y ait des terrains psychopathologiques plus fragiles, et donc plus sensibles et plus favorables aux sociopathologies, c’est une évidence. Mais s’il semble qu’apparaissent de nouvelles formes de pathologies, comme on le voit par exemple au Japon, ce concept de nouvelles psychopathologies est récusé par de nombreux psychiatres dans la mesure où il s’agit en vérité essentiellement de sociopathologies – c’est à dire de questions d’économie politique.
De plus, la fragilité psychopathologique, comme défaut affectant une psyché, est très souvent, sinon toujours, ce qui est à l’origine, et par des processus de compensation à la fois bien connus et intrinsèquement mystérieux, des individuations les plus singulières, et en cela les plus précieuses pour la vie de l’esprit, aussi bien au plan psychique qu’au plan collectif. J’ai déjà montré comment divers cas de handicaps furent à l’origine de génies artistiques, ainsi des doigts paralysés à partir desquels Django Reinhardt inventa la guitare jazz moderne, ou de Joë Bousquet qui devint écrivain en voulant être sa blessure, ou encore des asocialités que l’on qualifia toujours de perversion de Baudelaire, de Rimbaud et de tant de poètes, sans parler des folies de Hölderlin, de Nerval, d’Artaud, de Van Gogh, etc. Et ajoutons ici la surdité de Thomas Edison.
Le discours de l’Inserm, ignorant totalement ces questions, repose sur une pensée exclusivement normative et hygiéniste de l’appareil neurologique aussi bien que de la vie en général, et de l’être humain en général, qui ne semble tenir aucun compte, en outre, des analyses de Canguilhem sur le normal et le pathologique, et qui ne voit pas que c’est l’articulation entre système nerveux, système technique et système social qui constitue le fait humain total, c’est à dire réel – ce que permet de comprendre, depuis Leroi-Gourhan, l’analyse de l’hominisation comme technogenèse et sociogenèse. Il est vrai que la psychanalyse a elle-même gravement négligé ces dimensions hors desquelles il n’y aurait pas de psychogenèse, comme j’ai commencé de l’analyser avec le concept d’organologie générale, et je reviendrai sur ce point au chapitre suivant.
L’enquête de l’Inserm entrouvre cependant elle-même, quoique bien timidement, des perspectives vers ces sujets, lorsqu’elle souligne que la première question, en terme de genèse de la pathologie, est le langage, ce qui devrait toutefois inclure aussi, et plus généralement, tous les circuits d’échanges symboliques :
Un mauvais développement du langage entrave la mise en œuvre d’une bonne sociabilité, gêne la qualité de la communication et favorise l’expression de réactions défensives de l’enfant.
Le " groupe d’experts " recommande pourtant, en fin de compte, de développer de nouveaux essais cliniques avec des associations de médicaments et de nouvelles molécules.
Mais en vue de quoi ? Vraisemblablement sans pouvoir préconiser l’usage de la Ritaline, puisque cette molécule, qui servit précisément à " soigner " les enfants américains sujets à des " troubles des conduites ", a fait l’objet d’un procès retentissant, il s’agit manifestement, pour l’Inserm, d’une part de mettre en place des mesures de dépistage visant à catégoriser et lister a priori des enfants potentiellement " sujets " à ce trouble, et de proposer la solution d’une camisole chimique, c’est à dire d’une technologie de contrôle pharmaceutique, ouvrant par la même occasion un nouveau marché, et qui permette de ne pas poser le problème de sociopathologie – qui est le seul vrai problème.
29. La culpabilisation des parents et des enfants est un écran de fumée qui dissimule les question d’économie politique industrielle et conduit à la camisole chimique.
Ce processus de culpabilisation des parents et des enfants permet de les accuser en lieu et place de la société sans vergogne qui les rend fous et les détruit, que l’on n’aime plus et où l’on ne s’aime plus, où règnent mécréance, discrédit, cynisme et bêtise. Les turbulences comportementales, induites par la désindividuation généralisée, ne sont pas provoquées par des causes génétiques, même si elles ont évidemment aussi des bases génétiques – ni plus ni moins qu’une quelconque molécule bénéfique pour un organisme mais qui, lorsque est franchi un certain seuil, devient tout à coup toxique. Car les bases génétiques de l’irritabilité sont aussi celles de la sociabilité, et plus précisément, de ce que Kant appela l’insociable sociabilité :
J’entends ici par antagonisme l’insociable sociabilité des hommes, c’est à dire leur inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d’une répulsion générale à le faire, menaçant constamment de désagréger cette société. L’homme à un penchant à s’associer, car dans un tel état il se sent plus qu’homme [c’est moi qui souligne ces derniers mots] par le développement de ses dispositions naturelles. Mais il manifeste aussi une grande propension à se détacher (s’isoler [en japonais : hikikomori]), car il trouve en même temps en lui le caractère d’insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens. … Remercions donc la nature pour cette humeur peu conciliante, pour la vanité rivalisant dans l’envie, pour l’appétit insatiable de possession ou même de domination. Sans cela toutes les dispositions naturelles excellentes de l’humanité seraient étouffées dans un éternel sommeil. L’homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce : elle veut la discorde.
Cette insociable sociabilité est donc la bonne éris :
Ainsi dans une forêt, les arbres, du fait même que chacun essaie de ravir à l’autre l’air et le soleil, s’efforcent à l’envi de pousser beaux et droits. Toute culture, tout art formant une parure à l’humanité, ainsi que l’ordre social le plus beau, sont les fruits de l’insociabilité, et d’épanouir de ce fait complètement, en s’imposant un tel artifice, les germes de la nature.
L’insociable sociabilité est la façon que Kant a d’articuler le psychique et le collectif, et comme un processus d’individuation qui met la singularité, et l’éris qu’elle suppose comme émulation, c’est à dire comme élévation et transmission, au cœur de sa dynamique. Or, c’est ce que les normalisations et classifications de la nosologie mentale d’inspiration américaine voudraient pouvoir contrôler pour le réduire à un modèle comportemental entièrement normalisable, c’est à dire calculable.
L’homme – qui est le nom courant du processus d’individuation psychique et collective – est un être en devenir, c’est à dire par défaut, et ce sont ses défauts qu’il faut, et comme son avenir, c’est à dire : comme ce qui constitue ses chances. Même dans la vie, on le sait, ce sont les défauts de réplication de l’ADN qui permettent l’évolution et la néguentropie caractéristiques du vivant. La normalisation chimiothérapique voudrait éliminer ce défaut qu’il faut : elle voudrait un processus sans défaut. Mais un tel processus serait sans désir – car l’objet du désir est ce qui lui fait défaut. Or, un processus sans désir est un processus irrationnel, qui conduit à la société démotivée des camisoles chimiques et des bracelets électroniques, ou à la politique de la terreur, ou, plus vraisemblablement, aux deux à la fois. Car les êtres sans désir voient leurs pulsions se délier, et la société ne sait plus les contenir que par la répression – outre la régression qui déchaîne ces pulsions.
Non seulement on peut faire, avec l’irritabilité génétique, qui est la base moléculaire de l’insociable sociabilité, des choses parfaitement sociables, mais on ne peut faire de choses véritablement sociables, c’est à dire individuantes, inventives et civilisés, que sur de telles bases. Quant à la turbulence pathologique dont souffre en effet la société qui ne s’aime pas et où règne la bêtise, elle est engendrée par un système dont cette thérapeutique des conduites est un élément : ce système est celui du populisme industriel qui a fait de l’attention une marchandise ayant perdu toute valeur, et qui engendre du même coup des comportements en effet socialement non-attentionnés, de la part d’individus désaffectés, de friches humaines dans une situation générale de misère symbolique, spirituelle, psychologique, intellectuelle, économique et politique.
Les enfants turbulents ont heureusement pour eux des défauts. Mais la libido de ces enfants énergétiquement constituée par ces défauts mêmes, parce qu’elle est détournée des objets d’amour que sont les parents, et plus généralement, des objets sociaux, c’est à dire des objets d’idéalisation et de sublimation de cet amour, en tant qu’objets de constitution de l’individuation collective, par exemple les objets de savoir, ou les objets du droit, en tant que concrétisations sociales et par défaut de la justice qui n’existe pas, la libido de ces enfants, ainsi détournée, devient alors dangereuse, pulsionnelle, agressive et terriblement souffrante de ne plus n'arriver à aimer ses parents et leur monde, tandis que les parents n'arrivent plus à aimer leurs enfants : ils n’en ont plus les moyens.
Ces enfants demandent alors plus de consoles de jeu, plus de télé, plus de coca, plus de vêtements ou d’accessoires scolaires de marque, et les parents, soumis à cette pression à laquelle l’appareil social est désormais soumis lui-même en totalité, sont privés de leurs rôles de parent. C’est dans de telles circonstances que Patricia et Emmanuel Cartier ont pu passer à l’acte, mais en emportant leurs enfants avec eux – et tout comme ceux qui, tels les kamikazes de Londres, se prennent pour des martyrs : en affirmant qu’il y a une vie après la mort, et qu’elle vaut mieux que cette vie de désespoir.
J’affirme que de telles circonstances atténuent très fortement la culpabilité des parents Cartier. Et j’ajoute qu’en analysant les conditions dans lesquelles les dispositifs de captation de l’attention et plus généralement d’incitation à la consommation causent des troubles de la conduite, y compris ceux qui ont amené des parents à devenir infanticides, la question n'est pas de trouver des coupables, mais de tenter de penser ce qu’il en est de la justice et l’injustice à l’époque hyperindustrielle, et d’en déduire des propositions politiques nouvelles et porteuses d’un avenir, c’est à dire trouant l’horizon du désespoir.
Enfants, adolescents et parents sont gravement déséquilibrés dans leurs relations, c’est à dire dans leur être : le passage du psychique au collectif commence dans cette relation, qui n’est donc pas seconde, mais primordiale, et tramée par le processus d’identification primaire où l’enfant comme ses parents n’est ce qu’il est qu’en relation transductive avec les siens. Or, cette relation est à présent gravement perturbée par l’objet temporel industriel qui capte et détourne l’attention, modifiant en profondeur le jeu des rétentions et des protentions, et surtout, produisant des rétentions secondaires collectives qui court-circuitent le travail de transmission entre les générations, qui est aussi la seule possibilité de dialogue, y compris et même surtout sur le mode de l’opposition et de la provocation. Ces questions constituent le fond problématique de ce que j’ai appelé, dans le chapitre précédent, le complexe d’Antigone, et cela signifie aussi qu’elles renvoient à la question de la justice, du droit et du désir hypersurmoïque de la jeunesse qui peut tourner, si il est maltraité, à des processus de sublimation négative – c’est à dire aussi, dans certains cas, à des fantasmes particulièrement dangereux de martyrologie.
Contrôle de l’attention et canalisation des processus d’identification primaire et secondaire montrent qu’il y a un lien évident entre les procès que l'on fait à des enfants que l'on accuse d'être turbulents – car c'est bien un procès qu'on leur fait, et l’on sait qu’aux Etats Unis, ces enfants sont traités comme des malades – , enfants que l’on sacrifie ainsi sur l’autel de la consommation, ce qui est un scandale, une honte et une infamie, et le procès des époux Cartier. Car cette manière de les traiter, qui répond aux intérêts communs de l'industrie pharmaceutique, de la télévision et des hypermarchés, dont un chef de service de sécurité assure cependant savoir être " assis sur le couvercle de la marmite ", est une manière de faire peser sur les petites épaules de ces enfants la décadence d'une société intoxiquée par ses excrétions et produits de désassimilation : une société malade d’une auto-intoxication, qui est une destruction mentale, et la ruine de la " valeur esprit ".
L’enquête de l’Inserm qui prétend établir scientifiquement que ces enfants sont pathologiquement turbulents et déficitaires sur le plan attentionnel apparaît alors pour ce qu’elle est : un artifice de plus, qui permet de masquer que ces enfants sont rendus turbulents par une société qui est devenue profondément pathologique, et, en cela, inévitablement pathogène en effet. Les résultats de l’enquête, à cet égard, ne sont sans doute pas faux. Mais les prémisses qui servent à interpréter ces résultats le sont tout à fait. Et la conclusion qui en est tirée, et qui préconise en particulier une chimiothérapie du malaise social, en même temps qu’un dépistage qui est clairement un fichage, est catastrophique. Elle est d’autant plus catastrophique qu’elle ne pourra que conduire à répéter ce qui s’était déjà produit aux Etats-Unis avec la Ritaline.
30. Manques d’attentions – ou la toxicomanie comme modèle social
Au cours d’un procès intenté à l’industrie du médicament qui mit sur le marché la Ritaline, il fut déjà question de déficit de l’attention et du trouble pathologique qu’il était censé constituer chez les enfants et les adolescents :
" On ne peut pas continuer à bourrer nos enfants de psychotropes tout en leur demandant de dire non à la drogue " [déclare] Andrew Waters qui accuse l’American Psychiatric Association " d’avoir comploté pour pousser la jeunesse américaine à la consommation des pilules calmantes ".
Ce qu’il s’agit de calmer est l’ADD, c’est à dire d’attention deficit disorder, et les pilules calmantes sont du méthylphénidate, c’est à dire de la Ritaline, une " molécule proche des emphétamines ". Sa prescription a une définition si large que n’importe quel gamin distrait ou un peu turbulent peut y entrer. Résultat : le nombre d’ordonnances pour la Ritaline a connu une progression de 600 % entre1989 et 1996.
Coïncidence : la Ritaline est mise sur le marché au moment où les époux Cartier se marient. La définition de sa prescription est si large qu’elle peut évidemment s’appliquer à tous ces enfants qui, en Europe, en Amérique, au Japon et bientôt en Chine, deviennent de plus en plus turbulents, déficitaires sur le plan attentionnel psychologique tout aussi bien que non-attentionnés sur le plan social, abrutis qu’ils sont par la télévision, les jeux vidéos et autres désordres sortis des hypermarchés et de la société hyperindustrielle – c’est à dire du populisme industriel qui empoisonne le monde.
Comment dès lors ne pas s’inquiéter de voir le " groupe d’experts " recommander un suivi des enfants " dépistés ", confié aux infirmiers et infirmières des PME et PMI, ainsi qu’aux instituteurs et institutrices des écoles, aux éducateurs spécialisés, etc. ? Car face à ces " pathologies " qui affectent tout autant les infirmiers et les infirmières, ainsi par exemple de Patricia Cartier, qui était infirmière, que les instituteurs et les institutrices et que les parents des enfants " dépistés " comme souffrant de troubles de la conduite, pathologies parentales qui s’appellent par exemple le crédit à la consommation, la consommation addictive, l’abandon des enfants devant la télévision, etc., comment avoir confiance dans des structures institutionnelle de " suivi des enfants dépistés " pour faire face aux difficultés de ces enfants – sinon pour leur faire consommer de la Ritaline, ou un équivalent plus récent et autorisé ?
Car la Ritaline a été retirée du marché après un procès, donc – mais aussi après avoir fait de très graves dégâts. Que l’on me comprenne bien : on a eu confiance dans la Ritaline – et on a eu tort. Et réfléchissons bien, donc, ici, à ce que dans certains Etats, comme la Virginie, la Caroline du Nord ou le Michigan, de 10 à 15 % d’enfants d’âge scolaire avalent quotidiennement leurs " pilules d’obéissance ", souvent après avoir été signalés par les enseignants, qui invitaient les parents à consulter. Le contrôle chimique des teen-agers a ainsi pris des proportions effrayantes. Un couple d’Albany (Etat de New York) avait décidé d’interrompre provisoirement le traitement de son fils de 7 ans, qui le supportait mal. Les parents ont été dénoncés aux services sociaux pour " négligence " et traînés devant un juge. Lequel a ordonné la reprise des comprimés.
Peut-on faire confiance aux préconisations médicamenteuses et institutionnelles de l’Inserm, ou bien ne faut-il pas combattre le vrai problème, à savoir le désordre écologique de l’esprit à l’époque des technologies culturelles et cognitives monopolisées par le populisme industriel, auquel il faudrait opposer une économie politique et industrielle de l’esprit, novatrice, porteuse d’avenir, inaugurant un nouvel âge de l’individuation psychique et collective, et concrétisant, qui plus est, cette société du savoir ou ce capitalisme de la connaissance que tant de dirigeants, ou de conseillers de dirigeants, ainsi de Denis Kessler, appellent aujourd’hui de leurs vœux – et tout en en appelant à un " réenchantement du monde " ?
Ce que préconise l’Inserm conduit à une articulation fonctionnelle entre psychiatrie et justice pour gérer les ravages catastrophiques que la société de contrôle provoque chez les parents et leurs enfants. Or, de quoi s’agit-il ici ? De la relation entre dikè et aidôs. Au défaut de vergogne de l’appareil symbolique, devenu diabolique, c’est à dire facteur de déliaison sociale, de diaballein, et entretenant systématiquement la régression en quoi consiste le déchaînement pulsionnel, l’enquête préconise d’ajouter un dispositif répressif qui conduit à une pure et simple renonciation à la possibilité d’un surmoi : le corps médical intériorise ici la possibilité et la légalité du fait que la société ne soit plus sociable en rien, et que l’insociabilité ne puisse produire aucune sociabilité, sinon par lobotomisation chimique des singularités en souffrance.
Or, ce contrôle chimique, qui est une généralisation de l’utilisation des systèmes addictifs, préconisés aux plus jeunes enfants en souffrance d’avoir perdu leurs parents, c’est à dire les possibilités d’identification primaire où se forme leur imago, installe de toute évi