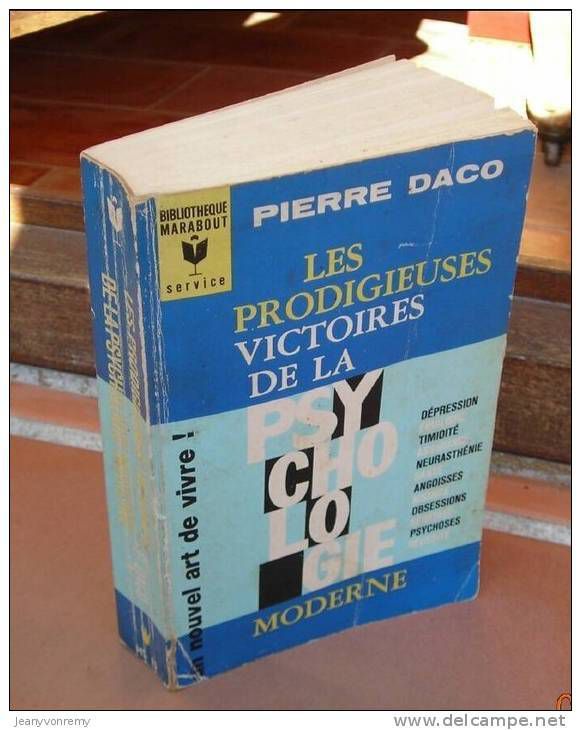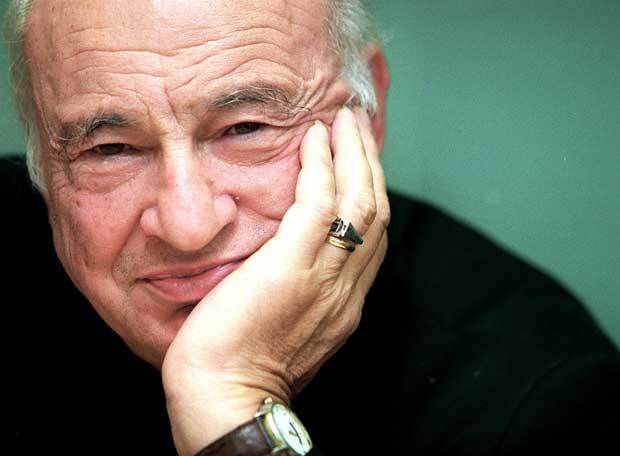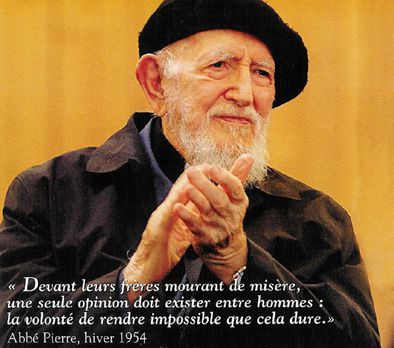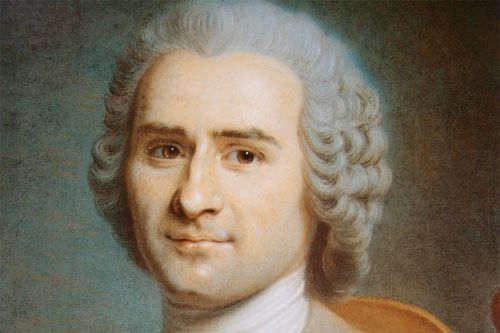Précurseur de la psychologie intégrative et grand humaniste, je rends ici hommage à l'un des plus illustre psychologue européen de son temps. Mort trop jeune en 1992 à l'âge de 56 ans, il laisse derrière lui de nombreux best-sellers qui ont permis une saine compréhension de la psychanalyse et de la psychologie des fondateurs. Depuis son départ, personne à ce jour n'a pu expliquer, avec tant de clarté et de simplicité, pourquoi nous devrions tous connaître les acquis de la psychanalyse et pourquoi nous devrions continuer d'étudier les travaux des fondateurs de la psychologie du XXe siècle. Il a rendu service à de nombreuses familles en quête de réponses et reste toujours d'actualité, malgré la montée des thérapies technicisées. Voici donc le premier des dossiers dédié à feu Pierre Daco.
Pierre Daco est un psychologue et psychanalyste belge né en 1936 et décédé à Coxyde (Koksijde), Belgique, en octobre 1992 à l'âge de 56 ans.
Disciple de Charles Baudouin et de Carl Gustav Jung, il est membre de l'Institut International de Psychagogie et de Psychothérapie (rebaptisé depuis Institut International de Psychanalyse et de Psychothérapie Charles Baudouin) et de la Fondation Internationale de Psychologie Analytique (qui n'existe plus de nos jours). Ses ouvrages ont participé à la diffusion et à la médiatisation de la psychanalyse.
Ses écrits sont à la fois empreints de psychologie analytique, eu égard au fait qu'il restitue les grands symboles (ou archétypes) dans le quotidien de ses patients, et de la psychanalyse freudienne sur la base de laquelle il s'appuie afin d'expliquer les mécanismes inconscients, ou sous-jacents qui sous-tendent toutes nos réactions comportementales, y compris les complexes, inhibitions, la « projection », les « fixations », etc.
Pierre Daco prône une approche plurifactorielle de l'être humain, un accompagnement thérapeutique fondé sur des disciplines différentes dont la complémentarité participait incontestablement à l'unification de l'être humain, à sa « complétude ». Par exemple, le « rêve lucide », teinté de symboles puissants, libérateurs, devenait un excellent auxiliaire, un complément remarquable des séances psychanalytiques proprement dites, dont l'issue idéale était de permettre au sujet de faire remonter à la surface de sa conscience la cause cachée de ses symptômes névrotiques. De même, la pratique de la « libre association » pouvait s'avérer d'une très grande utilité, pratique que Pierre Daco avait incluse dans son approche.
Son premier livre Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne de 1960 connaît un succès sur plus de 50 années de rééditions ininterrompues et constitue le best-seller inégalé des éditions Marabout avec près de 2 millions d'exemplaires vendus et une nouvelle réédition en 2007. En 2010 il reste le numéro 4 des meilleures ventes en ligne des "livres de référence" en psychologie sur amazon.fr.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Daco

----------------------------------------------------------------------
- Premier extrait de l'ouvrage : Burn-out, fatigue et dépression
" La fatigue est un signal d'alarme, un feu rouge. Devant ce signal, le moteur humain doit freiner, jusqu'à l'arrêt complet. "
Le repos et le sommeil sont des besoins naturels. Ils deviennent plus exigeants au fur et à mesure que l'activité se prolonge. Le sommeil est une période de restauration : les cellules cérébrales se débarassent des déchets toxiques, accumulés au cours de leur activité. Par conséquent, le manque de sommeil produit un véritable empoisonnement. Les cellules cérébrales épuisent leurs réserves, accumulant les déchets toxiques.
Durant le sommeil, elles reconstituent leurs réserves alimentaires, sources de leur énergie.
La fatigue est donc un mécanisme naturel, qui permet à l'être humain de se préparer au sommeil, et d'éviter ainsi l'intoxication de ses cellules cérébrales.
Donc, après avoir dormi, l'homme doit se sentir parfaitement dispos, comme un moteur décrassé. Ses cellules nerveuses doivent avoir récupéré leur vitalité. Tout être humain devrait se lever en état de fraîcheur dispose ; tout être humain devrait se lever en chantant, célébrant joyeusement la renaissance du jour ! ...
Regardons cependant autour de nous, et nous verrons qu'il n'en est rien. La fatigue est une des grandes déficiences actuelles. La journée commence à peine, et la plupart des gens traînent déjà une fatigue, collée à eux comme de la glue.
Quel est le refrain moderne ?
" dès le matin je me sens fatigué ... le matin je suis irritable ... le matin je suis de si méchante humeur, que j'ai envie de chercher querelle pour un rien ...le matin je dois faire des efforts terribles pour démarrer ; puis cela passe, vers onze heures etc. "
Cette fatigue-là n'est pas, évidemment une fatigue normale.
Mais, tout anormale qu'elle soit, elle règne à l'état épidémique. C'est une fatigue devenue mode de vie ; et qu'un repos, même prolongé, ne parvient pas à éliminer.
On sait parfaitement bien que la vie trépidante moderne, empêche souvent ! le rythme naturel de l'homme. Mais il y a plus. On a " moralisé " la fatigue ; et c'est à peine si on n'en a pas fait une déficience volontaire et méprisable.
Un homme peut donc être méprisé parce qu'il est fatigué. Et aussi un homme peut être admiré et récompensé ... parce qu'il est épuisé ! Absurde ? Voyons cela de plus près.
Le mépris de la fatigue
Le climat moderne est donc basé sur l'hyperactivité, la compétition, l'agressivité, la volonté hypertendue. On entend souvent : " Il m'énerve, celui-là, à être aussi calme ! " _ Ou bien : " Ah la la ! ... il prend toujours son temps celui-là ! " _ Ou bien encore : " Il m'énerve ... c'est à croire qu'il n'a pas de nerfs ! "
Voici quelques une de ces maximes actuelles qui font tant de mal :
_Allons, surmonte ta fatigue ; on n'a pas le temps d'être fatigué !
_Fatigué ? ... Mais tu es un homme, oui ou non ? ... alors surmonte-la !
_Fatigué ? ... tu n'as qu'à faire un effort !
_ Moi, fatigué ou pas fatigué, je vais de l'avant !
_ La fatigue ? Connais pas ! ( sous-entendu : " ... et par conséquent je ne comprend rien à ceux qui sont fatigués ; je les méprise ; ils n'ont qu'à faire un effort " )
_Tu te sens fatigué et déprimé ? Passe à l'attaque et fonce !
_ Tu es déprimé ? Pure imagination ! Un peu de volonté, voyons ! etc
Devant cette avalanche d'absurdité, que fait souvent une personne fatigué ?
Elle craint le mépris. Elle craint la honte, et redresse l'échine. Elle continue, passe outre, et se met à l'affût de tout les excitants lui permettant de " surmonter " cette fatigue. Elle accomplit efforts sur efforts. Comme cette personne est fatiguée, l'effort devient donc évidemment une chose pénible. C'est comme si elle devait bander tous ses muscles pour ouvrir une porte ...Et la personne fatiguée s'entête, s'obstine, s'acharne. Et aboutit rapidement à la super-fatigue et donc à l'épuisement.
L'état normal de l'homme est-il permanent ?
Non ; il balance entre deux pôles. Il est comme une vague calme ; il oscille entre le moins et le plus, le négatif et le positif ; entre le " creux " et la " bosse ". L'activité normale se présente comme ceci :
a) Il agit sans hâte . Agir est la nature même de l'homme ; cette action peut être manuelle, musculaire, mentale, verbale etc. ==>
b) Cette action amène une sensation : la fatigue naturelle, qui doit être agréable, parce que naturelle ==>
c)L'action ralentit, puis s'arrête. L'homme se repose dans une détente complète ==>
d) Il récupère, se remet en marche, et agit à nouveau.
L'homme normal, donc, doit passer régulièrement de l'action au repos, et du repos à l'action. Avec, au milieu, le signal respecté c'est à dire considéré par l'homme, de la fatigue.
Observons maintenant l'homme épuisé de tout à l'heure :
a) Il agit mal ( parce que fatigué ) ==>
b) Il arrive à la grande fatigue ==>
c) Il repousse cette grande fatigue, et continue l'action == >
d) Il arrive à la très grande fatigue ==>
e) Il la repousse, et aboutit à l'épuisement.
Les effets immédiats de l'épuisement
L'épuisement produit une double réaction :
a) la dépression ;
b) l'agitation.
Tantôt l'une tantôt l'autre. Il n'y a pas de dépression sans agitation ; il n'y a pas d'agitation sans dépression. C'est d'ailleurs la caractéristique de l'épuisé ; il bascule sans cesse entre ces deux pôles. La vague calme de l'instabilité naturelle est devenue une vague affolée, touchant alternativement les extrêmes.
L'homme épuisé devient une caricature de l'homme normalement fatigué.
a) Le " creux " s'approfondit, et devient dépression.
b) La " bosse " exagère ses effets, et devient agitation.
Et la norme : _ il agit
_ Il devient fatigué
_ il se repose
_ il agit de nouveau ...
devient : _il s'agite
_ il devient épuisé
_ il ne peut plus se reposer
_ il s'agite, puis se déprime ...
Et c'est alors une chaîne infernale qui se déroule sans répit ni fin. Car l'épuisement est comme un poison ; il provoque la stupeur ( dépression ) d'une part, et l'excitation ( agitation ) d'autre part.
Où l'épuisé récolte le mépris ?
Dans la dépression, l'activité est fortement réduite ; le déprimé ralentit ses gestes, dans un but d'économie vitale.
Il se plaint de lassitude et d'insomnie. L'amaigrissement apparaît souvent ; les fonctions digestives sont troublées.
Des tremblements de fatigue peuvent se produire, ainsi qu'un affaiblissement de la vision, des troubles cardiaques, etc.
La dépression produit automatiquement une difficulté à agir, puisqu'il y a incapacité ! à agir. L'énergie n'est plus suffisante, pour assumer avec aisance des tâches normales. Un travail bénin devient, pour le déprimé, une montagne à soulever.
Il est donc normal que le déprimé recule devant les circonstances demandant l'action, puisque son système nerveux ne lui permet pas cette action.
Tout cela est donc mécanisme purement physique.
Mais comment la société va-t-elle interpréter ce recul devant l'action ? Elle prétendra que ce déprimé manque d'énergie. Ce qui est évident. Mais ici, on commet souvent une très grave erreur : on croit que l'être humain est maître de son énergie, et qu'il la produit à volonté. Ce qui est absolument faux. La société dira donc du déprimé qu'il manque d'énergie, parce qu'il manque de " volonté " ... Et, ce qui est mieux encore : on le jugera responsable de ce manque de volonté ! Sans se rendre compte que la volonté normale est une question de santé et d'équilibre.
Au lieu de dire : " ayez de la volonté ", on devrait dire " ayez la santé physique et nerveuse qui produit automatiquement la volonté ".
Car la volonté est tout simplement l'aisance. La volonté consiste à déclarer : " je désire faire ceci, et je le fais sans difficulté, dans une aisance parfaite ". Nous pouvons déjà conclure : dès que, pour accomplir une action, on doit faire appel à la volonté, c'est qu'on manque de volonté réelle ; dès que l'action devient crispée, la véritable volonté ( aisance ) disparaît. Dès que l'on doit se battre avec un problème, c'est le problème qui nous bat. La volonté véritable et saine doit être comme l'élégance : invisible. L'acte de volonté réelle consiste à puiser sans effort dans le réservoir d'énergie.
Or le problème est souvent faussé par l'intervention du mérite. Plus un homme surmonte les difficultés, plus il a de mérite. Mais ne serait-il pas plus simple de dire : plus un homme possède la santé et l'équilibre, mieux il agit ; cela lui permet de diminuer l'effort ; et l'énergie sauvegardée le laisse dispos pour d'autres tâches ? Nous reparlerons de tout cela.
Les efforts du déprimé
Un état déficient empêche le déprimé d'agir correctement. Tout effort, ( presque inutile à une personne normale ) devient terrible pour le déprimé. Aussi évident que si une personne, munie de ses deux jambes entières gravit sans difficulté exagérée une montagne, l'estropié y rencontrera un échec presque insurmontable.
Or, on doit se rendre compte que le déprimé fait sans cesse de grands efforts pour surmonter sa déficience _ parce qu'il souffre, et parce qu'il craint le mépris. Malgré cela, on dira qu'il refuse l'effort ! ... En somme, on le taxe purement et simplement de lâcheté, de faiblesse morale et de couardise. On lui flanque sans cesse de cuisantes gifles ; et le déprimé maudit alors l'incompréhension dont il est entouré. Souhaitant même _ qui ne le comprendrait ? _ que tout son entourage sombre dans la dépression, afin qu'il sache qui si lui, déprimé, n'agit pas, hésite et recule, c'est parce que son état l'oblige à ne point agir, à hésiter et à reculer.
Mais cela est trop simple pour être généralement admis. Et les conséquences de mépris apparaissent : le blâme et la punition.
Le déprimé se trouve alors parmi d'autres hommes qui le jugent et le méprisent ... parce qu'ils considèrent, sans doute, que l'épuisé a " voulu son épuisement " !
L'épuisement et la dépression
" ... Vous êtes au bord de la dépression ... "
Voici ce que des millions de personnes ont entendu. Et le médecin prescrit généralement : la gamme des calmants ou des excitants. Les fortifiants nerveux. Les toniques généraux. Les conseils de repos. Les distractions et les voyages. Et si nécessaire, le retrait du milieu familial et l'isolement, un traitement psychologique, etc .
De plus, les troubles gastriques sont examinés avec soins, les réflexes nerveux également ; le médecin pouvant chercher les signes d'une hypertension artérielle ou d'un diabète. Ou les signes d'une affection nerveuse, ou d'une artério-sclérose cérébrale.
Que signifie le terme dépression ?
Qui dit "dépression" dit "Chute de pression". La dépression est un fléchissement de la tension nerveuse ou psychologique. Dépression est donc un terme tout à fait général. C'est une étiquette qui peut recouvrir toute une série d'états. Ces états porteront à leur tour des noms particuliers : asthénie, neurasthénie, psychasthénie, obsessions, schizophrénie, manie-dépressive, allant donc du bénin au très grave. Nous examinerons ces états dépressifs au moment voulu.Le nombre des symptômes de la dépression est donc élevé. La dépression peut avoir une base purement physique (comme dans la neurasthénie ), avec des phénomènes psychologiques surajoutés.
Physiquement encore, une ménopause déclenche parfois la dépression. Mais il ne faut pas conclure que toute ménopause amène forcément une dépression ! Car le terrain prédisposant est toujours important. La prédisposition sera organique (hypertension, diabète ) ou psychologique. La ménopause sert alors d' "interrupteur ". Elle déclenche une situation qui existait depuis longtemps à l'état latent.
De même la dépression peut avoir une base psychologique, familiale, religieuse ; elle peut apparaître à la suite de tracas prolongés de doutes, d'anxiétés, de craintes etc. qui amènent, par épuisement, un fléchissement de tension.
Les symptômes communs aux états dépressifs
Le déprimé se reconnaît facilement à son attitude. Il semble morne, inerte. Ses réactions motrices sont réduites au minimum. Il est avare de gestes ; la moindre action le fatigue. Très souvent l'insomnie apparaît. L'amaigrissement est plus ou moins important.
Des tremblements de fatigue peuvent se produire : ainsi que : maux de tête, hypotension artérielle, sensation d'immense lassitude, obsession de la fatigue, impossibilité de se concentrer, indécision ou hésitation, tristesse sans raison apparente, des manies, des scrupules, cerveau " creux, vide et froid ", douleurs dans la nuque, troubles de la vue Et le plus souvent :
a) aboulie ( manque de volonté )
b) mélancolie
c) peur de devenir fou pouvant aller parfois jusqu'au refus de la maladie
L'aboulie
On connaît la réflexion d'Amiel : " Aimer, rêver, sentir, apprendre, comprendre, je puis tout ; pourvu qu'on me dispense de vouloir " ...
Pour le déprimé, " vouloir " est probablement la grosse difficulté. Mais cette insuffisance se fait surtout sentir dans le passage de l'idée à l'acte. Il désire faire telle chose ; et ce désir est souvent grand. Mais la réalisation de ce désir reste lettre morte.
Le " vouloir " ne se déclenche pas ; l'inertie l'emporte. Puis apparaît un autre désir. Puis un autre encore.C'est une véritable pluie de désirs.
" ...Je ferai ceci tout à l'heure ... je ferai cela demain ... "
Et cependant, ni tout à l'heure, ni demain, la volonté ne se met en branle pour réaliser l'idée. On assiste à une véritable dispersion de la volonté, qui se fragmente en de nombreux morceaux. Mais chacun de ces morceaux demeurent insuffisant pour réaliser l'action ...
Il se peut que l'aboulie soit légère. Dans ce cas, l'action sera tout de même réalisée par la volonté. Mais l'activité sera lente, pénible, avec efforts épuisants. De plus, l'action manquera de durée, de " souffle ". L'envergure fera défaut, ainsi que la persévérance. L'aboulique léger accomplira donc toute une série de petites actions dispersées, parce qu'il est incapable de l'aisance demandée par une action prolongée.
Dans les formes les plus graves, des actions élémentaires deviendront impossibles. Toute activité est abandonnée.
Que disent ces abouliques ?
_ " ... Je suis incapable de faire les poussières ; je le désire pourtant ; je suis honteuse devant mon mari qui pourtant me comprend ; mais j'en suis incapable ; soulever un torchon est pour moi une action au-dessus de mes forces ... je devrais faire les repas pour mon mari, et je n'y parviens pas ; je me disperse en des centaines de petites idées ; mais quand je dois les rassembler, c'en est trop, et j'abandonne tout ; je suis tellement découragée ... je me sens incapable de faire le moindre ménage ; je laisse tout aller ; me peigner est pour moi une action qui me laisse haletante ; je me sens triste à mourir ... "
_ " ... Je suis toujours indécis et hésitant ; il me faut une heure pour acheter un crayon ; je doute, et je me rends parfaitement compte que je suis maniaque ; mais il m'est impossible de faire autrement ; au bout d'un certain temps, je sens comme une crise de rage contre moi ; je sens aussi un tremblement qui monte ; alors, j'abandonne tout et je m'enfuis sous un prétexte quelconque ; sinon, d'exaspération, je serais capable de gifler ou d'insulter n'importe qui ... "
_ " ... Je vérifie dix fois le robinet du gaz avant de me coucher, puis je me relève pour vérifier encore. Puis je me recouche. Je sais l'avoir fermé ... mais je me relève encore. Cela m'épuise. "
Tout ceci reste dans le domaine de la dépression " normale " ... si l'on peut dire. Mais dans les cas plus grave encore, l'activité est absolument arrêtée. Le déprimé se confine au lit, avec tout un cortège de sentiments psychologiques qui le font souffrir, souvent atrocement. Pourquoi ?
Parce que, dans la dépression, tous les phénomènes sont ressentis consciemment par le malade.
Donc, conscient de cette impossibilité de vouloir, le déprimé se trouve face à son entourage. Qui comprend ... ou ne comprend pas. La deuxième possibilité est, évidemment, la plus fréquente. De là à l'accuser de " paresse ", de " fainéantise", de "mauvaise volonté ", il n'y a qu'un pas. On l'accuse aussi de " manquer de volonté ". Alors que c'est justement la conséquence de sa maladie, et ce de quoi il a sans doute le plus conscience lui-même !
Quel est le traitement de l'aboulie ?
L'aboulie est un symptôme de dépression. Elle n'est pas la dépression elle-même. Disparaisse la dépression, et l'aboulie fera de même. Sachons toute fois une chose, et répétons le mot célèbre : " Il n'y a pas de paresseux ; il n'y a que des malades ." Ce qui est profondément vrai. La fonction humaine est : agir et vouloir. Parce que les muscles commandent l'action ; et que le système nerveux déclenche automatiquement le vouloir. Encore faut-il que l'un et l'autre soient en bon état.
Dès qu'une personne ( qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte ) est " paresseux ", la cause doit être recherchée immédiatement. Cette paresse est le symptôme, soit d'une déficience physique ou nerveuse, soit d'une souffrance psychologique pouvant provenir de multiples sources. Re donner la volonté et l'action revient à dire : donner un nouvel équilibre. Nous verrons cela plus loin, dans " Le traitement de la dépression ".
La mélancolie
Elle consiste en une tristesse perpétuelle, profonde, que rien ne semble justifier. Le pessimisme est total, et s'étend à toutes choses.
Comment apparaît le mélancolique ? Tous ces gestes sont las ; ses lèvres tombent aux commissures ; le front est creusé de rides ; la voix est parfois inaudible. Puisons ici dans l'excellente description de J. Sutter, médecin des hôpitaux psychiatriques :
Le discours est en accord avec l'apparence extérieure ; pour le mélancolique, tout est sujet d'affliction ; les événements néfastes sont démesurément grossis, leurs conséquences envisagées sous le jour le plus défavorable ; les faits heureux eux-mêmes sont prétexte à tristesse, et l'ingéniosité morbide du malade s'applique à leur trouver une signification désastreuse. Le malade voyant aussi les effets néfastes avant même que le fait le rendant mélancolique ne se passe. Son pessimisme s'étend à toutes choses, de la façon parfois la plus illogique et la plus imprévue ; il ne désarme jamais.
Le dégoût de vivre est la première réaction du mélancolique. Tout lui devient indifférent, même sa propre souffrance. Chaque matin est une souffrance qui recommence : l'anéantissement est son grand désir. L'aboulie est évidemment totale, ainsi que l'impuissance. Rien ne lui reste, qu'une immense indifférence.
Des phénomènes psychologiques se greffent rapidement : comme lui tout entier est indifférent, le mélancolique se reproche cette indifférence. Telle mère mélancolique dira : " ... je ne parviens plus à aimer mes enfants ; et je les adorais il y a un an ... Mon indifférence m'obsède ; je voudrais pouvoir souffrir, en avoir du chagrin ; je n'ai même pas cela ... "
Le mélancolique est souvent obsédé par des idées d'indignité. Il éprouve de terribles sentiments d'auto-accusation, de remords, de culpabilité. Le mélancolique s'accuse sans cesse des pires choses. Sa souffrance morale est intense, parfois atroce. Il semble atteint d'un tourment fixe, monotone. Son activité mentale se canalise sur ces idées de culpabilité et de remords, et le conduisent parfois à une rumination telle qu'il arrive à l'immobilité complète, et au refus des aliments.
Des perturbations organiques existent dans la mélancolie : manque d'appétit, constipation extrême, mauvaise circulation. Dans certains cas les plus graves, l'alimentation doit se faire artificiellement. Comme le mélancolique est accablé de remords, il cherche parfois à se punir ; il cherche parfois des sanctions pouvant aller jusqu'au suicide.
Une autre forme de mélancolie, très particulière, apparaît parfois chez les jeunes filles. Il s'agit de :
L'anorexie mentale
L'anorexie est la perte de l'appétit. Or, certaines jeunes filles, entre quinze et vingt ans ( donc peu après la puberté ) diminuent volontairement leur alimentation, sans donner de raisons valables. Le refus de se nourrir est bien ancré ; elles abusent des laxatifs, ou rejettent les aliments en vomissant en cachette. Progressivement la sous-alimentation apparaît, avec amaigrissement considérable. Dans certains cas, la mort en est la conséquence( voulue, semble-t-il, par la malade ). Il semble bien que cette maladie soit liée à une réaction affective. On la constate parfois chez les nourrissons ( à l'occasion du sevrage, d'un changement de nourrice ). On la dépiste aussi chez certaines femmes mariées, à la suite de conflits conjugaux. La femme se réfugie alors dans la maladie ( ou se venge par la maladie ) en refusant se s'alimenter ou en refusant les aliments qu'elle a absorbés. Chez certains enfants ( vers quatre ou cinq ans ) le refus de se nourrir suit la naissance d'un petit frère ou d'une petite soeur. Il y a donc ici une peur d'être frustré ; l'enfant déclenche une maladie pour garder l'attention de ses parents.
Chez les jeunes filles ? Dans certains cas, on constate un violent sentiment de honte naissant avec la puberté. Des scrupules religieux ou sexuels s'installent. Avec, comme conséquence, la recherche d'une auto-punition sous forme de châtiment corporel.
Dans d'autres cas, la puberté de l'adolescente peut servir d'interrupteur, déclenchant des situations qui existaient à l'état latent ( comme le fait également la ménopause, vue plus haut ).
Parfois également, cette anorexie représente un " chantage " destiné à conserver l'amour intégral des parents. C'est un cas d'infantilisme. Ou bien ce refus d'aliments ( et la maladie qui en dérive ) peut concrétiser une vengeance contre les parents.
En plus d'un examen médical sévère, le milieu familial sera examiné en premier lieu, et à fond. De terribles drames affectifs y sont parfois découverts. Dans ce cas, l'isolement sera prescrit, et un traitement psychologique immédiatement entrepris.
Pour conclure, la mélancolie ralentit l'activité physique et mentale. Elle pousse à l'inaction complète ( comme dans l'aboulie ). Le mutisme est fréquent. Le malade demeure prostré, le regard vague, ruminant son désespoir.
Dans les cas les plus graves, un suicide est à redouter, ou le refus pur et simple des aliments.
Nous avons placé la mélancolie parmi les symptômes de la dépression par épuisement. Mais de nombreuses autres manifestations engendrant la dépression sont possibles. Comme par exemple des manifestations neurovégétatives, ovariennes, thyroïdiennes, etc .
La cause de la dépression est alors purement physique ; les répercussions mentales apparaissent ensuite.
Et si la mélancolie est un effet de la dépression, les conclusions sont les mêmes que celles de l'aboulie ; et c'est alors la dépression elle-même qui doit être traitée, c'est à dire les causes.
La peur de devenir fou
On la rencontre souvent chez les déprimés. Cette peur est parfois une véritable obsession. Une obsession lancinante, féroce, impitoyable. Même prononcer les mots " fou ", " folie ", " asile ", est pour ces déprimés un effort et une chose insurmontable. Il n'ose lire aucun article se rapportant à l'aliénation mentale ; il n'ose voir aucun film la représentant.
On sait que le déprimé ressent un " vide " du cerveau ; qu'il est incapable de " ramasser ses idées ". Ses pensées sont souvent brumeuses. Il est donc logique qu'il ait l'obsession de la fatigue cérébrale, et qu'il croie que cette fatigue le conduirait, le conduit, à la folie.
Que disent beaucoup de déprimés ?
"... ce creux dans ma tête, surtout le matin, avec toutes mes idées qui partent, me donne la certitude que je deviendrai fou ... " ;
"... ma fatigue, le froid de mon cerveau, mes maux de tête m'angoissent au-delà de toute expression ; comment voulez-vous que je garde ma raison, avec ces angoisses perpétuelles ? " ;
"... pour ma dépression, le médecin m'a conseillé un traitement psychiatrique. C'est bien la preuve que je suis à moitié fou ... "
Avant tout, sachons que ces craintes ne correspondent jamais à une réalité possible. Chez le déprimé, la peur de la folie est tout à fait absurde. Mais n'oublions pas que, chez eux, le moindre mot est capté et amplifié. Ils sont très réceptifs à une suggestion ... à condition qu'elle soit maléfique ! Dites à un déprimé qu'il risque la folie ; il vous croira immédiatement ! Dites lui qu'il n'a pas la plus petite chance de devenir fou, il ne vous croira pas ! Le déprimé est fortement aidé, en cela, par ses préoccupations excessives au sujet de sa santé ( hypocondrie ). Le déprimé est obsédé par le fonctionnement de ses organes, de ses idées, de ses pensées. Son épuisement le porte à s'observer sans cesse ; et la moindre déficience est interprétée dans un mauvais sens. Pourquoi ? Parce que la réaction spontanée fait défaut. Elle fait défaut tout simplement parce qu'elle est déficiente. L'idée morbide n'a aucun ennemi. Mais elle a un ami tout-puissant : la dépression elle-même. Et ainsi, cette idée morbide se cultive toute seule, comme un charbon en serre chaude. Elle se développe comme une tumeur morale. Elle est comme un microbe s'épanouissant dans un organisme sans défense.
Or, par quoi le déprimé est-il particulièrement hanté ? Par les impressions qu'il " ressent dans la tête ". Par ses " vides ", ses migraines, ses pertes de mémoire, son incapacité à se concentrer,son impossibilité de continuer une action entreprise. Par ses manies, qui exagèrent l'hésitation et le doute normaux. Par ses ruminations mentales, qui ne cessent pas.
De là à croire qu'il va basculer brusquement dans la folie, il n'y a qu'un pas ... Surtout que malgré cette hantise, ou cette certitude, jamais cette dépression ne risque de basculer dans la folie redoutée.
Les causes de la dépression
Dépression est donc un terme tout à fait général. Parmi les nombreux états dépressifs, existent des symptômes communs. Chaque cas sera donc un cas particulier, dont l'examen devra être fait avec une minutie d'horloger. On conçoit bien que des centaines de causes différentes puissent faire fléchir la tension nerveuse ! Cependant, l'une des causes principales reste l'épuisement nerveux et mental. Dans ce cas, rechercher la cause de la dépression revient à trouver les causes de cet épuisement. Quelles sont les causes de l'épuisement ? La Palice répondrait : " L'épuisement a pour cause des actions qui épuisent . " Et La Palice dirait vrai, comme toujours.On doit alors se demander : quelles sont les actions qui épuisent ? ET pourquoi épuisent-elles ? On songe donc, immédiatement, au surmenage.
Qu'est-ce que le surmenage ?
Ce mot me fait apparaître l'image d'un malheureux étudiant. Il est deux heures du matin. Dans la fumée bleue de multiples cigarettes, une tasse de café fort à portée de main, l'étudiant " bloque " devant son travail. Cela dure depuis un mois. L'étudiant est épuisé. Va-t-il automatiquement aboutir à la dépression ? Pourquoi tel étudiant y aboutira-t-il, et tel autre non ?
Supposons en effet, qu'à cette préparation d'examens,se mêlent des sentiments " moraux ". Supposons que, pour cet étudiant, les examens finaux représentent une dernière ressource. Qu'il travaille dans l'angoisse de ne pas réussir, que cette angoisse devienne de la peur. Peur de son père, par exemple ; peur de manquer toute sa carrière ; peur du mépris, etc. Il est certain qu'au surmenage de l'étude, s'ajoutent des éléments émotifs qui renforceront l'épuisement. On voit donc que la possibilité de surmenage varie selon les individus.
Il y a surmenage quand la dépense d'énergie dépasse les possibilités. Abuser d'un organe ( le cerveau, par exemple ), c'est diminuer sa puissance. Exactement comme avec une voiture. Se surmener c'est gaspiller un capital. La sensation de fatigue est le signal le plus précieux qui soit.Dépasser cette sensation, c'est risquer de tomber dans l'épuisement. Un épuisement encore récupérable, soit ! Mais un épuisement quand même. Si cet épuisement est prolongé, ou répété de multiples fois, on va en ligne droite vers la dépression.Il y a surmenage dès que les grands réparateurs naturels ( repas, sommeil ) sont insuffisants. Le surmenage dépend donc des forces disponibles, cela est évident.
Se surmener = dépenser plus que ses revenus. N'oublions pas, une fois de plus, que la fatigue est un signal destiné à empêcher l'intoxication des cellules nerveuses. Le surmenage doit donc être envisagé sous forme préventive. Chaque être humain doit connaître sa puissance propre. Et cela peut être assez difficile à savoir.
Il ne faut pas croire qu'une dépression se déclenche toujours immédiatement après l'action épuisante. C'est même un cas assez rare. Tout médecin, tout psychologue constatent fréquemment que la dépression suit de loin une série d'actions épuisantes, s'étageant parfois sur de nombreuses années.
Un cas courant avec épuisement direct
X ..., employé modèle, se voit brusquement nommé chef de bureau. Désirant être considéré dans son nouvel emploi, X ... travaille avec acharnement pendant deux mois. Il veille tard dans la nuit, dépasse sans cesse sa fatigue. Au bout de ces deux mois, il présente tous les phénomènes du " claquage ". X ... s'effondre, épuisé, avec les symptômes d'une dépression nerveuse. Surmenage mental ? Bien sûr ... Mais il travaillait tout autant dans son emploi précédent ! Alors ?
Tout d'abord, le premier emploi de X ... était formé d'une somme d'habitudes. Bien que son travail fut intensif, les adaptations à de nouvelles situations étaient rares. X ... travaillait dans une sorte d'automatisme qui lui évitait toute fatigue mentale.
Au contraire, dans son nouvel emploi, X ... doit s'adapter rapidement à de nouvelles responsabilités, qui se présentent sans cesse, et qui demandent une forte somme de travail mental. Conséquence ? Épuisement et dépression .
On croit avoir tout dit ... et cependant il n'en est rien.
X ... fut élevé dans une famille aisée. Il fut sans cesse " sur-protégé " et " couvé " par des parents qui l' " adoraient ". Tout était fait, pensé et décidé à sa place. X ... déboucha dans la vie avec une difficulté de vouloir ( aboulie) ... et de multiples complexes psychologiques, ( que nous envisagerons plus loin ) ... L'emploi de chef de bureau lui est présenté. Il l'accepte, il se surmène ; c'est entendu. Mais, avant de commencer, X ...avait déjà sombré, ( sans le savoir ), dans l'angoisse, le doute, le scrupule et l'échec. Il y a eu surmenage intellectuel, oui ! Mais il y a eu, surtout, surmenage émotif. Toute action comportant une responsabilité était sous-tendue par ses complexes psychologiques, qui, automatiquement, empêchait l'adaptation immédiate et la liquidation de l'action. L'action ( qui pour un être normal aurait été terminée ), continuait à tourner dans le mental de X ..., déclenchant scrupules, doutes, angoisses, manies, insomnies. Mais, en même temps, d'autres responsabilités se présentaient à lui ! Amenant, elles aussi, tout un cortège psychologique épuisant. Et ainsi de suite ...
On ne peut même pas dire ici que X ... se soit surmené. Mais plutôt que sa nouvelle situation fut l'interrupteur, le commutateur. Ses complexes profonds rendirent terriblement difficiles des actions de responsabilité qui auraient été envisagées et entreprises normalement par un autre. Il y a eu, ici, dépression à base psychologique éducative.
Un autre cas :
Y ..., jeune médecin sombre dans la " dépression nerveuse " au bout de six mois. Diagnostic : surmenage d'études et de travail médical. Bien sûr, bien sûr ... Mais si nous savions que toute ordonnance magistrale déclenchait chez Y ... une série de scrupules et de doutes, nous comprendrons déja mieux. Si nous savions que Y ..., après une ordonnance délicate, consultait ses livres pendant des heures, et attendait avec angoisse le résultat de son ordonnance ( imaginant toujours le pire ), nous comprendrons mieux.
Quelle est donc ici, la cause de la dépression ? Le travail ? Non. Les études ? Non. Les ordonnances ? Non plus. Les scrupules ? Les angoisses ? A moitié. Car il fallait connaître le pourquoi des srupules angoissés. Il fallait savoir pourquoi l'action " écrire une ordonnance ", continuait à tourner, angoissante, dans le cerveau de Y ...
Il serait trop long de faire une analyse détaillée du cas de Y ... Mais cela montre une chose : toute dépression doit être examinée sous toutes ses coutures. Les causes en remontent souvent loin ; mais ce sont ces causes qu'il faut trouver.
Le surmenage physique n'entre pratiquement jamais seul en ligne de compte. Le plus souvent, il s'accompagne de surmenage mental ( l'étudiant, par exemple ). Nous verrons d'ailleurs un peu plus loin, combien est dangereuse une concentration prolongée. Et combien il est indispensable de couper la concentration par des distractions. Il ne s'agit pas d'un " conseil " ; ceci est tout simplement une exigence pur et simple du cerveau.
Beaucoup plus dangereux sont les surmenages émotifs, les idées fixes, les obsessions, le cerveau qui tourne sur une même pensée, les ruminations mentales. On dira souvent : " Laissez de côté les sentiments tristes, les mélancolies, les idées noires. Réagissez à l'abattement, au découragement, à la prostration. " Je trouve cela très gentil, mais tous ces phénomènes sont déjà des effets d'un état déficient ! Ce n'est certes pas pour son plaisir qu'une personne rumine des idées noires ou des obsessions.
Il faut donc, en premier lieu, trouver le réservoir dans lequel se sont formées ces idées. C'est la tâche de la psychologie. Mais il faut le faire : car ces idées morbides deviennent à leur tour des causes, grossissant de plus en plus, et poussant la personne vers l'épuisement nerveux. Ces idées obsédantes risquent alors de devenir des idées fixes, canalisant à leur profit toute l'énergie du sujet.
Les actions épuisantes
Il est toujours un peu vain de " cataloguer " les comportements humains. Mais une chose est certaine : tout effort humain se fait en vue de l'adaptation à une situation, quelle qu'elle soit. Qu'il s'agisse d'ouvrir une porte ou de se marier !
Il existe donc une hiérarchie dans les difficultés d'adaptation. Et par conséquent dans la quantité d'énergie dépensée.
Le sujet ne ressent pas toujours ses actions épuisantes. Beaucoup d'entre elles demeurent subconscientes. ( Nous verrons cela au chapitre " Psychanalyse " ) Mais subconscientes ou non, elles n'en font pas moins leur travail de destruction. Nous pouvons dire que le milieu familial est une des sources les plus fécondes d'épuisement et de dépression ( lesquels se déclenchant alors souvent à retardement ). Le très grave problème de l'éducation est ici en jeu.Certains adolescents portent en eux un nombre inouï d'adaptations intérieures manquées ; chacune de ces inadaptations portant une charge émotive. De plus, la vie en famille est un problème d'adaptation réciproque continuelle. Divers caractères sont en présence ; ils exigent une adaptation souple et compréhensive. D'inévitables heurts se produisent. Tout est bien lorsque ces heurts se " liquident " immédiatement : soit par l'équilibre de la personne, soit par une explication, soit par une colère. Tout est donc bien si la " décharge " se fait. Mais bien souvent cette décharge n'a pas lieu ; c'est ce qui arrive fréquemment chez les enfants vis-à-vis de leurs parents. La décharge ( colère, reproche ), n'a pas lieu, parce que le code moral, qui régit les devoirs des enfants, l'interdit. C'est alors la rumination mentale, chargée d'émotions, qui peut devenir un gros noyau de fatigue. ( Nous verrons d'ailleurs cela, dans ' Les personnes fatigantes " ) Qu'on songe alors au nombre d'années pendant lesquelles des inadaptations peuvent se prolonger et se nourrir ...
On peut constater aussi que la religion mal comprise, elle aussi, est fréquemment un terrain d'épuisement et de dépression. Tout dépend de l'éducateur religieux, et des prédispositions du sujet. De nombreux adolescents portent en eux la peur et l'angoisse religieuses. De la terreur, même.
Fréquemment, de fausses notions d'un Dieu cruel, vengeur et impitoyable, se mélangent à la sexualité troublée des adolescents ...On pourrait en dire des ravages produits par la masturbation. Non par la masturbation elle-même, mais par les émotions et les remords qu'elle produit, face à une éducation religieuse mal comprise, et ravalée au rang d'un impitoyable code moral.
La puberté physique
Je cite Janet : Chez beaucoup de sujets, les première manifestations se présentent entre douze et quatorze ans, à l'époque de la puberté physique qui a déjà affaibli considérablement leur force de résistance. C'est en même temps l'époque où l'attention des enfants est attirée sur les exercices religieux de la première communion. C'est à ce moment que commencent les manies de répéter les prières, les manies de perfection, les terreurs de l'enfer et ( chez les plus précoces ) les obsessions sacrilèges. Ces troubles peuvent restés limités aux actes religieux et persister indéfiniment.
Donc, toute adaptation importante peut être une action épuisante ... de même que toute action banale. Mme X. a une crise de dépression chaque fois qu'elle rentre de voyage. Action banale. La préparation d'un petit voyage dure déjà quinze jours ; avec hésitations, doutes, lenteurs, impossibilité de faire une valise sans la défaire immédiatement " parce qu'on peut toujours oublier quelque chose " ; en voyage se produit l'anxiété ; elle craint de tomber malade loin de chez elle, elle craint de perdre son argent, elle craint que sa maison ne brûle, elle craint l'accident. Elle me dit : " ... pendant les trajets en chemin de fer, je suis toujours dans l'attente angoissée d'un choc catastrophique ; le sifflet de la locomotive me fait pâlir ; je ne peux pas m'empêcher de demander à mes voisins de voyage la vitesse où le train roule ... " Elle met des heures à choisir un hôtel, à faire ses compte, à hésiter, à ruminer, de plus en plus épuisée.
Et Mme X. revient de voyage avec un " claquage " complet, bonne à se mettre au lit. C'est alors l'aboulie, la mélancolie et la rumination mentale de ses insuffisances.
Un simple voyage est donc pour elle un important surmenage. Parce qu'elle n'est pas capable de s'adapter aux nombreuse circonstances exigées par ce voyage. La psychologie devra donc, dans ce cas, rechercher les causes premières ayant produit cette déficience.
Le cas de Jacqueline D.
Jacqueline est une ravissante jeune fille de vingt-trois ans. Elle est victime, depuis l'enfance, d'une très forte déviation de la colonne vertébrale. Elle présente tous les symptômes de la dépression nerveuse. De plus, la vue de tout représentant de l'autorité ( prêtre, agent de police, gendarme, et même employé derrière un guichet ), fait apparaître des tremblements nerveux ou des sensations d'évanouissement, qui la font s'enfuir. Elle n'ose pas regarder en face ; elle passe pour hypocrite. Elle est tendue, agressive, et d'une culture fantastique dont elle se vante sans cesse. Il ne fallait pas être grand clerc pour en deviner la raison :
_ Mais votre culture est fantastique, mademoiselle ... Pourquoi ?
_ ( agressive ) ... Eh bien ... devinez, monsieur !
_ C'est fait.
_ Ah ?
_ Ce que vous appelez votre infirmité vous a donné, dès la petite enfance, un terrible sentiment d'infériorité, n'est-ce pas ?
_ Oui, monsieur. ( Agressive ) Maintenant, continuez mon histoire !
_ (doucement) : ... bon ... je vais donc repasser mon bachot ...
_ (soudain humble) : Oh ... ne croyez pas cela, monsieur, je vous en prie ! Mais j'ai tellement ruminé ma vie ... et j'ai tellement souffert !
_ Bien sûr. Nous en étions donc au sentiment d'infériorité, n'est-ce pas ?
_ Oui, monsieur.
_ Vous avez énormément souffert de sentiments de frustration, d'humiliation ; d'être rejeté de tout et par tous, n'est-ce pas ? Vous vous révoltiez contre votre sort, et cela de jour comme de nuit ...
_ Oui, monsieur ; à m'en tuer, parfois .
_ Mais ... ce sentiment d'infériorité vous a fait perdre toute sécurité. Vous vous sentiez affreusement solitaire. Il fallait donc à tout prix que vous la retrouviez, cette sécurité ... Où ? Chez vos parents ?
_ Oh non ! Mes parents, au fond, me détestaient. J'ai entendu ( j'avais dix ans) mes parents se disputer. Mon père parlait de moi en disant " Ta fille ..." J'étais un objet d'occasion dont on cherche le propriétaire ... Et puis j'ai entendu ma mère : " J'ai honte de sortir avec elle. J'ai honte de voir l'apitoiement des gens. Si au moins elle était un génie, einh ? ça ferait balance ! "
_ Et c'est à ce moment-là que tout a commencé.
_ Oui, monsieur.
_ Alors, Jacqueline, vous avez serré les mâchoires. Vous n'avez pas dit un mot de tout cela à vos parents. Et vous avez commencé à étudier à fond, toute seule, en cachette et avec rage. Vous deviez devenir un monstre sacré de la connaissance intellectuelle. Et aussi, dîtes-moi ? ... comme vous n'étiez pas forte physiquement, vous désiriez vous venger de vos parents par votre épuisement ?
_ Oui ... en y songeant maintenant ... j'avais cette idée en moi... Mais je l'ai sans cesse rejetée ... je me disais souvent : " si je meurs, on l'aura voulu ... " Monsieur, c'est encore plus compliqué que je ne le croyais ! ...
_ Mais non, mais non, Jacqueline, vous allez voir ...
_ Merci, monsieur.
_Allons-y. On descend dans la cave. Vous me suivez ?
_ (sourire) Passionnément.
_ Vous vous êtes donc mise au travail, en cachette, le soir, le matin, sans cesse. Chaque chose apprise à fond devenait votre supériorité. Comme un judoka, vous vous sentiez de plus en plus capable de " caler " n'importe qui ...et de le rendre ridicule. Chacun son tour, vous disiez-vous à vous-même ... C'était votre arme secrète.
_ Oui, monsieur. Mais j'ai été épuisé en deux ans.
_ Eh bien ... vous avez mis le temps ! A ce régime ... Vous avez donc repoussé la fatigue pour deux raisons :
1) vous vouliez à tout prix être une grande intellectuelle ;
2) vous désiriez inconsciemment, pour punir vos parents, vous faire mourir de fatigue. D'accord ?
_ D'accord, monsieur. Dites ... c'est toujours aussi compliqué, votre profession ?
_ Souvent beaucoup plus, Jacqueline ! Continuons. Donc, vous avaliez la connaissance à la louche. Vous étiez épuisée. Le tout dans un silence complet. Puis vous avez lâché vos connaissances comme des bombes. Je suppose que vous avez posé des " colles " à vos professeurs, et que vous avez raflé absolument tous les prix ...
_ (sourire ; elle baisse la tête ) ... Sauf le prix de gymnastique ...
_ Cela viendra, Jacqueline. Et vos professeurs, vos amies, vos parents, vous ont contemplée avec stupéfaction. Du coup, on n'a plus parlé de votre infirmité, pas vrai ?
_ Oh non ! ...
_ Mais je suppose que vous n'avez rien dit encore ... vous avez pris un air désinvolte, comme si c'était tout naturel et sans effort ? Votre vraie supériorité était à ce prix ?
_ Oui, monsieur, et j'ai continué ainsi très longtemps ...
_ Et personne ne vous a prise à part ? Personne n'a trouvé cela ... anormal ? ...
_ Oh non ! Ils étaient bien trop fiers pour m'arrêter ! Pensez ! Je devenais une encyclopédie ! La gloire de mes parents et de l'établissement !
_ Hum ! ... C'est du joli ...
_ Oui, monsieur.
_ Ensuite, dans votre épuisement, la puberté est venue.
_ Oui. Et des amies m'ont mise au courant.
_ Au courant de quoi ?
_ Mais ... de tout.
_ Alors ?
_ Alors, monsieur, beaucoup de choses ont commencé ... J'entrais dans un nouveau domaine. Pendant toute mon enfance, j'avais été repoussée par tout le monde. pensez ! Une demie-bossue ! J'avais souvent des haines intérieures épouvantables. J'aurais tout cassé ... ma tête en tournait, et je devais m'asseoir ... Puis je suis devenue très " calée" ; ( un cri de révolte )mais je restais tout de même une bossue, une Sale bossue ! Et je devenais une jeune fille, fréquentant les garçons ! Tous m'ont repoussée aussi .. sauf deux ou trois, qui me protégeaient ... Et je ressentais leur protection comme une insulte supplémentaire. j'étais très désagréable avec eux, parce qu'ils ne songeaient jamais à ...
_ Ils ne songeaient pas à votre rôle de femme. D'autant plus que, je suppose, vous leur lanciez vos connaissances comme des sceaux d'eau glacée ?
_ Je voulais abattre leur supériorité de mâles.
_ Et ça n'a pas duré.
_ Non, monsieur. Ils m'ont abandonnée , et je me suis retrouvée seule.
_ Quand avez-vous commencé la masturbation ?
_ ( Jacqueline rougit violemment. Elle crispe les mains ; se lève à moitié. Mais son "intellectualisme" se doit de considérer froidement le problème sexuel. Elle se rassied, et continue ) ... Vers quinze ans.
_ Remords ?
_ Pas tout de suite. Plutôt de la haine. Je me vengeais toute seule, parce que je m'épuisais davantage. Mais j'étais dans une école catholique ; un jour, un prédicateur étranger a fait un sermon. Il a parlé de la chair. J'avais quinze ans, vous savez ... Je l'entends encore tonner. Tout cela semblait sans pitié ... Et jamais je n'ai osé avouer ce que je faisais. Ceci aurait été des confessions et des communions sacrilèges.
_ Votre confesseur aurait pourtant compris, Jacqueline !
_ Oui, monsieur. Mais j'avais quinze ans ... Et après chaque communion sacrilège, j'avais l'impression ( c'était atroce ) que tout allait m'anéantir. Je croyais être foudroyée à chaque pas. Je me sentais pourrir à l'intérieur. C'était tellement fort que je croyais porter sur moi une odeur nauséabonde, et alors je m'inondais de parfum pour qu'on ne s'en aperçoive pas ... La vue d'un prêtre me faisait trembler ... Je croyais avoir les plus sales maladies possibles, je consultais pendant des heures tous les ouvrages de médecine ...Dans la rue, il me semblait que (j'étais comme folle) les agents de police me suivaient du regard ... Cela a duré cinq ans ; cinq ans, monsieur ! Et je supportais cela toute seule, dans la vie courante, mes parents ne savaient rien, ne se doutaient de rien. J'avais souvent des évanouissements, des vertiges, des pertes de mémoires. Je n'ai jamais osé dire quoique ce soit à personne sauf aujourd'hui ... et c'est beaucoup moins difficile que je ne le croyais ... C'est alors, au bout de cinq ans,que j'ai rencontré un ami d'enfance qui avait quitté le pays à l'époque ... Il a été tellement gentil, tellement naturel, que ... j'en ai été bouleversée ...une gentillesse, vous comprenez ? ...Je ne lui ai pas parlé de tout ceci, mais de ma dépression ... il m'a forcée gentiment à venir vous voir ... et voilà ... me voici ... monsieur ; je ne sens plus mon corps, tellement je suis fatiguée... mais je me sens moins monstrueuse en ayant dit tout cela ... et surtout, je sens que vous ne me jugez pas ...
Jacqueline, maintenant, est mariée et heureuse. Conte de fée ? Pas du tout. Mais l'histoire de chaque jour humain. Trois sciences sont intervenues dans sa guérison :
La médecine en premier lieu, pour rétablir l'état général nerveux de Jacqueline. En même temps un traitement psychologique en profondeur extrayait les complexes, comme des dents cariées.Il s'agissait d'éliminer dix années d'angoisses, de refoulements, de haines, de crispations ... Il s'agissait de redresser une sexualité faussée. D'apprendre la détente, l'économie des forces. Ensuite, un médecin réussit à réduire la scoliose. Tout cela fut fait avec la collaboration enthousiaste de la jeune fille ; tout cela fut fait, et réussi ! Bonne vie, Jacqueline ! ...
L'épuisement et l'agitation
Nous avons dis donc, que l'épuisement provoque
a) la dépression
b) l'agitation
Dans l'agitation apparaissent deux grands symptômes :
a) les réactions aux circonstances sont désordonnées, et nettement exagérées ( réactions musculaires, torrents de paroles, etc)
b) l'agité donne l'impression d'être le jouet de ses impulsions, sans posséder le frein nécessaire pour que se fasse l'adaptation équilibrée
Le comportement de l'agité devient une série de décharges brusques, qu'il ne parvient pas à contrôler. La " maîtrise de soi" disparaît.
Disparaît également l'aisance harmonieuse que donne une vitalité normale. Les gestes sont rapides et saccadés ; la parole devient un torrent. Des tics apparaissent (tics de gestes, tics de langage) ; des mimiques brusquées, des spasmes avec douleurs, des crampes etc. Tout cela, selon le degré d'agitation évidemment.
Je signale ceci : ces réactions agitées sont très souvent confondues avec un "trop plein" d'énergie .. Or il s'agit exactement du contraire.
Attention ici ! On croit souvent que la "maîtrise de soi" consiste à serrer les mâchoires pour "se mater". Cela est totalement faux. Si se maîtriser demande un effort, c'est qu'il n'y a pas maîtrise de soi. La maîtrise de soi disparaît dès que l'effort apparaît. La vrai maîtrise est égale à l'aisance. Elle doit apparaître sous l'effet d'une énergie harmonieusement répartie.
Dans ce sens elle est comme la volonté : si l'individu doit faire appel à la volonté ou à la maîtrise de soi ... c'est qu'il en manque. Sinon, pourquoi devrait-il l'appeler ?
Sans entrer dans des détails purement neurologiques, il est nécessaire de connaître un très important mécanisme de la formidable horlogerie nerveuse. Car, nous allons voir que, de ce mécanisme, peuvent être tirées des conclusions qui englobent l'équilibre, la santé, la façon quotidienne de vivre ou l'éducation.
On croit généralement que, lorsque l'on pense à quelque chose, la totalité du cerveau travaille. Or, c'est faux. On croit que, si on se concentre sur un problème, tout le cerveau travaille intensément. C'est encore plus faux.
Dans la concentration, seule une petite partie du cerveau est en activité ; tout le restant est bloqué, et dort. Nous allons voir pourquoi. Nous connaissons tous l'homme qui se "concentre" sur une lecture ou sur une étude ; il n'entend rien en dehors d'elles. Les paroles, les radios, les conversations ne semblent même pas exister. On connaît aussi le cas du piéton "distrait" (c'est à dire concentré sur un problème) et qui ne verra pas une voiture le frôler à toute vitesse. Si nous allons plus loin, nous tombons dans le cas de l'idée fixe ;la personne ne remarque rien hormis son idée. Pourquoi ?
Un magnifique mécanisme
Dès que le système nerveux reçoit un "message", il déclenche automatiquement deux grandes réactions :
a) Il canalise le message vers les centres nerveux directement intéressés par ce message. C'est le phénomène de dynamogénie : (de dunamis = force et gennân = engendrer). Cette canalisation permet l'excitation des centres nerveux intéressés. A son tour, cette excitation nerveuse permet la puissance exigée par l'action du moment.
b) En même temps, le système nerveux bloque les centres nerveux qui n'ont rien à voir avec l'action du moment. Il provoque ainsi un arrêt de toutes les formes de comportement qui ne sont pas intéressés par l'action. C'est le phénomène d'inhibition : ( de inhibere = retenir ). Cette inhibition est donc un blocage, donc un sommeil. Les parties du
cerveau ne participant pas à l'action du moment dorment donc.
Exemple : supposons que nous assistions à une conférence.
a) le conférenciers est un point qui émet des messages ( visuels, auditifs, etc);
b) le système nerveux draine ces messages vers les centres nerveux intéressés ;
c) ces centres nerveux sont excités ; l'excitant arrive aux centres sous forme d'impulsions électriques. L'homme fait alors attention, ou se concentre ;
d) en même temps, les parties du cerveaux qui ne sont pas intéressés par les messages du moment, dorment. Le restant de l'écorce cérébrale cesse donc de fonctionner ( inhibition).
Retenons donc la règle suivante : l'excitation de certains centres nerveux est accompagnée automatiquement du blocage des autres. Dans le cerveau : plus la zone d'excitation est réduite, plus les zones bloquées sont étendues
Voyons un peu les conditions de lucidité maximum du cerveau ; et par conséquent, de blocage ( sommeil ) minimum.
La rêverie
Dans la rêverie, le cerveau n'est sollicité par aucun sujet particulier. C'est un état d'abandon ; le sujet est spectateur des sensations qui se déroulent dans son cerveau. Le rêveur n'a son attention attirée par aucun poin précis. Les " messages" sont donc très nombreux. Donc, le cerveau est ouvert, éveillé au maximum ; le blocage est minimum. La rêverie est parfois un refuge pour les faibles ; cependant il existe une forme supérieure de rêverie, c'est :
La méditation
La méditation est nerveusement semblable à la rêverie. On confond souvent "méditation" et " concentration". Or, rien n'est plus faux. La véritable méditation ne consiste pas à penser ( avec effort) à quelque chose de précis. Au contraire, la méditation laisse "flotter" le cerveau autour d'un thème général. L'homme en méditation est passif ; son cerveau reçoit le maximum de sensations. C'est donc une rêverie " en profondeur". Étant donné le " flottement" du cerveau et le nombre de centres nerveux en action, les idées se déroulent facilement. L'esprit se recueille en une sorte de " fermentation" généralisée, et sans le moindre effort. L'esprit s'étend avec aisance à toutes choses. La réceptivité et la lucidité sont magnifiques.
La méditation est probablement le degré le plus élevé de la pensée humaine. Pensée lucide, très élargie, très étendue, pleine d'aisance. La réceptivité est au maximum ; tandis que le blocage est minime.
L'attention
Faire attention signifie : faire attention à quelque chose. Ici, l'esprit se fixe déjà sur quelque chose, sur un ou des points précis. (Une conférence, par exemple.) L'attention est une sorte de concentration faible. Puisque l'attention se dirige vers un point précis, les messages sont canalisés vers certains centres nerveux. Le blocage des autres se fait donc immédiatement.IL existe évidemment divers degrés d'attention ; ils vont de l'attention dispersée ( écolier distrait) à l'attention fixe ( conférence écoutée avec intérêt). Si nous allons plus loin, nous tombons dans la concentration.
La concentration
La concentration consiste à fixer sa pensée avec effort sur un point unique. ( Un problème difficile par exemple). La zone du cerveau en activité est alors très réduite ; ce qui est normal, puisque l'attention est fixée en un seul point ( donc un seul message). Par conséquent, les zones bloquées sont très étendues. C'est au cours d'une forte concentration que la plus grande partie du cerveau dort. Cela nous explique pourquoi l'homme qui se concentre ne remarque rien autour de lui.Il ne remarque rien parce que les zones bloquées de son cerveau sont incapables de recevoir d'autres messages, ( bruits, radio, paroles). Si nous poussons la concentration jusqu'à la pathologie, nous arrivons à l'idée fixe.
L'idée fixe
L'idée fixe ( de même que l'obsession, les ruminations mentales etc ) sont des concentrations involontaires et maladives. Elles restent perpétuellement fixées sur le même sujet. D'où une très forte excitation de quelques centres du cerveau, qui travaillent jusqu'à l'épuisement.L'idée fixe représente un seul message, toujours le même :donc, une très petite partie du cerveau est en activité exagérée ; tout le restant dort. On sait d'ailleurs que le sujet atteint d'idées fixes est incapable de remarquer quoique ce soit en dehors d'elles. Nous en reparlerons.
à suivre ...