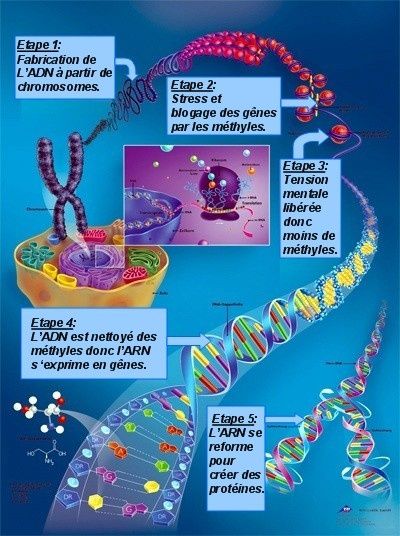Dossier complet de Marina Papageorgiou, Psychanalyste et Psychosomaticienne.

Quand Perséphone fut enlevée par Hadès, oncle amoureux et maître des enfers, Déméter, sa mère, entra dans une errance mélancolique et épuisante à la recherche de sa fille. La rencontre avec Iambé, vieille femme exhibant son sexe – laissant apparaître selon une variante du mythe une tête de garçon naissant –, fit rire la déesse et mit fin à sa douleur. Déméter reprit même une activité sexuelle et procréatrice, mais elle n’accepta de regagner sa place parmi les dieux qu’après avoir retrouvé sa fille, sous peine que la terre ne devînt stérile. Perséphone fut autorisée à alterner son séjour dans la demeure souterraine d’Hadès avec un séjour sur la Terre-Mère, qui retrouva ainsi la fertilité. Cette alternance qui signifie la rythmicité des saisons pourrait évoquer le double enracinement de la sexualité et de l’identité féminines, en « bascule » selon l’expression de Florence Guignard entre le maternel et le féminin.
Ce mythe m’est venu à l’esprit pour illustrer ma rencontre avec des patientes souffrant d’une « nouvelle » maladie, essentiellement féminine, la fibromyalgie. Mes réflexions sont inspirées de cures analytiques ainsi que d’investigations et de suivis psychothérapiques dans un centre de traitement de douleur chronique.
La fibromyalgie primitive ou (Syndrome Polyalgique Idiopathique Diffus), autrefois appelée polyentésopathie ou fibrosite, est un syndrome douloureux de l’appareil locomoteur d’étiopathogénie inconnue où la fatigue est intriquée aux douleurs diffuses.
À la différence de la fatigue chronique associée à des maladies systémiques et distincte des syndromes myofaciaux où les douleurs, d’origine organique, restent localisées et répondent aux traitements, le diagnostic de la fibromyalgie est clinique, en absence de toute lésion organique ou altération biologique. Deux critères de diagnostic sont retenus : d’abord la persistance de douleurs diffuses depuis au moins trois mois, puis un score d’au moins onze points du corps douloureux à la palpation sur les dix-huit répertoriés (tender points) et qui correspondent à des insertions tendineuses ou à des zones de transition musculo-tendineuses. La fréquence et l’intensité des douleurs peuvent varier, augmenter à l’effort, au froid et au « stress », diminuer à la chaleur et au repos, mais la fatigue, voire l’épuisement, est toujours présente.
Associée à des facteurs organiques rhumatismaux, endocriniens, etc. la fibromyalgie dite secondaire est mieux acceptée aussi bien par les patients que par les médecins.
UNE MALADIE ÉPUISANTE À SOIGNER
En absence de causalité organique tangible, la symptomatologie fibromyalgique reste énigmatique et embarrassante pour le corps médical. Elle suscite des réserves et des controverses nosographiques, de nombreux médecins et psychiatres y voient des manifestations hystériques. Aux douleurs et à la fatigue s’ajoutent d’autres symptômes fonctionnels et végétatifs, souvent accumulés, affectant tous les systèmes : musculosquelettique (lombalgies, spasmes, dysfonctionnement temporomandibulaire, canal carpien), digestif (reflux gastro-œsophagien, dysphagies, bouche sèche, colopathies), cardiovasculaire (palpitations et extrasystoles), respiratoire (toux, dyspnées, allergies), génitourinaire (dysménorrhées, incontinence), endocrinien (hypoglycémie, peau sèche, hyperhydrose, perte des cheveux), nerveux (céphalées, migraines, vision double, acouphènes, troubles de l’équilibre et étourdissements, dysesthésies (brûlures, gonflements, inflammations, picotements, tendance à échapper les objets, hypersensibilité aux bruits et aux odeurs). Enfin, irritabilité, anxiété et angoisses diffuses, troubles de concentration et de mémoire s’ajoutant aux insomnies conduisent le plus souvent à une incapacité de travailler, voire à une mise en invalidité. Cette clinique donne aux médecins une impression de « tout et n’importe quoi », « psychogène », ou « psychosomatique », coûteux et difficile, voire épuisant à soigner.
Les thérapeutiques médicamenteuses (anxiolytiques et antidépresseurs) n’apportent pas d’amélioration. La prescription d’exercices physiques (!) est vécue de manière ambivalente, et les techniques psychologiques les plus utilisées sont d’inspiration comportementaliste, dites de « gestion de stress et de douleur ». L’évolution de la maladie est variable : les crises peuvent se stabiliser ou diminuer et plus rarement disparaître, le critère médical prévalent étant la qualité de vie plutôt que l’amélioration des symptômes. Les malades se sentent mieux quand les douleurs diminuent, en revanche la fatigue persiste, probablement parce qu’elle est moins quantifiable. Malgré la vigilance suscitée par l’abondance des somatisations chez les fibromyalgiques, en général, on n’observe pas de maladies graves.
La fibromyalgie est ainsi considérée comme une entité nosographique distincte des autres atteintes organiques, résultant d’un dysfonctionnement des systèmes de contrôle inhibiteur de la douleur, selon la seule hypothèse éthiopathogénique valable. De nombreuses études ont montré que chez les femmes fibromyalgiques le seuil de douleur est diminué et que la sensibilisation périphérique impliquant non seulement les muscles mais également les tendons, les ligaments et la peau est amplifiée et généralisée par un dysfonctionnement central. Toutefois, des altérations dans les mécanismes nociceptifs peuvent être observées chez d’autres malades douloureux mais non fibromyalgiques. Certains chercheurs ont relevé une difficulté épistémologique dans la nosographie, à savoir l’intrication entre douleur et fatigue, dont l’un peut provoquer l’autre tout en en étant le résultat. Le lien entre les deux serait en rapport avec les troubles du sommeil mis en évidence chez ces patients, et qui pourrait être dû à une micro-ischémie qui entrave le repos musculaire pendant la nuit.
CORPS DOULOUREUX, CORPS VIDÉ
L’investigation des patientes fibromyalgiques fait ressortir deux caractéristiques particulières. Premièrement, les douleurs surviennent à la suite d’un événement traumatique qui marque un changement dans la vie du sujet et le sollicite à un remaniement économique majeur. Le plus souvent il s’agit d’un deuil, notamment un deuil maternel, une rupture affective, ou un échec professionnel. Le début des crises se situe en général après la quarantaine, ce qui peut signifier un cap de remaniement libidinal et identificatoire, accentué par les modifications biologiques évidentes chez les femmes et plus rarement à l’adolescence.
D’abord localisées, les douleurs se diffusent progressivement et le corps est décrit douloureux ou anesthésié, éteint, « hors service », et incapable de répondre à des sollicitations externes perçues comme demandant trop d’énergie et le vidant de ses forces. Le sujet ne sait pas s’il a mal parce qu’il est fatigué ou si la fatigue accrue devient douleur. L’épuisement est décrit comme un état où on ne peut plus lutter, on n’y peut rien.
La deuxième remarque est le fait qu’il s’agit toujours de femmes hyperactives, qui privilégient les défenses de comportement et notamment le recours à la motricité. Cette hypertonicité s’exerce dans leur vie professionnelle, très investie et contraignante mettant en jeu les exigences d’un moi idéal féroce et insatisfait. En dehors du travail, les tâches ménagères qui sont décrites comme un « cauchemar », ou « une épreuve de nullité », et les occupations impliquant les soins donnés aux petits-enfants, très investies sont par la suite évitées ou empêchées, car épuisantes. Ces femmes semblent se consumer dans leur travail, se confrontant à une injonction interne selon laquelle il faut faire toujours plus et mieux pour ne pas risquer de tout perdre. Elles décrivent une constante obligation de résultats en quête d’une valorisation et d’une ré-assurance narcissique menacée en permanence. Cette hyperactivité ne semble pas obéir à une logique de compétition ou de rivalité, soutenue par une activité fantasmatique et une conflictualité interne, par exemple de nature œdipienne, mais elle correspond à la nécessité de mobiliser une surcharge énergétique pour lutter contre des tensions externes ou internes trop menaçantes pour le psychisme. Cette hypertonie, qui affecte également les voies mentales, finit par épuiser le sujet enfermé dans le piège de ses mécanismes de défense, où l’apaisement est recherché dans l’action et l’excitation à l’instar des procédés autocalmants, décrits par les psycho-somaticiens (M. Fain, C. Smadja, G. Szwec) et qui rendent mieux compte de la nature du « stress » lié au travail. Il est intéressant de s’interroger sur la facilité avec laquelle ces mêmes activités peuvent être désinvesties, lors des arrêts maladie prolongés où la mise en invalidité est ressentie comme un soulagement. « Je pourrais enfin me reposer, et dormir », disait une patiente souffrant d’insomnies et de douleurs matinales.
La faculté de « lâcher » pourrait connoter une faible valeur sublimatoire des activités professionnelles ainsi que la labilité de l’investissement. Investies comme des occupations pour éviter de penser, elles ne sont pas ressenties comme un espace de créativité, de plaisir et d’enrichissement personnel. Au lieu de gagner en indépendance, le sujet s’use dans une quête permanente d’amour et de reconnaissance adressée à un objet maternel cruel ou indisponible, mais qu’il doit en même temps garder à l’abri de toute projection de motions destructrices internes. Ceci explique le contrôle exercé sur les voies motrices et les voies fantasmatiques et qui ne permet pas non plus l’épanouissement des pulsions épistémophiliques et le plaisir de penser.
LOURDEUR ET APESANTEUR
Les patientes fibromyalgiques décrivent des sensations de douleur, de brûlures ou de froid, d’écorché vif, qui alternent avec des sensations de lourdeur, de raideur ou de mollesse, d’épuisement, de perte de consistance ou de force musculaire, des troubles d’orientation ou de contenance dans l’espace, ou encore la sensation de trop sentir, comme avoir mal « aux attaches des tendons » où « même sourire devient fatigant ». Les sensations semblent opérer à la place des émotions et des affects qui ne sont pas absents mais déqualifiés. Hormis des crises de larmes, ces patientes se montrent rarement joyeuses ou tristes, agressives ou en colère, n’ont pas d’expressions enthousiastes ni d’élans passionnels. Leur vie sexuelle est à peine mentionnée, ou alors pour décrire de manière lapidaire une vie conjugale « comme tout le monde », « sans rien de particulier », en soulignant le caractère obligatoire ou contraignant de la sexualité. Parfois, elles relatent des expériences blessantes au plan physique ou affectif, et le plus souvent elles décrivent une sexualité « incomplète », soit par absence de plaisir soit par manque de tendresse.
Le caractère diffus de ces éprouvés donne au clinicien le sentiment d’être en présence d’un corps insaisissable, sans forme, sans contour. En face d’une patiente qui égrenait tout ce qu’elle ne pouvait plus faire dans la journée une image s’est imposée à moi, celle d’une silhouette de sable qui s’effritait dès qu’on essayait de la saisir.
L’ENFANT THÉRAPEUTE
L’expérience clinique montre que le surinvestissement d’un corps douloureux fait écho à une relation avec l’objet primaire, de nature traumatique, un objet interne menaçant et excitant en permanence, qui n’est ni assurément présent, mais dont il est impossible d’assumer l’absence. Que la mère ait été réellement absente, psychiquement indisponible, chaotique, imprévisible, érotisée ou intrusive, elle incite chez l’enfant une hyperex-citabilité motrice et sensorielle qui vise à la fois à récupérer l’intérêt maternel et à atténuer une proximité menaçante de faire exploser le sentiment de continuité de soi. Ainsi, à l’instar de la plaie corporelle qui, en tant que zone de condensation narcissique dans la description freudienne, protège de la névrose traumatique, la douleur physique garde toujours une valeur de défense contre le risque d’effondrement psychique.
Une configuration particulière est au centre de l’histoire des femmes fibromyalgiques. Pendant leur enfance, elles ont occupé une fonction d’enfant thérapeute auprès de leur mère, ce qui a provoqué une distorsion particulière des liens mère-fille. D’une manière ou d’une autre, elles ont été amenées à s’occuper d’une mère souffrante psychiquement, mais également atteinte physiquement, malade ou handicapée. Il s’agit d’une mère qui se trouve dans une dépendance physique mais décrite comme très indépendante de caractère, courageuse, insoumise, et hyperactive à l’extérieur et à l’intérieur du foyer, malgré des capacités sensori-motrices parfois limitées, très exigeante et perfectionniste. Ce qui domine dans le personnage maternel est un excès de présence physique agie qui lui confère l’illusion de passer outre à tout besoin ou désir, et malgré l’évidence déniée des manques corporels, d’échapper au manque, et bien sûr à la castration. Dans tous les cas, ces femmes s’étaient senties durant leur enfance moralement et physiquement responsables de l’intégrité psychique et physique de leur mère.
Le personnage paternel est investi comme un rempart, tantôt tendre ou idéalisé, courageux, tantôt érotisé, même violent, brutal, très pulsionnel, mais toujours peu capable d’endiguer les agissements de la mère.
Les rapports avec les maris sont un compromis entre les deux personnages parentaux. Les relations avec les enfants-filles sont plutôt conflictuelles, réactivant les exigences et les dangers émanant de la mère, tandis que les enfants-garçons sont décrits comme plus faciles à élever et à éduquer, voire à « tenir », mais aussi plus vulnérables et souvent en mauvaise santé.
Ces patientes se décrivent comme des enfants très sages, écolières sérieuses et appliquées, sans frivolité, matures et responsables, de vrais soutiens de famille, « comme des hommes ». Dans cette hypermaturité intellectuelle, et corporelle, il s’agit de contenir l’expansion motrice pour ne pas lâcher la surveillance du corps de la mère, tout en se conformant à son désir à elle de « tenir » l’enfant.
Pendant son analyse, une patiente éprouvait le besoin de me regarder bien avant de se lever du divan et se détacher de moi, alors que sa mère l’empêchait de se détendre avec insouciance et nonchalance à ses côtés en la sommant de ne pas bouger, pas remuer, pas respirer ! Au bout de quelques années, on a pu comprendre que la crispation douloureuse correspondait pour elle à un désir de se raidir de manière virile pour se défendre contre la déréliction physique et psychique de sa mère, "atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde". Le corps endolori correspondait à une identification masculine paternelle pour se défendre d’une promiscuité homosexuelle latente et maternelle. Toute circonstance l’éloignant fantasmatiquement du père provoquait des angoisses sous forme de sensations de perte de consistance et de jambes en coton. En revanche, le sentiment de fatigue et d’épuisement, l’empêchant de travailler mais aussi de penser et d’associer librement, correspondait à une identification hystérique à la mère molle et éreintée, chaque fois que celle-là refusait de partager un jeu ou une joie avec sa petite fille.
La rigueur d’une enfant thérapeute contraste souvent avec une ambiance familiale marquée d’excitation et de sensualité parentale, châtiments corporels, et parfois abus sexuels. J’ai toujours trouvé que la place de l’enfant thérapeute dans le roman familial est connotée d’un trouble de filiation, d’un changement de nom, d’une adoption, ou d’un changement de statut, d’une alliance transgressive ou d’un secret familial qui bouleverse l’ordre établi, en tout cas un événement significatif dans un registre symbolique, ou une rupture de transmission.
Le fait qu’il s’agit essentiellement de femmes n’est pas insignifiant dans le tissage de la relation thérapeutique et le jeu des projectionsidentifications qui va habiter l’espace de la relation thérapeutique, y compris avec les médecins. Elles suscitent chez les médecins hommes une attitude de rigueur et de réserve alors que les médecins femmes adoptent une attitude hyperactive, toute-puissante ou complice. Ainsi, l’orientation par les premiers vers une consultation de la douleur semble être motivée par le besoin de « tiercéiser » une relation thérapeutique épuisante et peu gratifiante, dont la part de subjectivité risque d’ébranler la rigueur du raisonnement clinique et de fausser les capacités d’empathie. En revanche, les mêmes difficultés et la persistance des plaintes suscitent chez les médecins femmes une envie d’en « faire trop » pour ces patientes, multipliant les explorations et les traitements et instaurant une proximité sous forme de relations mondaines ou de confidences « féminines ».
Autant d’attitudes de séduction maternelle exercées sur une fille et qui s’opèrent par l’intermédiaire d’un corps marqué tantôt par un excès d’excitation, « un corps qui ne dort jamais », tantôt marqué par l’épuisement de la lutte, en position de retrait ou de renoncement.
REGARD PSYCHOSOMATIQUE SUR LA FATIGUE ET LE LIEN PRIMAIRE MÈRE - FILLE
Pour Pierre Marty, il est des relations à l’objet qui sont fixées précocement à partir des investissements qui sont restés essentiellement ancrés dans la sphère sensori-motrice en raison des réponses de la mère et de sa capacité d’assurer l’intégration somatopsychique pulsionnelle de l’enfant et d’étayer l’acheminement fantasmatique des excitations. Dans un premier temps la mère ne peut « lâcher prise » sur le corps du bébé, faute d’une capacité de rêverie suffisante, et dans un deuxième temps son anxiété ou ses propres besoins d’étayage narcissique empêchent l’épanouissement de l’enfant, par exemple dans les jeux, freinant les décharges motrices et la mobilité fantasmatique. On peut rapprocher le sommeil non réparateur et l’hypervigilance musculaire des fibromyalgiques à la théorisation de Michel Fain sur la nécessité d’un rythme alternant investissement et désinvestissement du tout-petit de la part de la mère pour que le sommeil gardien du soma puisse s’installer, avec pour corollaire le rêve gardien du sommeil, l’ensemble garantissant le silence des organes. On sait que cette qualité de la mère est liée à la « censure de l’amante » qui met en jeu la discontinuité entre la libido maternelle, la mère étant séduite par le bébé à qui elle prodigue des soins, et la libido féminine de la mère amante qui désinvestit le bébé pour retrouver l’intimité corporelle du père. Ainsi, quand les choses se passent bien, la censure de l’amante renforce les visées narcissiques de la fonction maternelle de Marty en continuité avec l’identification hystérique primaire.
Outre le sommeil fatigant, chez ces patients, l’activité onirique est réduite et les rêves qui surgissent au fur et à mesure du traitement sont toujours rapportés à des objets ou des animaux qui bougent dangereusement, ou des contenants (chambres, maisons, grottes) que le rêveur se met à explorer de l’intérieur.
Je fais l’hypothèse qu’il s’agit d’une tentative d’élaboration fantasmatique de ce qui est propre et singulier au destin psychique et anatomique du corps féminin, à savoir qu’elle est le contenu du corps de la mère, de l’utérus, avant d’être à son tour un contenant. Cet enjeu singulier entre l’altérité et l’identique est propre à l’identité féminine et au développement de sa vie psychique.
REGARDS PSYCHANALYTIQUES SUR LE LIEN MÈRE - FILLE
À plusieurs reprises, Freud établit la distinction entre la névrose d’angoisse et l’hystérie, pourtant très intriquées, à partir de l’insuffisance psychique qui caractérise la première et qui est responsable de l’accumulation de la tension sexuelle interne, à l’origine des processus somatiques anormaux. En revanche, le soubassement des symptômes hystériques qui cliniquement s’apparentent à ceux de la névrose d’angoisse se fait à partir d’un conflit psychique. Ainsi la névrose d’angoisse est le pendant somatique de l’hystérie, la dérivation de l’excitation se produisant à la place d’une élaboration psychique suffisante. Cette distinction parcourt les diverses reprises freudiennes quant à l’origine et la nature de l’excitation, qui déborde les capacités du moi, et résulte d’un effroi présexuel qui ne doit pas dans le cas de l’hystérie être déchargé complètement et immédiatement mais passer par les frayages des traces mnésiques et l’après-coup, transformant ainsi la quantité extérieure en qualité (Esquisse). Or cette capacité transformatrice est liée à la qualité des échanges avec l’objet maternel primaire, ce qui correspond dans la conception freudienne à l’identification hystérique primaire, qui fonde les prémisses de la vie fantasmatique. Mais si la mère est la première séductrice, elle reste dans le modèle freudien essentiellement œdipienne, et n’est pas envisagée comme objet de séduction de la part de l’enfant. Or dans la clinique contemporaine aussi bien des structures névrotiques que non névrotiques, on est confronté aux avatars des investissements et identifications réciproques entre l’enfant et la mère pendant l’œdipe précoce. Ainsi dans la censure de l’amante conceptualisée par Michel Fain et Denise Braunchweig, l’accent est mis sur l’investissement de la mère réciproquement par et sur deux objets, l’enfant et le père de l’enfant.
Dès cette triangulation précoce et fondatrice, la mère apparaît dans une singularité soulignée par André Green, celle d’avoir des relations charnelles avec deux partenaires liés entre eux.
En ce qui concerne le développement œdipien féminin, l’œdipe précoce s’articulera avec le changement d’objet de la phase œdipienne où la petite fille devra à la fois s’identifier à la mère mais aussi se confronter à elle en tant que rivale. Ces remaniements identificatoires et libidinaux masculins, féminins, maternels, paternels vont réactualiser les identifications préœdipiennes maternelles et paternelles et leurs soubassements fantasmatiques. L’effraction de l’œdipe sexuel met à l’épreuve la force et la qualité de l’intrication pulsionnelle précédente et interroge aussi la texture du masochisme érogène primaire. On sait que le défaut de l’identification hystérique primaire fait le lit de l’hystérie mais aussi des éclosions somatiques. Comme le rappelle Augustin Jeanneau, chez l’hystérique la dépression est tournée au-dehors, en quête d’un objet d’amour à l’instar de l’objet prégénital.
Dans la quête de l’objet maternel en rapport avec les assises de sa propre féminité, la femme doit composer avec ce que Florence Guignard appelle le maternel primaire et le féminin primaire. Le premier se réfère à la capacité de rêverie de la mère et l’espace des introjections projectives, qui réactive dans la relation mère-fille l’infantile de la mère se voyant comme la petite fille qu’elle fut à travers sa propre fille. Cet espace vectorise le conflit pulsionnel primaire et renvoie l’enfant au fantasme du retour à l’utérus et au fantasme de castration. De sa texture dépendent également les processus de la pensée et les capacités créatrices ainsi que la qualité du préconscient. Le féminin primaire de la mère confronte l’enfant à la sexualité de la mère et au désir de l’autre. L’abandon de l’omnipotence narcissique marque l’avènement à la position dépressive et aux prémisses de la bisexualité psychique, la capacité de s’identifier à la mère et à l’objet du désir de la mère.
Chez la fille, l’intrication entre l’identification à la mère comme identique et en tant qu’objet du désir du père s’avère particulièrement complexe et douloureuse du fait de l’identité corporelle. Ainsi, accéder à une maternité créatrice et épanouissante implique le renoncement au fantasme de posséder (et détruire) l’utérus de la mère pour lui voler les richesses déposées par le père. Dans un cas que j’ai développé ailleurs, l’hystérectomie qu’une mère dépressive « exhibait » à sa fille pendant son adolescence a scellé l’identification hystérique masochiste à la mère afin de contre-investir les pulsions haineuses engendrant une énorme culpabilité.
Mère et fille appartenaient à la même secte, ainsi que le mari que la deuxième avait offert à sa mère afin de l’initier. Bien entendu le couple était stérile, sans que cela soit source de tristesse jusqu’à la mort de la mère et l’apparition de la fibromyalgie. Dans ce cas, l’arrêt de l’activité professionnelle pour cause de fatigue a été remplacé avec succès par une hyperactivité consacrée aux soins donnés bénévolement aux personnes âgées dépendantes ou mourantes, étayée bien sûr par une pulsionnalité sadique.
Chez les fibromyalgiques, la position de l’enfant thérapeute les confronte à l’intrication entre le désir de posséder le corps de la mère en lieu et place de l’Autre de l’objet et l’impossibilité de s’en détacher. L’obligation de porter le corps de la mère colmate la béance que laisse la perte de traces représentationnelles de « ce qui fait qu’on est sûr qu’on a bien eu une mère et qu’on a été bien porté dans ses bras » comme dit une patiente.
PORTER LA LOURDEUR D’UNE MÈRE LÉGÈRE
Liliane est une jolie femme ronde, de 57 ans, « rose bonbon », me suis-je dit, lors de notre première rencontre. Ses douleurs ont commencé après deux décès, la mort de sa mère et le mariage de sa fille la même année, ce qu’elle compte pour « un deuxième décès », comme elle dit, lors de notre première rencontre. À ces deux pertes qu’elle est incapable de différencier, il faut ajouter la mort d’un frère aîné qu’elle n’a sue que deux mois plus tard, comme si « elle était une inconnue ». Elle avait aussi appris le décès de sa mère le lendemain, et le vit depuis avec les remords de l’avoir placée dans une maison de retraite où elle a fini ses jours « désorientée ». À la suite de ces pertes, Liliane a suivi pendant quelques années un traitement antidépresseur et une psychothérapie « contre » une dépression sévère, dont elle s’estime guérie, mais elle garde des douleurs présentes jour et nuit, des sensations de brûlures et de glaçons, un épuisement physique permanent et des moments de déséquilibre et de désorientation, comme une somnambule. Elle s’efforce alors de visualiser une rambarde ou une corde imaginaire qu’elle doit tenir avec « ses yeux et ses muscles », pour éviter de tomber. Puis, elle se sent tellement fatiguée et ramollie que rien ne peut l’atteindre. Même l’explosion d’une bombe n’arriverait pas à la faire bouger.
De cette hypervigilance sensorielle et motrice est tissée comme un fil rouge la relation de Liliane à sa mère. Petite dernière d’une fratrie de cinq enfants, elle était pendant toute son enfance plus qu’un simple soutien d’une mère à moitié sourde, atteinte d’une otospongiose et presque aveugle, à la suite d’un glaucome. Liliane était toujours collée à elle, la guidait pour traverser la rue, lui décrivait les paysages, lui répétait les paroles des passants qu’elles rencontraient, car « sa voix vive et aiguë de petite fille portait bien », et rendait sa mère heureuse. Ainsi, plus que porter sa mère, Liliane avait toujours eu le sentiment d’être devenue littéralement le corps de sa mère, seule manière de pouvoir tenir et assumer cette lourde charge. Elle évoque deux souvenirs-écrans qui manifestement gardent une brillance traumatique : dans le premier, un médecin enlève la peau des yeux de la mère à l’aide d’une pince. Dans le deuxième elle tombe dans un fossé à l’âge de 6 ans alors qu’elle traversait un champ, en tenant sa mère à bout de bras, en évitant les orties. Lors de la chute, la petite fille s’est trouvée écrasée par le poids de la mère corpulente et terrorisée à l’idée qu’elles pouvaient y rester coincées pendant la nuit. Elle faisait ce « chemin de calvaire » plusieurs fois par semaine pour conduire sa mère chez sa propre mère, qui vivait seule à plusieurs kilomètres de la maison parentale de Liliane.
Dans l’histoire familiale, elle occupe également une place singulière. Elle est la seule à porter le nom de son père, deuxième mari de la mère qui était également son amant ainsi que père biologique de tous ses enfants, nés pendant son premier mariage et reconnus par le premier mari dont ils portent le nom. Liliane est née après la mort de celui-ci et le remariage de sa mère avec son « amour adultérin ». Elle porte son nom « comme un fardeau » tandis qu’elle s’attendait à ce que cela fût une fierté qui lui aurait valu la reconnaissance et les faveurs de sa mère. A la place, elle a eu affaire à la rivalité et à l’hostilité de ses frères et sœurs qui la traitaient comme une « petite merde », alors que c’était elle qui avait scellé l’union de ses parents, y compris en payant intégralement les frais des obsèques pour les deux décès. D’ailleurs, au décès de ses parents, qu’elle présente comme une scène primitive ultime, elle découvre dans le livret de famille qu’à sa naissance, elle était déclarée de mère inconnue. Sa mère l’aurait reprise quelques mois plus tard.
En guise de commentaire sur les différentes prises en charge qui lui sont proposées (antalgiques, antidépresseurs, relaxations, kinésithérapie, psychothérapie), Liliane me dit que rien ne la soulage vraiment et pour longtemps, mais qu’elles doivent exister. Elle doit prendre tout ce qu’on lui donne, de la même manière qu’elle grignotait les restes de tranches de pain que sa mère lui donnait, une fois que ses autres enfants avaient fini le petit déjeuner.
Elle accepte ainsi de « goûter » la psychothérapie parce « qu’elle n’a rien à perdre », et que je la reçois très loin de son domicile ce qui lui donne le sentiment que je ne lui impose pas une thérapie lourde. Le contraire de son psychiatre qui était pesant et l’enfonçait dans un silence de plomb. Elle vient accompagnée de son mari, renfrogné et bougon, qui l’attend dans le couloir et dont Liliane ne fera aucune mention pendant longtemps.
Les plaintes corporelles décrivant un « dos en feu et un corps écrasé par la fatigue, piétiné par un éléphant » occupent toute la séance et sont directement associées au stress permanent qu’elle ressent à son travail et qui la conduit à se faire arrêter par son médecin, voire même à envisager une préretraite. Elle occupe un poste administratif dans l’Éducation nationale où elle est chargée des normes de sécurité dans les écoles maternelles et primaires. Elle ne peut plus assumer la « lourdeur de ses responsabilités et les exigences qui augmentent, au détriment de la reconnaissance et la valorisation qui sont en baisse », d’autant qu’elle ne supporte pas les conflits entre ses collègues et le supérieur hiérarchique, une femme de caractère mais sans considération pour son équipe. Liliane décide de la défendre en se désolidarisant d’une pétition dénonçant son incompétence et ses abus de pouvoir. Il s’ensuit une période de long conflit qui empoisonne les relations au bureau et qui aboutit au départ houleux et amer de la chef. Elle est très déstabilisée. Habituellement elle se sent obligée d’accepter tout, même des choses contradictoires ou insensées, et dans ce conflit, elle a pu s’opposer « à la masse », mais avec des dégâts. Elle se sent seule, plus fatiguée que jamais alors que la chef est partie et qu’il n’y plus de tensions. Elle veut comprendre pourquoi elle ne peut jamais dire non, ou poser des limites.
Cette situation, qui me demande une gymnastique mentale particulière car je me sens sollicitée à suivre les fluctuations économiques de la patiente, tout en m’efforçant de préserver mes capacités fantasmatiques, me permettra de comprendre et de montrer à Liliane l’origine interne de son « stress ». Ce que Liliane a ressenti à l’égard de sa chef attaquée : volonté de la protéger en se démarquant de la fratrie de ses confrères et consœurs, espérance d’être reconnue dans ce dévouement, recrudescence des douleurs et abattement après qu’elle est partie – répudiée, pensais-je –, ressemble point par point à sa position d’enfant thérapeute, mère de sa propre mère. Ce qui la contraint à maintenir un état d’excitation élevé n’est pas tant lié à sa peur consciente de commettre une négligence ou une faute et d’être moralement responsable d’un accident qui pourrait blesser ou tuer un enfant, mais à son angoisse inconsciente d’endommager ou de détruire sa mère alors qu’elle était chargée de la protéger, de veiller sur elle. Je dois préciser que le levier transférentiel qui me permet de lui formuler cette idée est le fait que Liliane fait souvent des commentaires sur mon physique et des éventuelles marques de fatigue ou de contrariété. Elle devient alors très vigilante à mes expressions ainsi qu’aux bruits du service.
Je cherche à lui montrer que l’angoisse n’est pas directement liée à son travail, source d’ailleurs de gratifications qu’elle sous-estime, mais à l’énergie considérable qu’elle doit déployer pour lutter contre ses propres pulsions agressives, voire destructrices, dirigées contre un objet d’amour dont elle attend la reconnaissance.
D’autre part je vise à introduire la dimension de la fonction paternelle dans sa vocation de tiercéité, et du désir maternel pour le père, en lui faisant entendre implicitement que dans son éprouvé de porter le fardeau de sa mère malade tout en faisant un avec elle, elle cherche aussi à être un parent pour sa mère, aussi bien une mère qu’un père, l’homme père qui la protège mais qui a aussi des « titres de propriété », en reprenant une de ses formulations à propos de son lieu de travail qui n’appartient pas à elle mais au chef de l’État. Cette idée semble difficile et elle s’absentera en arrêt maladie.
À son retour, elle se dit accablée de fatigue, mais elle se sent très réconfortée à l’idée que j’ai laissé entendre, à savoir qu’elle peut s’intéresser à autre chose que le devoir professionnel. Elle compare cette idée à l’image d’une mère qui accepte que sa fille peut avoir des secrets qu’elle ne lui communique pas. Elle évoque alors son goût pour les beaux vêtements, difficiles à trouver à sa taille, et son souci d’assortir la rousseur de ses cheveux à son maquillage de manière féminine et légère, mais « sans faire vulgaire ».
Pendant une période d’accalmie, quant à ses douleurs, durant laquelle Liliane me donne une étrange impression de somnambule éthérée, le travail psychothérapique va se poursuivre au profit d’un renforcement des identifications féminines plutôt mimétiques, et d’une recherche de complicité avec moi qui illustrera les difficultés de la triangulation qui la confronte à l’épreuve de la perte d’objet.
Le remaniement dans son lieu de travail a mis en place une équipe composée d’un chef homme et de plusieurs jeunes femmes, décrites comme aussi idiotes et incompétentes que vulgaires et provocantes, prêtes à tout pour obtenir une promotion. Liliane se trouve alors dans une place tantôt de vieille fille mise au placard, oubliée et inutile, qui doit céder sa place, tantôt dans un rôle de mère expérimentée qui doit apprendre aux nouvelles « les secrets du métier ». Une nouvelle période de recrudescence des crises douloureuses correspond à cette rivalité œdipienne et de jalousie féminine, qu’elle récupère dans un fantasme de mère initiatrice ainsi que dans la joie d’être grand-mère. D’une part, elle se compare avec tristesse aux « nénettes » légères du bureau face auxquelles elle ne fait pas le poids, d’autre part elle investit de plus en plus nos séances qui sont devenues plus fréquentes, ainsi que les moments d’enjouement qu’elle partage avec sa petite-fille de 4 ans et son petit-fils de 18 mois. Elle souligne sa capacité de deviner et de combler leurs besoins et leurs désirs (préparer des bons plats pour le bébé, jouer à la dînette ou lire des histoires). Elle peut bouger et « s’éclater avec eux dans le bonheur », se démarquant de sa propre fille qui se montre austère et sèche avec ses enfants leur interdisant de « courir et de tournicoter sans cesse ». Dans une ambiance de béatitude orale, elle se sent envoûtée par sa petite-fille « merveilleuse et magique » et un petit garçon qui la dévore des yeux et la comble de câlins.
C’est dans ce contraste de perte et de retrouvailles que Liliane évoque pour la première fois les crises de jalousie de son mari chaque fois qu’elle fait des coquetteries ou achète des cadeaux à ses petits-enfants. Il se montre très hostile et jaloux de ses séances avec moi mais tient à faire l’aller-retour avec elle pour la surveiller et lui gâcher son plaisir.
La passivité vis-à-vis des violences physiques et verbales de son mari que Liliane associe aux disputes violentes de ses parents, et l’alcoolisme « dégoûtant » de son père, comme si elle devait porter et supporter le poids d’un destin, correspond à un renforcement masochiste de l’identification hystérique à la mère face à la crainte de la perdre, menace sous-jacente à tout changement économique et opportunité de créer des nouveaux objets. Cette identification masochiste à la mère renoue avec une des parties clivées de l’enfant thérapeute, celle de la passivation imposée par les besoins de la mère, alors qu’une autre partie s’identifie aux besoins et aux désirs d’enfant. C’est cette partie qui est en œuvre dans la capacité de Liliane de « régresser », comme elle dit, en présence de ses petits-enfants.
À ce moment de la cure, la patiente évoquera la fatigue sous un autre angle. Celui de la lassitude de penser : au bureau, en séance, en réunions de famille à propos des problèmes d’héritage. Elle veut qu’on la laisse tranquille avec sa petite-fille qu’elle cajole avant de dormir, tandis qu’elle a peur de garder le bébé garçon toute la nuit car il pourrait se trouver malade, voire en détresse vitale.
Dans un transfert positif de base, Liliane cherche le même contact que celui d’être près du corps de sa petite-fille, dans une identification immédiate, proche de l’identification hystérique primaire. Toute sollicitation, physique ou intellectuelle qui rompt ce corps à deux mobilise une charge pulsionnelle motrice, qui pourrait expliquer la fatigue exprimée. En revanche, la position masochiste vis-à-vis du mari, que Liliane associe au « réveil des douleurs du dos et des bras », avivant aussi les réminiscences d’une scène primitive brûlante, correspond à une sexualisation secondaire, à travers les identifications maternelles et paternelles, féminines et masculines sous-jacentes au « féminin » de la mère et qui mettent en scène une mère sexuelle rivale. Cette image est effractante et insupportable, car elle ne peut pas s’articuler avec des traces fournissant l’assurance d’une mère aimante et qui « porte », capable de contrecarrer l’irruption du génital.
Liliane évoquera une relation de tendresse et d’affinités avec un homme très séduisant et fin, qui cherche à « s’introduire davantage dans son intérieur », ce qu’elle voit venir, et elle redoute de « se comporter avec légèreté, et tout perdre ». La légèreté de la séduction féminine s’oppose à la lourdeur du corps maternel à porter et à supporter, écrasant mais sûr. Le léger devient menaçant à cause du manque d’insouciance infantile, et la lourdeur qui vide le corps mais qui est indispensable pour vivre doit se comprendre en opposition à une mère sans consistance, qui ne porte pas l’enfant, en apesanteur.
L’identification de Liliane à sa mère oscille entre la lourdeur-douleur du lien primaire teintée du handicap sensoriel et la dépression de la mère inversant la logique de la régression-dépendance au sens winnicottien, la rivalité féminine œdipienne et le changement d’objet qui menace le pacte narcissique de non-agression scellé avec la mère, à partir de la place d’enfant thérapeute. Cette inversion de génération est aussi utilisée en porte-à-faux par rapport à « la censure de l’amante », permettant à la fille de maintenir une illusion d’omnipotence près de sa mère et d’occuper fantasmatiquement la place de l’amant sans pour autant permettre une véritable intériorisation de surmoi paternel. La structure œdipienne de la mère marquée par la figure de sa propre mère qui déteint sur la complicité réelle avec sa fille déqualifie la fonction de la censure de l’amante qui se trouve ainsi resexualisé, comme un trop d’excitation fixé sur le corps qui ne peut pas suivre pleinement un destin fantasmatique. De ce point de vue, elle fonctionne comme une hystérie de comportement au lieu de se développer vers une hystérie complète. Tout changement d’objet et remaniement économique en faveur du père n’est pas vécu comme porteur de nouvelles richesses et d’ouverture affective mais ravive le risque d’un arrachement du lien maternel, d’un délestage narcissique plutôt que d’une légèreté et entraîne un renforcement masochiste de l’identification hystérique à la mère souffrante et délaissée.
Au bout de deux ans, les douleurs physiques de Liliane sont devenues supportables, parfois inexistantes, ce qu’elle attribue au fait de pouvoir se confier à moi et de garder son mari dehors, mais elle est très gênée par son poids qu’elle attribue au grignotage nocturne, où elle est réveillée par des rêves d’angoisse et la sensation de faim. Saisie d’une forte émotion, elle réalise qu’elle fait exactement comme sa mère, réveillée par des fringales nocturnes pendant une période où, très déprimée, elle avait chassé le père du lit conjugal et elle avait pris Liliane à sa place. Confidente de la mère pendant sa puberté, Liliane doit recomposer la scène primitive, en découvrant en la personne d’une maîtresse du père, une liaison qui remonte à sa naissance, une autre rivale (et alliée ?) œdipienne qu’elle doit partager avec sa mère. Le surgissement de ses propres désirs sexuels, et l’enrichissement psychique la confrontent à ce triple remaniement identificatoire, hystérique par essence. On pourrait se demander si toute hystérie féminine ne se distingue pas justement par ce noyau de lien pulsionnel au corps de la mère qui reste comme un roc, au cœur de toute formation de conflit psychique.
Liliane me pose alors une question : « Il me fallait une force de géant pour survivre à ma mère, tellement usée, fragile, et tellement énorme, en fer. En tant que femme, vous devez savoir, est-ce que les femmes traînent toujours leur mère comme un boulet, comme si on était condamné à la même peine ? On ne peut jamais se laisser aller, s’envoler à la légère sans se faire attraper en bas par ce poids épuisant. »
En ses termes, on pourrait penser la fatigue comme émanant de deux investissements douloureux contraires, l’un se dirigeant vers le narcissisme corporel, faute de pouvoir se transformer en douleur psychique, l’autre se dirigeant vers la constitution d’un objet œdipien destiné à être lesté masochiquement afin de ne pas être perdu.
"Le but final étant de ne jamais s’épuiser des chaînes qui lient à la mère".
Ouvrages de référence:
-Guignard F. (2000), « Mère et fille : entre partage et clivage », in La relation mère-fille, entre partage et clivage, Paris, SEPEA.
-Hôpital Avicenne, Bobigny.
-Fritz P., Bardin T., Fibromyalgie et syndrome myofacial.
-Braunschweig D., Fain M. (1975), La Nuit, le Jour, Paris, PUF, coll. « Le fil rouge ».
-Green A. (1997), Les Chaînes d’Éros, Paris. Odile Jacob.
-Jeanneau A. (1985), « L’hystérie, unité et diversité », Rapport au 44e Congrès des pays de langue romane, in Revue française de psychanalyse, t. XLIX, n° 1, p. 107-326, Paris, PUF.
-Papageorgiou M. (1999), « Tu enfanteras dans la douleur ou tu n’accoucheras point », in Revue française de psychosomatique, n° 15, Paris, PUF.