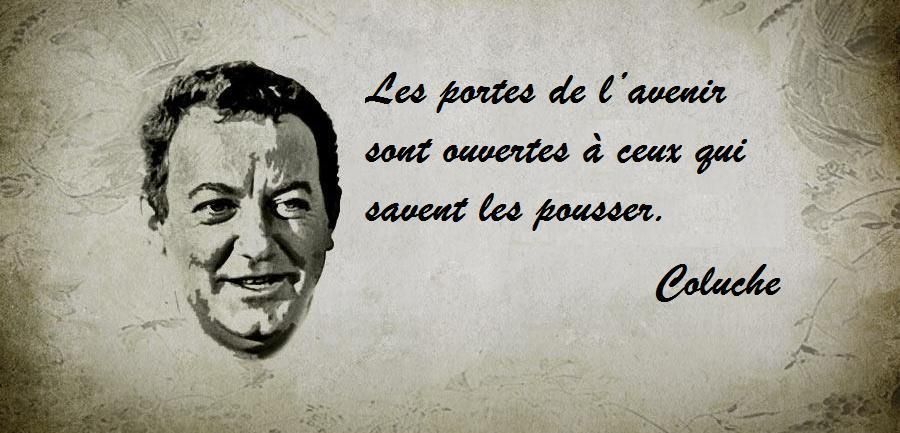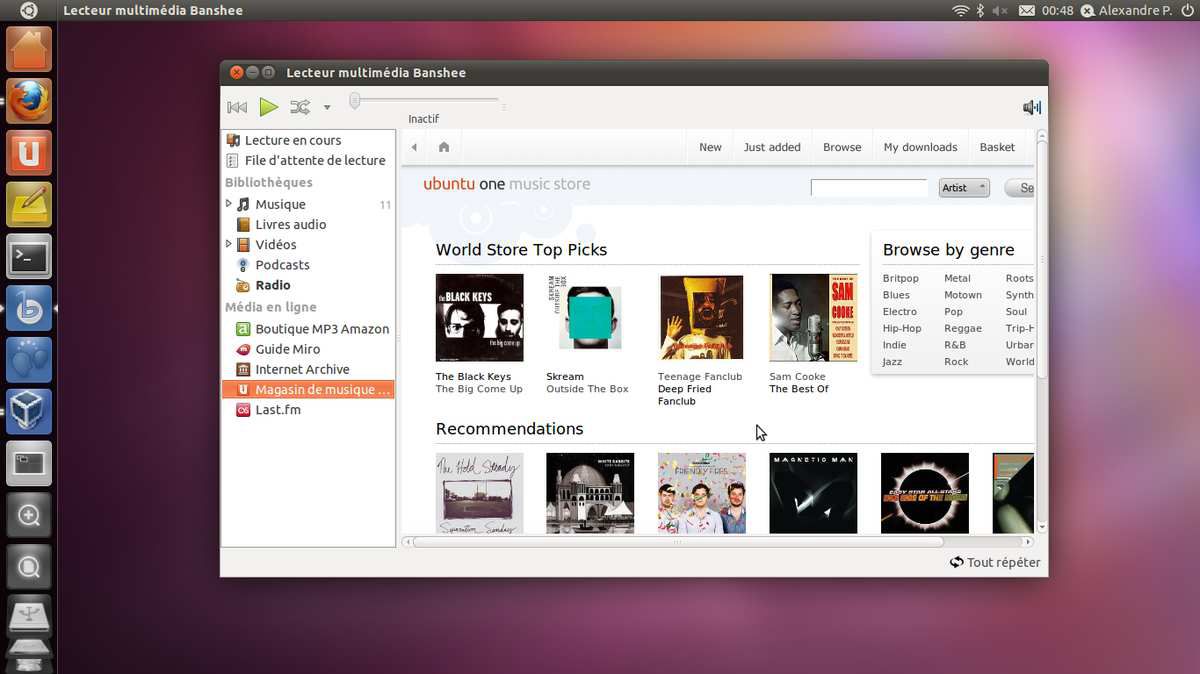Elles se différencient essentiellement par les contre investissements du surmoi en lien avec la place de la femme dans la culture et dans la religion. Faire l’amour pour l’homme a toujours renforcé son narcissisme phallique. Aimer faire l’amour place la femme dans une forme de dévalorisation narcissique associée à l’image de la putain en contradiction avec celle plus valorisante de la maman.
L’homme s’est ainsi retrouvé pris entre deux scènes opposées. Dans l’une, on trouve un macho phallocrate qui vit sa sexualité dans le mépris et l’humiliation de la femme, la putain et dans l’autre, un bon père de famille, copain, pro-féministe, respectueux de la femme, la madone.
Le mot “ Putain ” désigne une femme capable d’être féminine, sexy et érotique. Elle sait être désirable et séduisante et ose montrer son envie. Elle recherche le plaisir autant pour le recevoir que pour le donner. La putain associée à l’image de la prostituée a de tout temps exercée une grande fascination chez l’homme. Elle est au centre des images pornographiques. Elle s’exprime également dans les violences sexuelles presque exclusivement le fait des hommes.
L’attraction et l’emprise de la femme sur l’homme ont fait qu’il a dû se protéger d’elle en la diabolisant. Il lui a opposé l’image de la pureté de la madone et du sacrifice de la femme qui enfante dans la douleur. Cette image renvoie à la sainte vierge et au cliché de la mère de famille parfaite, excellente et indispensable. La madone peut tout contrôler, dominer et diriger, tout en culpabilisant son entourage et en se prenant souvent pour une victime.
La libération sexuelle de la femme dans nos sociétés occidentales a changé la donne. L’évolution actuelle est difficile à saisir, mais elle va dans le sens d’une moindre différence dans les comportements sexuels. Néanmoins, les déterminants biologiques du désir font que la sexualité de l’homme restera probablement toujours plus agressive.
Entre l’amour et la haine
Dès la naissance l’enfant est en lutte entre deux forces contraires qui engendrent son angoisse. Le désir de rester indifférencié à la mère au risque de ne pas exister, et la nécessité de s’individualiser au risque de se sentir menacé d’abandon et d’être insécurisé. La relation inscrite dans la présence maternante de la mère est érotisée. Pour calmer l’angoisse liée à ses absences, il crée un espace transitionnel dans lequel des fantasmes évoqués sont associés à des stimulations physique, engendrant des mouvements aussi bien tendres qu’hostiles.- fantasmes masturbatoires. Son monde interne se construit sur un mode clivé. Il éprouve de l’amour lorsque son désir est satisfait. Il se sent détruit et ressent de la rage lorsque l’environnement n’est pas conforme à son désir.
Dans ce modèle simplifié, la présence d’une mère suffisamment bonne qui ne se laisse pas détruire par l’angoisse et l’hostilité de son bébé, favorise l’intégration de la gratitude et de l’hostilité à la mère. Les représentations de cette dernière seront pour l’essentiel plus ou moins refoulées sous la pression des différents processus éducatifs. Les affects hostiles resteront inscrits comme un proto-langage s’exprimant sur un mode préverbal dans la communication érotique. Cela va déterminer la manière dont l’homme va gérer ses angoisses et sa capacité à les érotiser.
Dès les premiers mois de la vie, l’enfant est en présence de l’ailleurs de la mère intéressée par un autre, le père et d’éventuels frères et sœurs. Il renonce à son omnipotence au profit de la toute puissance de la mère. Pour supporter l’angoisse, il se place dans une position masochiste. « Si c’est son désir, c’est bon pour moi. »
Puis il subit l’épreuve de la différence des sexes et des exigences de la réalité. Il s’inscrit dans le jeu des identifications croisées aux deux parents sexués. Il est confronté à une nouvelle castration en renonçant à posséder sexuellement les parents. Ses constructions incestueuses imaginaires feront partie de ses proto-fantasmes faits de mouvements fusionnels et anti-fusionnels et s’intègreront plus tard dans les exigences sexuelles du MOI. Celles-ci permettront à l’homme de s’abandonner à des expériences de possession, de perte, d’effacement des limites et à la jouissance sexuelle.
L’identité sexuelle du garçon…
Pour intégrer les schémas socioculturels de la masculinité, le garçon doit se défaire de la féminité primaire rencontrée dans l’expérience de maternage avec maman. Pour cela il doit changer d’objet d’identification et s’éloigner de la mère en mettant à l’écart ses besoins fusionnels. L’acquisition de l’identité de genre serait donc plus difficile chez le garçon. Il n’est pas du même sexe que sa mère. En se différenciant et en s’éloignant d’elle, il s’expose aux anxiétés d’abandon, en restant trop proche il se sent englouti et ne peut accéder à la masculinité. De là s’inscrit en lui le complexe fusionnel, anti-fusionnel basé sur le clivage amour haine. On le retrouve dans la dualité sexuelle de l’homme faite de l’attraction et du refus de la maman et de la putain.
A l’adolescence cette dualité se transfère sur la femme aimée et désirée. Les premières expériences sexuelles viennent souvent renforcer l’anxiété liée aux risques de la masculinité. L’érection est insuffisante ou l’éjaculation est prématurée. L’angoisse liée au désir d’investir la femme peut alors être contrée par une masturbation très défensive. Pour le garçon investissant plus le pôle agressif, la génitalité servirait à protéger et à affirmer son identité sexuelle masculine. L’intimité avec la femme lui fait courir le risque de rencontrer l’anxiété de ré engloutissement. Ce qui explique que certains hommes ne parviennent pas à établir cette intimité affective. En évitant la fusion et la tendresse associées à la féminisation, l’homme à l’impression qu’il peut mieux maîtriser sa sexualité.
Mais elle s’expose à celle de la jeune femme, à son anxiété liée à la désirabilité et aux peurs profondes de se sentir objectivée et prise pour une putain. Toutefois, la gestion des besoins fusionnels semble moins ardue pour la fille. Ce qui explique qu’en général, les femmes s’engagent avec plus d’aisance que les hommes dans un rapport d’intimité affective. Mais confondue à la mère, elles ne peuvent advenir à leur propre jouissance de femme nécessaire à l’accueil de l’agressivité phallique de l’homme.
La femme est diabolique !
La domination de l’homme présente dans la plupart des sociétés renvoie à la nécessaire fonction phallique paternelle qui permet de séparer l’enfant de la mère pour sociabiliser l’enfant. L’amant de jouissance vient aussi en position de tiers séparateur pour arracher la femme à sa relation archaïque à la mère, condition pour qu’elle accède à sa sexualité de femelle.
La division de la femme aurait été renforcée par le patriarcat qui réside dans le désir de l’homme de transmettre ses biens et le fruit de son travail à ses fils naturels et légitimes. Cela a donné naissance à une organisation socio-économique où la femme trouvait d’abord sa place comme objet de reproduction ou comme objet de satisfaction des besoins sexuels de l’homme. La femme perçue comme objet sexuel était associée à la prostitution et la mère au mariage. Ce double statut a amené l’homme à vouloir la posséder, l’exploiter, la contrôler. Il lui fallait absolument contrer les risques d’infidélité, au risque de lui faire perdre sa désirabilité. Les positions de l’église ont amplifié le clivage et nourri la méfiance, allant jusqu’à décréter que le sexe de la femme était dangereux et maléfique. La femme par son sexe basé sur le plaisir pouvait posséder l’homme et lui faire perdre tout contrôle sur la chair. Elle devient diabolique. Le sexe incarné par Eve est coupable, punissable, méprisable. La femme pouvait ainsi servir d’exutoire à la haine de l’homme rejoignant celle éprouvée par la castration à la mère.
" Ma mère n’est pas une putain "
Les tabous autour de la sexualité font que la mère dans sa parure de madone ne se présente pas à l’enfant comme une femelle qui a fait et fait l’amour avec un autre. Celui-ci n’associe pas la procréation au plaisir de sa mère.
La plupart des patients, rencontrés en thérapie, ont du mal à pouvoir imaginer leur mère faire l’amour. Ils ne savent rien de sa sexualité plaisir. L’imaginer dans cette position de jouissance les dérange profondément.
L’enfant découvre, parfois très tard, que sa mère a fait l’amour pour qu’il puisse naître à la vie. L’amour, au sens du coït, est associé aux ébats corporels de nature animale et triviale. Il découvre la sexualité dans le secret angoissant. C’est propice à toutes les créations imaginaires, souvent excitantes, fascinantes et inquiétantes, parfois même dégoutantes.
Il recherche plus tard une femme digne comme sa mère, en mesure de lui faire des enfants parfaits. L’investissement d’objet apparenté à une putain s’oppose fondamentalement à la pureté morale de la mère. Cette opposition puissante fonde la fantasmatique de l’homme. Elle est au cœur de sa sexualité.
Je revois l’exemple de cet homme qui vivait sa mère comme une sainte, mère qui a eu 9 enfants. Il avait dit à sa femme « si tu veux être heureuse avec moi, tu dois aimer ma mère ». Il a choisi une femme frigide ayant peur de la sexualité. Il a assumé pendant 20 ans son rôle de père au prix d’une profonde frustration qu’il a compensé par de nombreuses maitresses. Il respectait sa femme disait-il et pourtant il ne pouvait faire autrement que de la « baiser ». Puis ils ont fait chambre à part. Cette période de sa vie a été dominée par beaucoup de colère et d’angoisse.
L’infidélité activateur du désir
Dans l’inconscient de l’homme il y a toujours un autre possible, réel ou imaginaire qui donne à la femme sa force d’attraction et active le désir. La femme séduisante est susceptible d’être convoitée par d’autres. Elle est potentiellement infidèle, l’infidélité étant de tout temps associée à la putain. La femme fidèle, bonne épouse et mère de ses enfants perd son pouvoir d’attraction. La jalousie de l’homme repose sur l’angoisse de la perte de l’objet aimé et désiré, mais aussi sur l’attraction répulsion représentée par le rival. A la source, le rival du même sexe, le père ou le frère, est devenu plus ou moins le premier objet d’amour homosexuel. L’homosexualité latente sera souvent présente dans la fantasmatique de l’homme.
La jalousie est un des moteurs de la passion amoureuse. L’homme découvre partout des amants. Pour calmer sa douleur jalouse, il fait des enfants et se rassure. Il transforme sa femme en mère au foyer. Perdant ses pouvoirs de femme, elle revêt alors ses attributs de madone, une façon d’exprimer son hostilité en se désinvestissant de la sexualité.
Je rencontre des hommes qui ont perdu tout désir sexuel pour leur femme. Visionner des films pornos ou engager des liaisons virtuelles avec « ces salopes » rencontrées sur internet mobilise leur désir sexuel. Faire l’amour avec leur femme qui n’aimerait pas suffisamment le sexe n’est plus suffisant.
D’autres hommes s’organisent discrètement des soirées en club libertin où ils peuvent mettre parfois leurs fantasmes en actes. Beaucoup en rêve seulement. Des femmes qui ont découvert que leur mari regardait des films pornos ou entretenait des échanges virtuels avec des femmes sur internet ont été très blessées.
Par exemple, une femme n’aimait pas faire l’amour. Elle est très belle. Après une longue période de désinvestissement total de la sexualité, elle surprend son mari sur internet engagé dans un dialogue avec des femmes qui le font sexuellement rêver. Passé le temps de la colère, elle s’engage avec lui dans un travail de psychothérapie de couple pour ne pas le perdre. Plus tard en découvrant sa fantasmatique profonde, elle reprend contact avec « la putain » et reprend goût à l’érotisme et à l’amour, son mari aussi.
L’hyper sexualisation de l’homme
L’hyper sexualisation de certains hommes s’oppose le plus souvent à la sexualité de la femme. « Il a trop de désir » disent-elles. Elles estiment que le trop de désir a tué leur désir. L’agressivité de la demande sexuelle des hommes engendre des réactions comme : « Il fait l’amour sans me respecter », « il ne prend pas le temps des préliminaires. » Pour l’homme, amener sa femme à la jouissance représente un double triomphe. Cela répond à la frigidité supposée de la mère et à la prise de pouvoir sur le rival. Plus elle jouit moins elle ira voir un autre et plus elle sera convoitée comme une femme jouissive. L’enjeu entraîne souvent des comportements envahissants et d’urgence. La putain agit comme moteur de son impatience en réaction à la madone primitive et à l’impuissance psychique face au rival. L’agressivité que cela révèle fait que l’homme érotise plus facilement l’hostilité présente dans la sexualité. Alors que la femme a le plus souvent besoin de contacter le lien fusionnel et la tendresse pour accueillir l’hostilité de l’homme. Cette généralité est souvent nuancée par la clinique.
La position plus passive et masochiste de la femme recouvre souvent une agressivité latente. En se sentant sécurisée par la complicité avec l’homme, elle peut plus facilement être active et laisser vivre son agressivité. L’homme ne pouvant s’investir dans une intimité avec sa femme, se heurtera au refus de celle-ci à être objectivée. Il ne peut ni assumer, encore moins exprimer ses désirs coupables dans la relation. Ses comportements sont ambivalents et muets comme ceux des parents.

La madone Florentine - portrait
La maman et la putain sont dissociées...
D’après Freud, les courants tendres et sensuels sont dissociés chez les hommes et plus associés chez les femmes. Pour l’homme il sera difficile de rencontrer ces deux courants chez une femme qui doit être l’épouse, la compagne, la mère des enfants et l’amante. Le clivage maman/putain pousse certains hommes à dissocier dans leur vie réelle l’épouse respectable et la femme objet de désirs, la maîtresse ou la prostituée.
Chez beaucoup de femmes ce clivage est insupportable. Chez elles l’amour est nécessaire pour accueillir les aspects transgressifs du désir et de l’excitation. Dans la passion amoureuse, l’homme et la femme peuvent faire vivre les deux courants. En l’absence des aspects fusionnels de la passion, la sexualité plus agressive est vécue comme une déchéance par la femme. Elle déserte alors la sexualité.
Je vois plusieurs hommes, qui après plusieurs années de passion, rencontrent des difficultés à installer ou à maintenir l’érection. La femme dans sa demande de tendresse ne suscite pas l’excitation. Certaines se sont réfugiées dans des courants qui prônent la sexualité sacrée. L’homme se sent castré. La perte symbolique de l’érection de l’homme la blesse dans sa désirabilité et la conduit à la frigidité.
L’insatisfaction sexuelle est interactive
La sexualité de l’homme se manifeste selon le cycle de la réponse sexuelle : désir du désir sexuel, mobilisation vers l’objet de désir, sexualisation de la rencontre, orgasme, résolution et retrait, puis période réfractaire. Celle-ci sera marquée soit par une rupture de contact, soit par une continuité tendre animée par la gratitude de la jouissance. Les difficultés érectiles et l’éjaculation prématurée sont bien connues et marquent souvent une communication érotique discordante. J’insisterais particulièrement sur deux étapes du cycle, celle de la résolution-satisfaction et la gestion de la période réfractaire.
La satisfaction sexuelle à la fin du cycle dépendra pour l’homme de sa propre jouissance suscitée par celle de la femme. Le rythme, l’intensité de l’excitation portés par la fantasmatique la plus souvent inconsciente de chacun devront suffisamment s’ajuster pour que la réponse sexuelle commune soit satisfaisante. L’insatisfaction de l’un rejaillira forcément sur l’insatisfaction de l’autre et induira de nouveaux comportements sexuels.
Par exemple si l’éjaculation de l’homme intervient trop vite, la femme sera insatisfaite. Si la femme ne jouit pas intensément, l’homme sera insatisfait. L’ajustement dépend aussi du processus de satisfaction sexuelle de la partenaire et de la nature psychophysiologique de son orgasme. La sexualité ne sera réjouissante pour les partenaires que lorsque l’ajustement entre les partenaires permet la réalisation d’une sexualité satisfaisante pour les deux. Or dans les faits les insatisfactions des partenaires sont rarement dévoilées. Exprimer son insatisfaction peut toucher la fragilité narcissique de l’autre.
Il en est de même de l’interprétation des comportements au cours de la période réfractaire. L’homme après l’éjaculation perd souvent de son dynamisme et de sa présence au regard de sa partenaire. Ne pas gérer son rythme éjaculatoire est un risque pour le couple. Après l’amour, l’homme peut être amené à désinvestir l’intimité et l’érotisme relationnel du quotidien. Ce qui engendre une profonde insatisfaction chez certaines femmes qui le feront payer à l’homme en se refusant à lui.
Désir et maternité ?
La sexualité lorsqu’elle est associée au désir de procréation et de création d’une famille devient, le plus souvent, compliquée. La majorité des difficultés sexuelles et relationnelles rencontrées dans les couples commencent à partir de la grossesse du premier enfant. Le regard de l’homme sur sa femme change. Elle devient mère comme sa mère ou comme la mère de sa femme. Le corps change. Les moteurs de l’excitation sexuelle de l’homme se déplacent. Ce changement de regard de l’homme, coupe la femme de sa représentation fantasmatique profonde de la « salope » et l’inhibe sexuellement. Ne se sentant plus désirable, cela renforce le processus de madonisation dans lequel l’investissement exclusivement maternel est privilégié. Pour l’homme, la difficulté concomitante ou conséquente de la femme à exprimer son intérêt pour le sexe l’inhibe également. Les freins au désir engendrés durant la maternité peuvent s’inscrire durablement dans la dynamique du couple. La femme continuera après la naissance à se réfugier dans le maternage et l’homme désinvestira le foyer envahi par trop de maternel. La sexualité restera le plus souvent défensive et s’éteindra peu à peu.
Pour l’homme, avoir un enfant peut réactiver le désir infantile du petit garçon pour la mère, désir auquel il a dû renoncer. Lorsque la désidentification avec la mère n’est pas suffisante l’arrivée d’un enfant est toujours une épreuve susceptible d’accentuer le clivage sur lequel repose sa sexualité. L’homme aurait besoin de dématernaliser la femme pour pouvoir la désirer. Dans les fantasmes sexuels des hommes, la mère et la femme ne cohabitent jamais. Les images de la féminité aiguisent les désirs sexuels, celles de la maternité les inhibent.
Les fantasmes de l’homme
L’exploration des fantasmes sexuels montre l’intérêt profond de l’homme comme de la femme pour une sexualité fantasmatiquement transgressive. Les fantasmes porteurs d’une forte excitation sexuelle font appel à une sexualité hors de la chambre et à des tiers. Ils font le plus souvent apparaître une sexualité non conventionnelle où apparaissent des scènes faites de trio, de partouze, de voyeurisme, d’exhibitionnisme. L’exploration plus approfondie de la fantasmatique fait souvent apparaître des scénarios dans lesquels s’expriment des pulsions sadomasochistes. Dans l’imaginaire de l’homme, son excitation sexuelle est révélée par la jouissance de femmes qui s’abandonnent et se perdent dans une sexualité déshumanisante.
L’étude des scénarios érotiques montre que pour qu’il y ait excitation sexuelle, le metteur en scène est toujours dans une double position. L’homme est porté par ses pulsions et les représentations de lui-même, mais aussi par ses projections dans l’espace intérieur de la femme. On retrouve ainsi la nature toujours double du fantasme, de l’enfant avec la mère ou de l’adulte avec la femme.
Le fantasme inconscient ou conscient à travers des scénarios érotiques est toujours présent dans la sexualité de l’homme comme de la femme. Il repose sur le désir de réparation et le renversement des traumatismes vécus dans la dyade mère/enfant, contrariée par la présence réelle, imaginaire ou symbolique du père.
Le caractère triomphant de l’excitation sexuelle générée par les scénarios fantasmatiques de l’adulte condense l’histoire personnelle du garçon dans ses découvertes de l’érotisme et de la sexualité.
Dans la fantasmatique de l’homme, la « putain » est perçue comme un animal sexuel permettant à l’homme d’exprimer l’urgence et la violence de son désir. Il y accède en se déconnectant de la culpabilité à objectiver les femmes. Accolée au mépris, existe aussi l’idée de la séduction. La putain semble plus accessible comme source de rêves et de fantasmes érotiques. Elle se présente comme une femme expérimentée et délurée, disposée à accomplir des actes sexuels que l’on s’interdit de demander à son épouse ou à sa partenaire officielle. L’homme dans ses fantasmes domine la femme et répare ainsi la violence faite par la mère à l’omnipotence de l’enfant, en lui préférant un autre. Dans la réalité la femme reconnue comme une madone, lui fait perdre souvent sa toute puissance, en le renvoyant profondément à l’impuissance psychique et érectile.
La violence sexuelle des hommes
Parler de la sexualité de l’homme amène à se questionner sur les violences sexuelles. Dans un contexte de violence, les hommes sont soit envahis par leur fantasmes ou soit animés par des pulsions qui s’expriment dans l’acte en dehors de toutes formes de représentations.
La perversité sexuelle de l’homme passe souvent par la relation incestuelle d’une mère avec son garçon. La relation est narcissique. Le garçon est un objet fétiche investi comme une idole qui doit illuminer la vie de sa mère. Il a pour mission de combler le vide intérieur de la mère désexualisée (désexualisation réelle ou imaginée). Le père n’est pas reconnu dans sa fonction d’homme. Le garçon pris dans les mailles de la mère se perd dans des fantasmes portés par le désir de faire peau commune et le besoin de déchirure de cette peau ou de pénétrer, d’envahir, de faire effraction dans l’objet d’amour pouvant conduire à la passivité, à l’immersion, voir à la dissolution. Ces fantasmes sont au service de visées défensives puissantes. Le combat titanesque du moi contre la peur et la mort trouve son origine dans l’emprise incestuelle. De là éclate une « rage narcissique » s’exprimant comme une immense protestation à vouloir exister. Elle s’exprime dans le passage à l’acte violent occultant la conscience fantasmatique. On entre dans la démesure sous l’effet d’une passion narcissique où l’autre n’est plus reconnu. L’acte dans le réel fait rupture avec la pensée. Il est proprement insensé.
Le problème de la limite dedans/dehors est illustré par le viol. Il faut un sujet à forme humaine à pénétrer. L’acte est effectué sous l’emprise d’une exigence intérieure, automatique tandis que la conscience reste extérieure à ce qui se déroule. Le sexuel est au service de la violence par effraction de l’objet indispensable pour exister.
On est constamment à la limite du dedans et du dehors, dans l’indétermination entre fantasme, hallucination et perception. La mère est à l’intérieur du sujet. L’indifférenciation est animée par un mouvement contradictoire de refus et d’incorporation de l’autre. On n’est pas encore dans le clivage entre la madone et l’anti-madone. Ce n’est pas d’angoisse de castration qu’il s’agit mais d’angoisse d’inexistence.
Dans la clinique on rencontre des défenses contre ces risques hallucinatoires. Ils se traduisent dans des formes d’impuissance à vivre ou à investir sexuellement la femme. La peur inconsciente d’être un violeur ou de prendre la femme comme une putain obère le désir et l’agressivité sexuelle.
L’homme en couple sous l’emprise de la madone
Dans la dynamique d’un couple, l’homme fusionnel et peu agressif sexuellement a souvent une fonction rassurante au début de la relation. Après quelques temps, les femmes détectant les anxiétés d’abandon de leur partenaire éteignent leurs propres pulsions sexuelles, leurs fantasmes et leur créativité érotique, par loyauté pour celui-ci. Le manque de masculinité du mari ne leur permet pas d’assumer leur propre besoins anti-fusionnels, de peur de se percevoir dans leur propre regard et le sien, comme une putain. Le désir est affecté. Le conjoint fusionnel devenant inquiet du manque d’enthousiasme de sa partenaire, intensifie ses avances sexuelles. L’anxiété liée à la non reconnaissance de sa masculinité est amplifiée. Elle engendre le plus souvent une réactivité sexuelle maladroite ou la perte de son désir. Le message capté par la femme est que le sexe est susceptible d’entacher l’amour. La femme étouffe ses désirs de femme et déplace alors sa libido sur ses enfants en se réfugiant dans son rôle de mère, endroit où elle peut exercer un pouvoir sans limite. La castration exercée par la femme qui se dérobe au désir de l’homme tend soit à l’infantiliser un peu plus soit à engendrer une violence intérieure réactualisant celle qu’il a connu et étouffé avec la mère. Elle peut s’exprimer dans la colère ou la violence conjugale. Mais après que la femme ait assumé ses devoir de mère, la putain peut resurgir, mais rarement avec le mari disqualifié dans son rôle d’homme. Elle rencontrera peut-être un amant de jouissance qui lui révélera son potentiel. Sinon la sexualité lui deviendra inaccessible et étrange.
La putain et l’actrice porno !
Dans les fantasmes de l’homme, l’image de la putain est étroitement associée à celle de la prostituée. Dans la prostitution, il n’existe aucune attente. Les hommes sont libres d’aller leur chemin après avoir payé. Il n’existe aucun investissement émotionnel et aucun lien.
L’homme se réfugie souvent dans des offres sexuelles codifiées représentatives de la « putain ». L’actrice porno, comme la prostituée le fascinent bien au-delà de l’offre. Elles resplendissent comme un mirage par leur disponibilité permanente et une profonde représentation de la transgression. L’image de la « putain » attire, mais c’est d’abord parce que le sexe attire. Et si le sexe attire, c’est qu’il renvoie à un manque puissant, moteur du désir de l’homme.
Ni madone, ni putain...
Le rapport madone anti-madone dans les jeux de pouvoir du couple s’exprime de façon complexe. Les difficultés rencontrées montrent le caractère pernicieux d’un système à deux qui conduit à la désexualisation de la relation. Elles s’accompagnent d’un climat d’angoisse, de somatisations diverses ou d’une desaffectisation de la relation. Les ajustements entre l’homme et la femme dépendent de leur complémentarité intrapsychique, s’exprimant dans un proto-langage discordant ou concordant, reposant sur une structure fantasmatique profonde et personnelle de chaque partenaire.
Les aspects discordants profonds sont souvent dépassés au début d’une relation. Avec le temps, ils envahissent la relation à l’insu des partenaires. Les crises sont alors inévitables. Pour déjouer les pièges le couple devra se dévoiler, se parler afin d’instaurer une bonne complicité sexuelle nécessaire à la créativité. Les ajustements passent par la création d’un espace fantasmatique commun, s’exprimant par des jeux interactifs passifs, actifs entre l’homme et la femme. Beaucoup d’hommes s’y refusent, ne voulant déroger aux rôles qu’ils ont introjectés depuis longtemps. Pourtant l’homme devra à la fois mobiliser son agressivité sexuelle et élargir ses plaisirs dans une passivité plus féminine. Les hommes pouvant avoir des fantasmes plus féminins de soumission et de désirabilité associés à des fantasmes plus masculins de domination bénéficient de multiples possibilités qu’offre une genralité riche et complexe qui sort des schémas relatifs à la seule identité biologique. Cela laisse un grand espace pour la créativité et l’ajustement avec une ou un partenaire, pour que vive une seule libido au service de la jouissance de chaque partenaire, devenant tantôt mâle, tantôt femelle...L’attractivité agressive de la putain est alors assumée et distanciée par les deux partenaires. L’accueil et la tendresse plus féminine sont dissociés des aspects régressifs du lien maternel.
L’équilibre mobile entre l’agressivité phallique et la désirabilité de l’un et de l’autre passe par la création d’un « nous » érotique fait d’une fantasmatique concordante. Celui-ci dépend le plus souvent du dévoilement à l’autre de sa fantasmatique profonde et de l’élargissement de celle-ci à celle de l’autre. La complicité érotique, qui en résulte, est alors propice à la créativité sexuelle et relationnelle et de surcroît à la gratitude.
Il va de soi, qu’aucun schéma ne peut définir une quelconque normalité sexuelle de l’homme. Seul une acceptation profonde de soi-même, dans ses préférences érotiques et ses pratiques sexuelles, et l’acceptation de l’autre, vu comme un amplificateur de la jouissance, peut définir une certaine vision de la santé sexuelle. Elle s’inscrit toujours dans la qualité d’une relation.
Michel Bonhomme pour http://www.couple-amour-sexualite.com