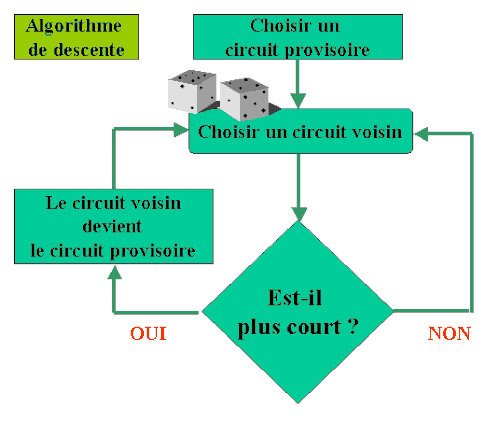Trois mois, six ans, vingt ans… De parloirs en promenades, comment vit-on le quotidien en milieu carcéral ? Comment s’organise la vie quand elle est contenue dans une cellule de 10 m2 ?

Les clefs de l’énorme trousseau cliquettent à la ceinture du surveillant. Pour pénétrer l’univers carcéral lorsqu’on est journaliste, il faut s’armer de patience. La maison d’arrêt d’Auxerre n’y fait pas exception. Trois mois de délai et quatre ou cinq relances téléphoniques pour obtenir une visite des locaux de seulement quarante-cinq minutes. Le jour dit, il faut sonner à l’interphone, franchir un portail encadré par un surveillant, laisser ses effets personnels, passer sous un portique de sécurité. À chaque porte, des sonnettes, des serrures aux lourdes gâches. L’attente.
À un instant donné, un Français sur mille dort derrière les barreaux. Bien qu’à l’écart et peu visible, la prison est une société à part entière. Dans les années 1970, le Groupe d’information sur les prisons (Gip), initié par Michel Foucault, Jean-Marie Domenach et Pierre Vidal-Naquet, permet à la prison de faire irruption dans le débat public. Depuis, nombre de sociologues, historiens, psychologues, journalistes et militants continuent de dénoncer l’univers carcéral comme étant un non-lieu marginal, occulté et, parfois, une zone de non-droit. Des témoignages de détenus, ou des œuvres de fiction, comme le film Un prophète de Jacques Audiard (2009), ont entraîné spectateurs et lecteurs là où leur regard ne portait pas : derrière les murs, dans le quotidien carcéral.
La prison est une institution en tensions entre des objectifs contradictoires : elle désocialise les individus pour les resocialiser, elle prétend tout à la fois punir et réinsérer. Mais, en deçà de l’ambition institutionnelle, une autre réalité se fait jour : celle de la vie quotidienne des détenus. En prison, parce qu’il faut bien vivre, on noue des liens, on s’approprie l'espace, on résiste ou on abdique, on patiente. Bien sûr, le quotidien carcéral diffère d’un établissement à l’autre, d’un détenu à l’autre. Régime d’incarcération ouvert ou fermé, maison d’arrêt ou centre de détention : les vécus sont pluriels, et les témoignages parfois dissemblables. Mais comment, concrètement, vit-on en prison ?
Compter le temps
La prison est un espace bien délimité : une cellule de quelques mètres carrés, des coursives, une cour, des murs d’enceinte. Mais elle est aussi un temps : le temps de la journée, des heures et des minutes ; et celui de la peine, des mois et des années. Le temps carcéral, explique le sociologue Gilles Chantraine, est « un trou noir : le cœur du système semble gorgé de vide (1) ». Les activités telles que le parloir, la bibliothèque, la promenade, le travail ou le sport ne parviennent que difficilement à structurer la journée des détenus. Au mieux, elles comblent le vide.
Dès lors, à quoi bon posséder une montre ? Quand ils sont en régime fermé , les détenus ne sont pas maîtres de leur emploi du temps. Ils doivent attendre qu’on leur livre la gamelle pour manger, qu’on vienne les chercher pour se déplacer. Même si elle maintient le lien avec le temps extérieur, la montre ne fait que renforcer ce sentiment d’impuissance : savoir l’heure qu’il est mais ne rien pouvoir faire de cette donnée. Christophe de La Condamine, dans le journal qu’il a tenu lors des quatre ans de son incarcération, raconte : « Si j’avais un repère au poignet, je risquerais d’y regarder un peu trop souvent, je m’y fabriquerais l’attente. Attente de la promenade, attente du déjeuner, attente de l’heure du dîner, attendre l’heure de quoi ? Vivement dans cinq ans ou dans dix (2). »
Les détenus perçoivent avec étrangeté les années passées en prison. Temps immobile, « le corps semble avoir vieilli sans avoir vécu », explique G. Chantraine. En prison, certains détenus choisissent ainsi de dormir le plus possible pendant la journée. « Comme si les heures de sommeil ne comptaient pas dans l’accomplissement de la peine (3) », souligne le journaliste Frédéric Ploquin.
Cantiner
Pour améliorer l’ordinaire, les détenus « cantinent », c’est-à-dire qu’ils achètent, sur leurs deniers personnels, de la nourriture, des produits de toilette, et tous les objets et fournitures dont ils ont besoin au quotidien. Comme ils ne disposent pas d’argent liquide, c’est sur leur compte, alimenté par les proches ou par le salaire qu’ils perçoivent, que sont prélevées les sommes des achats par correspondance. Les détenus pauvres, les « indigents » qui disposent de moins de cinquante euros par mois, se voient attribuer une petite aide financière, en fonction des établissements et de leur comportement en détention. Dans le cas contraire, ils doivent se contenter des « gamelles » et du nécessaire que leur fournit l’administration pénitentiaire, généralement de piètre qualité et distribué au compte-gouttes. Et se priver de télévision dont l’accès coûte souvent plus de trente euros par mois pour chaque détenu d’une cellule.
La consommation est aussi un plaisir, explique G. Chantraine, parce qu’elle « permet aux détenus de s’exprimer par le moyen des achats qu’ils peuvent faire (…). En se singularisant par ses achats, l’individu se soustrait pour partie à la règle commune et à l’impact dépersonnalisant de l’institution. »
Comme la plupart des cellules ne disposent pas de réfrigérateur – et alors même que les détenus peuvent cantiner des produits frais –, ils stockent leurs denrées l’hiver sur le rebord de la fenêtre, contre les barreaux. Une pratique ostentatoire qui n’est pas sans poser problème, témoigne C. de La Condamine : « Lorsque les occupants sont fortunés, tout est relatif, un camembert attend d’être consommé. (…) Les différences financières sautent aux yeux. Combien d’envies, générées par ces exhibitions, se règlent à la douche ? »
Nouer des liens
Entre les murs ont lieu de nouvelles formes de socialisation. Les codétenus partagent les repas, les promenades ou les ateliers. Ils se rencontrent en maison d’arrêt et se retrouvent parfois, des années après, en établissement de peine. Quand ils partagent une cellule de quelques mètres carrés, la confiance devient une valeur de premier plan. Partager les provisions cantinées, ne pas puiser dans les réserves des autres quand ils ont le dos tourné. La promiscuité aidant, tout manquement aux règles explicites et implicites peut dégénérer en accès de violence. Le détenu qui refuse de se laver, par exemple, est souvent rappelé à l’ordre par ses codétenus. Une surveillance mutuelle, officieuse, se substitue à celle de l’administration pénitentiaire. De fait, beaucoup de bagarres éclatent loin du regard des surveillants. « Embrouille dans notre pavillon, rapporte dans son journal C. de La Condamine, une casserole d'eau bouillante a répondu aux coups de chaise. Ces deux protagonistes n’ébruiteront pas l’affaire. Cloques et bosses ne valent pas mitard. » Lorsqu’une solidarité s’installe, elle est vécue comme une véritable planche de salut. C. de la Condamine raconte que son codétenu Titi lui gardait tous les soirs, durant la durée de son procès aux assises, son plat au chaud par un système de bain-marie artisanal.
Soigner ses troubles mentaux ?
« Un surveillant passe la tête par la porte et dit : “Celui-là, vous allez voir, je ne suis pas sûr qu’il soit pour ici.” Entre en effet un drôle de type jeune, absent ; il ne s’assied pas, il regarde avec intérêt les murs, il ne parle pas. Tout d'un coup, il frappe sa joue, écrase une chose invisible, secoue sa tête (4). » Le témoignage de la psychiatre Christiane de Beaurepaire illustre une contradiction : la justice condamne à des peines de prison des individus atteints de psychoses, incapables donc de comprendre le sens de leur condamnation. Alors qu’un rapport du Sénat de 2010 écrit que « la prison n’est pas un lieu de soin », on dénombre plus de 20 % d’individus atteints de troubles psychotiques parmi les détenus. En avril 2010 ouvre, au sein de l’hôpital du Vinatier de Lyon, une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), un hôpital prison, susceptible d’accueillir des personnes «souffrant de troubles psychiatriques et nécessitant une hospitalisation».
Psychiatres et psychologues dénoncent une confusion entre criminalité et troubles mentaux, et un pas de plus vers la suppression de l'irresponsabilité pénale qui empêche de condamner une personne malade. L’expression de ces troubles se manifeste parfois par des mutilations et des tentatives de suicide. Coupures au rasoir, ingestion d’objets durs, les automutilations viennent soulager une tension émotionnelle insupportable, explique C. de Beaurepaire. « Ton corps en prison devient un argument, témoigne Hugo, ex-détenu. T’as des gens qui vont se mutiler parce qu’ils n’ont plus d’autres moyens de faire avancer les choses. Moi ça m’est arrivé, tu t’ouvres les veines pour attirer l’attention sur toi (5). »
Communiquer avec l’extérieur
« En apportant l’air du dehors, on fait du bien et du mal (6) », explique Sylvie, une compagne de détenu. En détention, les liens avec l’extérieur, d’une importance capitale, se renforcent, se maintiennent, se distendent, ou se rompent. Au parloir, au téléphone, ou à travers la correspondance, le détenu n’est plus seulement un numéro d’écrou et un compagnon de cellule, mais il redevient un père, un fils, un époux, un ami. Mais ces échanges amènent aussi colère et frustration : trop courts, ils rappellent au détenu qu’il est dedans quand les siens sont dehors. G. Chantraine évoque par ailleurs un « décalage entre le temps carcéral et le temps de l’extérieur » qui amène questions et préoccupations : « Le reclus est-il au courant des avancées de l’affaire ? Tel courrier est-il parvenu ? La date de sortie présumée est-elle toujours la même ? »
Aux visites de parloir, pour lesquelles certaines familles parcourent des centaines de kilomètres, on échange du linge et des livres. Nombre de détenus font passer du courrier en sous-main, afin qu’il échappe à la censure pénitentiaire. À Noël, certains reçoivent de leur famille un colis de denrées alimentaires de cinq kilos : foie gras, fromage, chocolat… Une solidarité avec le détenu que certains proches conditionnent à son innocence, commente la sociologue Gwénola Ricordeau. « Si t’étais coupable, lance un père à son fils accusé de viol, on te prendrait pas au téléphone. »
Travailler
« Quand vous travaillez, vous êtes concentrés au boulot, et là vous ne pensez à rien. Si vous restez sans rien faire, vous ne vous sentez pas bien », raconte un détenu de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. Afin de gagner de quoi cantiner, et pour occuper les journées, les détenus qui le souhaitent peuvent demander à travailler. Deux options s’offrent à eux : le service général ou le travail en production. Dans le premier cas, les « gamelleurs » ou « auxiliaires » font le ménage et servent les repas. Le travail en production, quant à lui, est fourni par des entreprises qui installent leur atelier au sein de la prison, généralement en raison des faibles coûts de main-d’œuvre. Découpe de planche, emballage, montage de composants électroniques, pliage, collage, les tâches sont mécaniques et répétitives. Le travail carcéral n’est encadré par aucun contrat de travail. Aucun entretien, aucune obligation de rémunération minimum, aucune indemnité en cas de licenciement, de maladie ou d’accident du travail n’est prévu pour les détenus qui travaillent aux ateliers.
Dans un rapport 2011, l’Observatoire international des prisons (OIP) précise qu’« en 2010, les rémunérations nettes des personnes détenues n’ont pas dépassé, en moyenne, 318 euros par mois ». Parce qu’il offre l’opportunité de s’extraire six heures par jour de leur cellule, le travail reste malgré tout une denrée rare très prisée des détenus. Seuls 25 % d’entre eux y ont accès, ce qui permet à « l’administration pénitentiaire, analyse Philippe Auvergnon, directeur de recherche au CNRS, de se garder la possibilité via l’accès ou le retrait du travail d’un outil disciplinaire extrêmement important ».
Bricoler
Du dentifrice pour coller des photos et des affiches au mur. Une boîte de Ricoré en guise de porte-savon. Du jus de raisin, du sucre et de la mie de pain pour distiller du vin. En prison, il faut faire preuve d’ingéniosité pour pallier le manque de tout. Les astuces du système D se transmettent d’un détenu à l’autre, des anciens aux nouveaux arrivants. C. de La Condamine décrit dans son journal comment réchauffer de l’eau : il faut « apporter l’électricité des deux côtés d’un isolant (manche de brosse à dents). On plonge l’objet dans un seau d’eau (salée, ça marche mieux) et l’électrolyse du liquide le fait monter en température. » Improviser un réchaud, une bouilloire, c’est manger et boire chaud quand on le souhaite : autant de moyens de se réapproprier un mode de vie, un lieu, un emploi du temps. Mais une fois qu’ils l’ont investie et aménagée, beaucoup de détenus insistent sur le fait que cette cellule n’est pas la leur. Les mots sont importants. F. Ploquin rapporte les propos de Karim Mouloum, en prison pour braquage, aux matons « lorsqu’ils lui ordonnent de rentrer dans “sa” cellule. – Dans “votre” cellule !, réplique-t-il avant d’obtempérer. »
Avoir une vie sexuelle
En prison la sexualité n’existe pas, ou presque. Du moins, pas dans les programmes de l’institution pénitentiaire. « Le corps de procédure pénale qui régit la vie en détention ne mentionne à aucun moment le mot “sexe” ou le mot “sexualité”, explique le sociologue Arnaud Gaillard. Un article de loi parle de la protection de la pudeur et des dérives de l’obscénité. » Si beaucoup de détenus témoignent de la disparition de leur libido dès lors qu’ils sont entre les murs, elle se limite pour d’autres à une sexualité solitaire, à des pratiques homosexuelles avec des codétenus, ou à une sexualité dérobée aux parloirs quand les surveillants acceptent de « fermer les yeux ».
Hugo, libéré il y a un an après vingt-neuf ans de détention, raconte : « La seule sexualité que j’ai eue en prison pendant vingt-neuf ans, elle est passée à travers la pornographie. (…) Ça fait un an que je suis sorti, j’ai encore des problématiques. À un moment, j’avais une nana (…) mais t’as du mal aussi à accepter ses mains sur ton corps. T’es seul, même en sortant, t’es encore seul (7). »
Une « privation de l’altérité », selon les mots d’Arnaud Gaillard, à laquelle tentent de remédier les unités de visite familiale (UVF), expérimentées depuis 2003 sur le modèle canadien. Ces appartements privés mis à la disposition des détenus de longue peine pour y recevoir un conjoint leur permettent de se soustraire pour quelques heures au regard des autres. Mais au 1er janvier 2011, rapporte l’OIP, « seuls dix-sept établissements sur 191 en étaient en effet pourvus ».
Être puni
Pour les détenus récalcitrants au règlement carcéral, plane l’ombre des sanctions disciplinaires. Prétoire (commission disciplinaire), mitard (cellules du quartier disciplinaire), le détenu sait généralement ce qu’il risque s’il ne se tient pas à carreau. Le mitard, décrit C. de La Condamine, est une « cellule toute de béton, privée de cantines (…). Pas de briquet pour ne pas enflammer le fin matelas de mousse posé sur le ciment. L’isolement est complet, y compris pendant l’heure de promenade dans une cour de quinze mètres carrés, fermée même vers le ciel par un grillage. » Les détenus particulièrement signalés (DPS), qui ont tenté de s’évader, qui ont commis viols ou meurtres en détention, ou qui appartiennent au crime organisé font l’objet d’un traitement particulier et sont souvent placés à l’isolement.
En outre, de nombreux détenus dénoncent l’arbitraire du système pénitentiaire qui fait de la privation de leurs droits un levier de punitions officieuses. Le journaliste Arthur Frayer se souvient des propos de Saker, un détenu : « Surveillant, je vais vous dire, il y a deux prisons : la prison réelle, celle qui existe parce qu’on a fait des conneries ; on a été condamné et on paye pour ça, c’est normal ; et il y en a une deuxième : la prison dans la prison. Tous les petits trucs quotidiens qu’on nous fait subir pour rien : les parloirs Hygiaphone sans raison, les retards de promenade sans motif, et les surveillants qui sont jamais là, les délais sans fin, les plaques électriques cassées qui sont jamais réparées (8)… » À l’inverse, de meilleures conditions de détention deviennent une forme de récompense. Le centre de détention en régime ouvert , par exemple, censé garantir une meilleure réinsertion, est octroyé aux détenus qui ont eu un comportement exemplaire. Par manque de moyens matériels et d’objectifs clairs quant à la mission de la prison, l’administration pénitentiaire fait respecter l’ordre avant toute chose. Les « pointeurs », les condamnés pour des affaires de mœurs se trouvent ainsi placés à l’écart des autres prisonniers, et ne sortent que rarement. Les surveillants ferment les yeux sur les petits trafics ou les rapports sexuels aux parloirs, en principe interdits, mais qui génèrent du calme.
A. Frayer se souvient des paroles de surveillants qui jugeaient que son discours sur le rôle resocialisant de la prison était trop « Enap » (École nationale de l’administration pénitentiaire) : « La réinsertion, c’est pour les politiques et les bureaucrates. Ici, il faut juste veiller à ce que les voyous ne se barrent pas. » Des propos cyniques qui font écho aux analyses du sociologue G. Chantraine, pour qui l’organisation carcérale est une « organisation où finalité et fin se renversent : le contrôle des membres n’est plus le moyen d’obtenir une fin, il devient la fin ».
NOTES
(1) Gilles Chantraine, Par-delà les murs, Puf, 2004.
(2) Christophe de La Condamine, Journal de taule, L’Harmattan, 2011.
(3) Frédéric Ploquin, La Prison des caïds, Plon, 2011.
(4) Christiane De Beaurepaire, « Folie et misère en prison », Pratiques, n° 48, février 2010.
(5) Lemonde.fr, Le Corps incarcéré, webdocumentaire, 2009.
(6) Gwénola Ricordeau, Les Détenus et leurs proches. Solidarité et sentiments à l’ombre des murs, Autrement, 2008.
(7) Lemonde.fr, op. cit.
(8) Arthur Frayer, Dans la peau d’un maton, Fayard, 2011.
Céline Bagault - www.scienceshumaines.com