La concertation médiatique et la profusion de l’information contribue-t-elle à une meilleure connaissance des problèmes ? A une meilleure diffusion du savoir ? Contribue-t-elle à une amélioration du débat démocratique ? La surinformation favorise-t-elle l’information ou débouche-t-elle sur une désinformation ?

Dossier réalisé par l'écrivain et journaliste René Naba:
Ancien responsable du monde arabo-musulman au service diplomatique de l’Agence France Presse, ancien conseiller du Directeur Général de RMC/Moyen orient, expert chargé de l’information, est l’auteur notamment des ouvrages suivants: "Média et Démocraitie, La captation de l'imaginaire un enjeu du XXI me siècle", Golias Novembre 2012 -"Erhal (dégage), La France face aux rebelles arabes" Golias Novembre 2011. Il nous livre, dans cet article, un témoignage géopolitique poignant d'un long vécu aux services des médias, qui exercent une hégémonie quasi-totalitaire sur les différentes populations du monde...
Média et Démocratie ?
Le développement de la diffusion satellitaire, la multiplication des chaînes transfrontières et d’autres canaux de diffusion tels l’Internet (Web), le courrier électronique, le blog ou encore le fax ou le mobile (téléphone portable) ont porté les sociologues et analystes politiques à célébrer l’avènement d’une "société de l’information" comme la marque caractéristique du XXIeme siècle, l’échec du totalitarisme et le terme ultime de la démocratie néo-libérale.
Toutefois, le contrôle accru des grands conglomérats industriels sur les vecteurs d’information, l’importance prise par ailleurs par les stratégies de communication, au détriment de l’information proprement dite, l’endogamie croissante au sein du couple médias et politique de même que l’interactivité des divers acteurs au sein de ce même couple, tendent à relativiser ce premier constat au point que se pose la question de la viabilité d’un débat démocratique dans une société où les principaux vecteurs d’information sont dominés par les puissances d’argent et la promotion des intérêts privés.
Dans ce contexte, le langage, moyen de communication et d’échange par excellence, devient un marqueur d’identité culturel de par la terminologie empruntée ou l’accent utilisé par le locuteur.
L’effondrement d’une idéologie à dimension humaniste, utile contrepoids à l’hégémonie capitaliste, a accéléré cette évolution au point que le langage apparaît désormais comme un redoutable instrument de sélection et de discrimination, de domination et d’exclusion.
I- Le débat démocratique face à la profusion d’information
La société de l’information ou le village planétaire.
Jamais dans l’histoire de l’humanité, l’information n’a été si abondante et si instantanée au point que l’information mondialisée, abolissant les frontières physiques et linguistiques, a transformé la planète en un « village planétaire ».
Tous les grands évènements mondiaux se vivent dans une quasi communion universelle, (Mondial du foot, Jeux olympiques, les grandes catastrophes naturelles, telles le Tsunami en Asie en Décembre 2004, l’ouragan Katrina durant l’été 2005 au sud des Etats-Unis, de même que les deux guerres d’Irak en 1990 et 2003, ainsi que la destitution de la statue du président irakien Saddam Hussein, en avril 2003.
Depuis la révolution technologique opérée il y a vingt ans, des chaînes d’information continue ont supplanté les chaînes généralistes (CNN aux Etats-Unis, LCI, BFM, I-TELE et France info et France TV, en France) développant des programmes interactifs avec interventions des auditeurs téléspectateurs dans les débats politiques, induisant avant le terme un débat participatif.
L’exemple le plus manifeste, en France, s’est déroulé sur TF1 à l’occasion du débat sur le referendum constitutionnel, en avril 2005, entre le président Jacques Chirac et un panel de jeunes, ainsi qu’à l’occasion de la campagne présidentielle française de 2007 toujours sur TF1 dans l’émission « j’ai une question à vous poser », où le candidat à l’élection présidentielle était confronté pendant 90 minutes à un échantillon représentatif de la population française.
Même la presse écrite a opéré une mutation, couplant son édition papier par une édition électronique donnant ainsi la possibilité à un plus large lectorat, au delà les océans, d’accéder aux informations du journal.
En France, par exemple, les grands quotidiens parisiens peuvent être consultés électroniquement depuis l’Afrique ou l’Asie, contournant la censure généralement en vigueur dans les pays autoritaires. Dans le Monde arabe, où la censure est la norme, le quotidien « Al-Qods Al-Arabi » journal critique trans-arabe, offre quotidiennement l’hospitalité de ses colonnes à certains des principaux proscrits intellectuels arabes et contourne ainsi depuis Londres les restrictions édictées par les gouvernements arabes.
De même, à coté de la presse payante, une presse gratuite s’est développée dans les pays occidentaux accentuant l’offre d’information. En outre, un service de messagerie à la demande (à la carte) a été aménagé pour les usagers des téléphones portables.
A. Surinformation ou désinformation ?
Toutefois, la concertation médiatique, la profusion de l’information contribue-t-elle pour autant à une meilleure connaissance des problèmes ? A une meilleure diffusion du savoir ? Contribue-t-elle à une amélioration du débat démocratique ? La surinformation favorise-t-elle l’information ou débouche-t-elle sur une désinformation ?
Dans les années 1980, cinquante méga-compagnies dominaient le paysage médiatique aux Etats-Unis, mais, moins de dix ans plus tard, il n’en restait plus que vingt trois pour une domination comparable. « La vague des énormes marchés conclus dans les années 1990 et la mondialisation rapide ont laissé l’industrie médiatique centralisée en neuf conglomérats internationaux: AOL-TimeWarner, Viacom CBS, News corporation, Bertelsman (Allemagne), General Electric (NBC), Sony, ATT-LIBERTY Media et Vivendi Universal France.
Quatre d’entre eux (Disney, AOL Time Warner, Viacom et News corporation) contrôlent tout le cycle de la production (films, livres, magazine, journaux, programmes de télévision, musique vidéo, jeux) ainsi que la distribution (radio, câble, grandes surfaces, salles de cinéma multiplex) (1).
Mais cette concentration médiatique, pour impressionnante qu’elle soit avec les immenses possibilités de diffusion qu’elle recèle, contribue-t-elle à une amélioration de l’information du citoyen et du débat démocratique ?
La réponse ne saurait être tranchée à en juger par les déboires enregistrés tant par les Etats-Unis que par la France dans deux moments clés de leur histoire contemporaine:la guerre d’Irak pour les Etats-Unis et le referendum sur le traité constitutionnel par la France.
B. Les Etats-Unis et la guerre d’Irak.
Les Etats-Unis ont baigné dans une ferveur nationaliste cimentée par l’horreur des attentats anti-américains du 11 septembre 2001 contre les symboles de l’hyper puissance américaine, les tours jumelles (Twin Tower) de New York et le Pentagone à Washington. Cette ferveur a d’ailleurs été attisée par les médias avec leur longue évocation des scènes d’horreur et leurs commentaires conséquents.
Cette unanimité nationale a atteint son paroxysme lors de la guerre d’Afghanistan, en Octobre-Novembre 2001, engagée par les Etats-Unis avec la caution de l’ONU et perçue dans l’opinion américaine et internationale comme des représailles aux attentats du 11 septembre.
Cette unanimité s’est reproduite avec la même ferveur lors de la guerre d’Irak, engagée deux ans plus tard, en mars 2003, grâce notamment au travail de mobilisation de la presse américaine, quand bien même la guerre d’Irak a été engagée sans la caution des Nations-Unies.
Les grands médias américains ont longtemps relayé les thèses de l’administration néoconservatrice américaine avant de reconsidérer leurs positions avec les déboires militaires américains sur le terrain, le pillage du Musée de Bagdad, les tortures de la prison d’Abou Ghraib et les révélations sur les mensonges de la guerre (absence d’armes de destruction massive, lien du régime de Saddam Hussein avec l’organisation Al-Qaîda)
Une journaliste vedette du New York Times, Judith Miller, l’une des plus actives propagatrices de la thèse mensongère des armes de destruction massive en Irak, a été licenciée de son journal et de grands journaux tels le Washington Post et le New York Times ont publiquement reconnu leurs erreurs.
Il n’empêche les médias américains dans la guerre d’Irak ont été complices de la plus grande mystification de l’opinion publique relayant sans la moindre retenue et sur une longue période, la propagande de guerre du président George Bush jr.
La guerre d’Irak a démontré au grand jour la connivence entre le pouvoir politique et le monde médiatique, au détriment de la Démocratie.
C. La France et le référendum sur le traité constitutionnel.
Les dirigeants des principales formations politiques et la quasi totalité des grands commentateurs des grands médias se sont prononcés en faveur du Traité européen, stigmatisant l’archaïsme de ses opposants, quand bien même le texte soumis à référendum était long, touffu, confus et inaccessible au lecteur de base.
Les partisans du Oui, -grands patrons de presse et grands dirigeants politiques- ont été désavoués d’une manière manifeste, sans que soient remis en cause leur mode de fonctionnement.
Dans le cas de la France, si la connivence est aussi manifeste qu’aux Etats-Unis, le désaveu est plus marqué.
Contrairement aux Etats-Unis, les grands médias français, tels Le Monde ou TFI, n’ont jamais formulé la moindre autocritique, pas plus pour la guerre d’Irak que pour la campagne référendaire européenne ou la couverture de la précédente campagne présidentielle française, celle de 2002, où déjouant tous les pronostics, le chef de l’extrême droite française, Jean Marie Le Pen, chef du Front National, avait dangereusement supplanté, au premier tour des élections, le premier ministre Lionel Jospin, candidat du parti socialiste, éliminant la gauche de la première compétition majeure du XXI me siècle.
Jamais le Journal « Le Monde » ne s’est expliqué sur cette emphatique sentence décrétée par son ambitieux directeur selon laquelle « Nous sommes tous Américains » après les attentats anti-américains du 11 septembre. Nul non plus ne l’a interpellé sur ce pouvoir prescripteur qu’il s’est arrogé de se faire le porte-parole des Français, sans le moindre mandat électif.
Six ans après cette profession de foi, alors que l’Amérique s’enlise dans le bourbier irakien, M. Colombani a été déchargé de ses responsabilités, en juin 2007, par un vote de défiance des journalistes de son établissement s’opposant à la reconduction de son mandat.
Auparavant, Patrick Poivre d’Arvor, présentateur vedette de TFI, la plus importante chaîne télévisuelle d’Europe, a été convaincu de « bidouillage », manipulation de l’information, sans que cela n’entraîne le moindre discrédit. Poivre d’Arvor s’était abusivement attribué une interview du dirigeant cubain Fidel Castro, en substituant son image à celle de l’interview et en reformulant les questions afin de donner à l’entretien un cachet personnel.
Jean Marie Colombani et Patrick Poivre d’Arvor ont été cités dans des procès en relation avec l’affaire Pierre Botton, l’ancien gendre de l’ancien député chiraquien de Lyon, Michel Noir, sans que cela, non plus, n’entrave leur fulgurante carrière. PPDA a même été décoré, en mars 2007, de l’ordre du mérite, au rang de chevalier, par le ministre de la culture Renaud Donnedieu de Vabres, sans doute à titre de reconnaissance pour sa contribution à la déontologique journalistique.
De son côté Serge July, fondateur de l’ancien journal de gauche « Libération », plutôt que de s’interroger sur sa fausse perception de la société française, a laissé percé son dépit après l’échec du referendum constitutionnel européen, en Mai 2005, fustigeant ses compatriotes de tous les maux, sans la moindre critique à l’égard de l‘élite dirigeante qui avait établi un texte long et complexe.
Sans chercher à faire œuvre de pédagogie politique sur la portée et la signification de la construction européenne, ou même sans chercher à mettre en cause le président Jacques Chirac pour sa manœuvre démagogique qui avait instrumentalisé l’enjeu européen et le référendum constitutionnel pour rebondir sur la scène politique locale après ses déboires électoraux.
Ainsi donc, deux fois, en cinq ans, la classe politico-médiatique française a été désavouée, sans que cela n’entraîne une réforme des rapports entre le Pouvoir politique et les Médias au point qu’une tendance à l’endogamie paraît se développer à en juger par le nombre de mariages croisés entre politiciens et journalistes.
« Les Médias français se proclament et se vivent comme un « contre pouvoir ». Mais « la presse écrite et audiovisuelle est dominée par un journalisme de révérence, par des groupes industriels et financiers, par une pensée de marché, par des réseaux de connivence ( ... ) Alors, dans un périmètre idéologique minuscule, se multiplient les informations oubliées, les intervenants permanents, les notoriétés indues, les affrontements factices, les services réciproques ( ... ) un petit groupe de journalistes omniprésents – et dont le pouvoir est conforté par la loi du silence- impose sa définition de l’information-marchandise à une profession de plus en plus fragilisée par la crainte du chômage. Ces appariteurs de l’ordre sont les nouveaux chiens de garde de notre système économique ».
Le constat, féroce, s’apparente, par moments, à la réalité. Il a été dressé par un journaliste du mensuel Le Monde diplomatique » Serge Halimi, dans un opuscule au titre ravageur, « Les Nouveaux Chiens de Garde », Editions « Raisons d’agir », 2eme édition-2005.
La forme la plus achevée de l’imbrication du journalisme au pouvoir politique aura été le journalisme embarqué « embedded », littéralement dans le même lit, durant la Guerre d’Irak. Cette proximité a été jugée malsaine par bon nombre des membres de la profession car elle faussait l’esprit critique dans la mesure où le journaliste était littéralement incorporé au sujet de son observation, sans la moindre distanciation.
En immersion totale avec son sujet et le combat de son colocataire du char, sa capacité d’appréciation était immanquablement biaisée. Cette technique a réussi à retarder, sans totalement l’annuler, l’appréciation objective d’une politique, comme ce fut le cas lors de l’invasion américaine de l’Irak, en mars 2003.
(Pour ce qui est de la France, cf à ce propos l’article du même auteur « Média et Démocratie I De la consanguinité entre Politique et Média en France ou « l’embedded à la française ».)
http://renenaba.blog.fr/2007/09/06/p2935657#more2935657
II) Les Chiffres de la publicité et le neuro-marketing
La communication tend à se substituer à l’information et ses dérives nous renvoient à la propagande de base des régimes totalitaires que les pays démocratiques sont censés combattre. « Spin doctor’s », c’est le nom que l’on donne aux Etats-Unis et au Royaume uni à ses « maîtres de l’embobine » chargés de gérer l’opinion publique.
A la fin des années 1990, le budget américain de l’industrie des relations publiques a dépassé celui de la publicité. Selon une étude de John Stauber et Sheldon Rampton, qui passent pour être les meilleurs spécialistes de la profession et co-auteurs d’un remarquable ouvrage sur la question (Toxic sludge is good for you- Common Courage presse 1995), le nombre des salariés des agences des relations publiques (150.000) dépasse celui des journalistes (130.000).
Aux Etats-Unis, 40 pour cent de ce qui est publié dans la presse est directement reproduit, sans altération, des communiqués des « Public relations » (3) soutient Paul Moreira, producteur de l’émission de référence de Canal + et auteur d’un ouvrage documenté sur « Les nouvelles censures- dans les coulisses de la manipulation de l’information » (Editions Robert Laffont février 2007).
Deux chiffres suffisent à caractériser l’Empire des Médias : il vit aux deux tiers de la publicité, et il dépense chaque année deux fois le budget de l’état français. Au niveau mondial, le chiffre d’affaires mondial de la télévision, hors subventions, est voisin de 220 milliards de dollars en 2006, dont environ 160 milliards financés par la publicité, soit 70%.
Le chiffre d’affaires mondial des journaux et magazines est voisin en 2006 de 275 milliards de dollars, dont environ 175 milliards financés par la publicité, soit 65%, en augmentation, avec un maximum de 88% aux Etats-Unis. En ajoutant les radios, cela fait environ 540 milliards de dollars par an, soit presque deux fois les dépenses annuelles de l’état français.
« Entertainment » (divertissement) comme outil et « advertising » (publicité) comme finalité. Le but n’est pas d’informer, mais d’attirer assez l’attention pour faire passer le vrai produit : la publicité. L’« information » là-dedans est un excipient comme un autre, dont le but n’est pas d’informer mais d’attirer l’attention et de véhiculer des messages publicitaires.
L’information devient « infotainement », une information de divertissement. Ce qui explique en France que les grandes émissions politiques des précédentes décennies, comme l’ « Heure de vérité » sur France 2, faite par des journalistes, a depuis longtemps cédé la place aux émissions de divertissement. Les hommes politiques préfèrent, et de loin, passer chez les animateurs Michel Drucker ou Marc Olivier Fogiel pour promouvoir leurs idées.
Le temps de cerveau disponible du lecteur ou téléspectateur humain ingurgite chaque année pour 400 milliards de dollars américains de messages intéressés. Emis par qui ? Sur les 360 milliards fournis aux anciens médias par la publicité, selon ce document du groupe Lagardère, 160 milliards, soit 44%, sont « attribués » par les sept premiers groupes de publicité, qui font un chiffre d’affaires direct d’environ 50 milliards.
La captation de l’imaginaire et le conditionnement psychologique des consommateurs se fait à un âge de plus en plus précoce. Selon une étude d’une équipe de chercheurs de l’Université de Stanford (Californie), 48 pour cent des enfants âgés entre 3 et 5 ans sont conditionnés par la publicité dans leur goût alimentaire.
Le directeur de l’équipe, le Docteur Thomas Robinson, chef du département de pédiatrie à la Faculté de médecine de Stanford, dont les conclusions ont été publiées, en Août 2007, dans la revue « The Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, préconise de « réguler voire de bannir la publicité et le marketing des produits hautes-calories et à faible valeur nutritionnelle, ou d’interdire tout marketing visant directement les jeunes enfants ». D’autant, estiment les chercheurs, qu’une telle pub est « par essence déloyale » (inherently unfair), parce que « les moins de 7/8 ans sont incapables de comprendre les visées persuasives de la publicité ».
Avec le lancement de la campagne présidentielle française, en 2007, les publicitaires ont affiné leurs recherches et leur ciblage. Ils se livrent désormais au « Neuromarketing », une technique qui permet de déterminer la combinaison média idéale qui permettre la meilleure pénétration du message. En gros, quels médias choisir pour que ma publicité rentre bien la tête du consommateur.
Dans le jargon professionnel, l’étude peut déterminer l’impact d’un message publicitaire sur la « mémoire explicite » (la mémoire consciente) ainsi que sur la « mémoire implicite », ce que le cerveau enregistre à l’insu de la personne.
Certes, la multiplication des sources d’information est la garantie de la démocratie car elle permet la formation d’une opinion libre par recoupement des connaissances.
Mais la profusion des vecteurs hégémoniques dans leur approche globalisante, (avec le contrôle du contenant et du contenu, la production et la distribution)porte en elle le risque d’un dévoiement de la démocratie, par les manipulations que les opérateurs du champ médiatique sont tentés de procéder en vue de la satisfaction d’objectifs personnels qui peuvent se révéler, par contrecoup, fatal tant pour la liberté de pensée que pour la démocratie.
III- Le Langage comme marqueur d’identité culturelle ou la guerre sémantique
"Le langage est un marqueur d’identité culturelle de la manière que les empreintes digitales, le code génétique, les mesures anthropométriques sont des marqueurs biologiques et physiques. L’accent, l’usage des termes, le ton révèlent l’identité culturelle de l’être."
Sous une apparence trompeuse, (des termes généraux, lisses et impersonnels,) le langage est codifié et pacifié. Il devient alors un redoutable instrument de sélection et de discrimination.
Un Plan social renvoie à une réalité immatérielle contrairement au terme douloureux de licenciement massif.
De même qu’ « externalisation et sous traitance » à des opérateurs fonctionnant en dehors des normes de la législation sociale ou encore « Délocalisation » et Optimiser rendement en exploitant une main d’œuvre bon marché et surexploitée des pays pauvres et souvent dictatoriaux, sans la moindre protection sociale, ou enfin « Privatisation » opération qui consiste souvent à transférer à des capitalistes d’entreprises du service public souvent renflouées par les deniers publics, c’est-à-dire les contribuables.
Même au niveau du discours politique le langage est aseptisé au point que l’ancien premier ministre socialiste Pierre Mauroy avait reproché au candidat socialiste aux présidentielles de 2002, Lionel Jospin, d’avoir gommé dans son discours le terme de « travailleurs ». Dans le langage convenu l’on préfère le terme pudique de « Gens de condition modeste » à celui plus parlant de « pauvres » de même pour le tandem « Exclus et « exploités ». Ou encore Classes (qui suggère idée de lutte) et couches sociales. Couches comme couches de peinture.
Le langage est connoté. Le seul licite est le LQR « Lingua Quintae Respublicae » (4), le langage en vogue sous la Vme République Française, homologué, estampillé. Gare à quiconque recourt à un langage personnalisé, forgé dans un vocabulaire qui lui est propre. L’homme risque l’ostracisme, aussitôt mis à l’index, affublé d’une tare absolue, irrémédiable : « ringard », « tricard », etc…..
La Langue substitue aux mots de l’émancipation et de la subversion, ceux de la conformité et de la soumission. L’on prône la fléxibilité au lieu de la précarité, dans un pays qui a érigé la rente de situation en un privilège à vie, notamment au sein de la haute fonction publique. Les Enarques ont une rente de situation à vie, mais quiconque ose relever cette incongruité est accusé de faire le lit du « populisme ».
Il en est de même au niveau diplomatique : Problème du Moyen Orient ou Question d’Orient.
Pour un problème, la réponse est unique, le problème ouvre la voie à des experts qui doivent techniquement apporter la solution. Mais la question d’Orient est plus floue. Une question suggère des réponses multiples, et induit l’absence de solution immédiate. Selon que vous utilisez un terme ou l’autre vous serez classé « moderne et dynamique » ou « ringard ».
Un exemple « Le Figaro » du 28 Août 2004 titre en manchettes « L’aveu du président Bush », sans que le journal ne précise en quoi consistait cet aveu, à propos de quoi. Dix ans auparavant, tout autre journal complaisant aurait titré :« Le président Bush admet son échec dans ses prévision sur l’Irak ». Mais si par malheur un journaliste audacieux avait titré la stricte vérité « Bush, le grand perdant de la guerre d’Irak », vous serez aussitôt accusé d’« anti-américanisme primaire ».
La « Novlangue » résulte de la présence de plus en plus manifeste de décideurs- économistes et publicitaires- dans le circuit de la communication, assurant une installation en douceur de la pensée néo-libérale.
Guerre psychologique autant que guerre sémantique, la guerre médiatique, vise à soumettre l’auditeur récepteur à la propre dialectique de l’émetteur, en l’occurrence la puissance émettrice en lui imposant son propre vocabulaire, et, au delà, sa propre conception du monde.
Si la diffusion hertzienne est la moins polluante des armes sur le plan de l’écologie, elle est, en revanche, la plus corrosive sur le plan de l’esprit. Son effet est à long terme. Le phénomène d’interférence opère un lent conditionnement pour finir par subvertir et façonner le mode de vie et l’imaginaire créatif de la collectivité humaine ciblée.
Nulle trace d’un dégât immédiat ou d’un dommage collatéral. Point besoin d’une frappe chirurgicale ou d’un choc frontal. Dans la guerre des ondes règne le domaine de l’imperceptible, de l’insidieux, du captieux et du subliminal. Qui se souvient encore de « Tal Ar-Rabih » (La colline du printemps) ?
Près d’un siècle d’émissions successives et répétitives a dissipé ce nom mélodieux, synonyme de douceur de vivre, pour lui substituer dans la mémoire collective une réalité nouvelle. “Tal AR-Rabih” est désormais mondialement connu, y compris au sein des nouvelles générations arabes, par sa nouvelle désignation hébraïque, Tel Aviv, la grande métropole israélienne. Le travail de sape est permanent et le combat inégal.
Il en est de même des expressions connotées : L’extermination d’une population en raison de ses origines s’appelle en français « génocide ». (génocide arménien en Turquie, génocide des tutsus au Rwanda). Lui préférer l’expression hébraïque du terme biblique de « Shoah » (holocauste) signe son appartenance au camp pro-israélien.
Israël n’a jamais reconnu le caractère de « génocide » aux massacres des Arméniens en Turquie au début du XX me siècle, sans doute pour marquer le caractère unique des persécutions dont les Juifs ont été victimes en Europe. D’abord en Russie, les « pogroms » de la fin du XIX me siècle, puis en Allemagne et en France durant la Seconde Guerre mondiale (1939-45).
Il en est aussi des termes antisémitisme et antiracisme. Arabes et Juifs sont des sémites, mais l’anti-sémitisme ne concerne que les Juifs, pour se distinguer des autres, alors que l’anti-racisme englobe Arabes, Noirs, Musulmans, Asiatiques etc.).
Le Président Jacques Chirac, lui-même, en fustigeant « l’antisémitisme et le racisme » dans son discours d’adieu, le 27 mars dernier, a consacré dans l’ordre subliminal un racisme institutionnel.
Jusqu’à présent, les pays occidentaux en général, les Etats-Unis en particulier, auront exercé le monopole du récit médiatique, un monopole considérablement propice aux manipulations de l’esprit, qui sera toutefois brisé à deux reprises avec fracas avec des conséquences dommageables pour la politique occidentale : la première fois en Iran, en 1978-79, lors de la « Révolution des cassettes » du nom de ces bandes enregistrées des sermons de l’Imam Ruhollah Khomeiny du temps de son exil en France et commercialisées depuis l’Allemagne pour soulever la population iranienne contre le Chah d’Iran,
La deuxième fois à l’occasion de l’Irangate en 1986, le scandale des ventes d’armes américaines à l’Iran pour le financement de la subversion contre le Nicaragua, qui a éclaté au grand jour par suite d’une fuite dans un quotidien de Beyrouth « As-Shirah », mettant sérieusement à mal l’administration républicaine du président Ronald Reagan.
Hormis ces deux cas, les Etats-Unis auront constamment cherché à rendre leurs ennemis inaudibles, au besoin en les discréditant avec des puissants relais locaux ou internationaux, tout en amplifiant leur offensive médiatique, noyant les auditeurs sous un flot d’informations, pratiquant la désinformation par une perte de repères due à la surinformation en vue de faire des auditeurs lecteurs de parfaits « analphabètes secondaires », pour reprendre l’expression de l’allemand Hans Magnus Einsensberger (5)
Non des illettrés, ou des incultes, mais des êtres étymologiquement en phase de processus de « désorientation », psychologiquement conditionné et réorienté dans le sens souhaité. Pur produit de la phase de l’industrialisation, de l’hégémonie culturelle du Nord sur le Sud, de l’imposition culturelle comme un préalable à l’envahissement et à l’enrichissement des marchés, « l’analphabète secondaire n’est pas à plaindre. La perte de mémoire dont il est affligé ne le fait point souffrir. Son manque d’obstination lui rend les choses faciles.
Une inversion radicale du schéma économique se produit et la loi de l’offre et de la demande se décline désormais selon un mode radicalement différent : la fabrication du désir de consommation détermine désormais l’activité d’une entreprise. Ce n’est plus le consommateur qui commande le rythme de la production mais le producteur qui orchestre désormais le désir de consommation. Le contrôle de l’appareil de production parait compter désormais moins que la maîtrise de la demande de consommation.
Le citoyen actif cède ainsi le pas au consommateur passif, l’aventurier de l’esprit au télé phage, le journaliste à l’animateur de divertissement, le patron de presse au capitaliste, entraînant du coup le glissement du journalisme vers le règne de l’« infotainement » néologisme provenant de la contraction de l’information et de l’entertainement (terme américain de divertissement). La mondialisation des flux d’information permet ainsi la mise sous perfusion éditoriale d’un organe de presse et par voie de conséquence la sédentarisation professionnelle de l’information, stade ultime de l’anaphabétisme secondaire.
Toutefois ce viol du monde par la publicité et la propagande par la profusion des sons et des images, dans le paysage urbain, sur les écrans dans la presse, au sein même des foyers, se heurte à des résistances éparses mais fermes.
De même que le monopole du savoir par la technocratie est battu en brèche, sur le plan international, par des contrepouvoirs notamment les acteurs paraétatiques (Greenpeace, Médecins sans frontières, Confédération paysanne), démultipliant les sources d’information non contrôlées, de même l’informatique a développé au niveau de l’information une sphère d’autonomie contestataire à l’ordre mondial américain.
Chaque percée technologique s’est accompagnée d’une parade. A la cassette du temps de la révolution khomeyniste, a succédé le fax puis les sites Internet enfin le blog, le journal électronique en ligne, dont le développement s’est accéléré depuis la guerre d’Irak et la dernière campagne présidentielle de George Bush jr (2004), des parades qui retentissent comme la marque d’une revanche de l’esprit contestataire et de la sphère de la liberté individuelle, en réaction au matraquage de la propagande et la concentration capitalistique des médias.
BIBLIOGRAPHIE
1- Noam Chomsky et Edward Herman « The manufacturing consent–La Fabrique de l’Opinion publique, la politique économique des médias américains » Ed. Le Serpent à plumes (2003) ».
2- Serge Halimi « Les Nouveaux Chiens de Garde », éditions « Raisons d’agir », 2me édition-2005.
3- Paul Moreira, producteur de l’émission de référence de Canal + et auteur d’un ouvrage documenté sur « Les nouvelles censures- dans les coulisses de la manipulation de l’information » (Editions Robert Laffont février 2007).
Nota bene : l’ouvrage de John Stauber et Sheldon Rampton (Toxic sludge is good for you- Common Courage presse 1995) est cité dans le livre de Paul Moreira cf supra.
4- LQR « Lingua Quintae Respublicae », par Eric Hazan, éditions « raisons d’agir »-2006
5- « Analphabètes secondaires », l’expression est de l’allemand Hans Magnus Enzensberger, auteur de « Médiocrité et folie » Editions Gallimard-1991. cf à ce propos « Aux ordres du Nord, l’ordre de l’information » de Jacques Decornoy dans le bimestriel du journal Le Monde « Manière de voir » N°74 « les 50 ans qui ont changé notre Monde ».
Source: http://oumma.com/




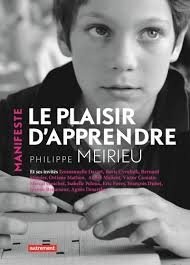 A qui ce livre est-il destiné ? Au jeune prof qui entre dans le métier et qui y trouve l'écho de son engagement ? Au professeur chevronné qui y verra aussi l'écho de ses réflexions et de son expérience ? Avec cet ouvrage, Philippe Meirieu publie un bel ouvrage qui invite au plaisir d'apprendre.
A qui ce livre est-il destiné ? Au jeune prof qui entre dans le métier et qui y trouve l'écho de son engagement ? Au professeur chevronné qui y verra aussi l'écho de ses réflexions et de son expérience ? Avec cet ouvrage, Philippe Meirieu publie un bel ouvrage qui invite au plaisir d'apprendre. Sans doute un peu tout cela. Mais, plus largement, nous assistons, je crois, à ce que Marcel Gauchet – que j’interroge dans le livre – nomme « l’inversion capitale de notre histoire culturelle récente » : que faire de savoirs qui « prennent la tête » dans une société qui aspire d’abord à « prendre son pied » ? C’est cela qui me frappe fortement aujourd’hui : même les méthodes prônées depuis l’Éducation nouvelle pour « donner du sens aux savoirs » - les « méthodes actives » ou la « pédagogie du projet » - tombent souvent à plat sur des élèves pour lesquels l’ « apprendre » n’est source que d’ennui, de difficultés, voire de souffrances. Certains, bien sûr, parviennent à trouver du plaisir dans tel ou tel exercice, telle ou telle discipline ; d’autres savent qu’il faut faire des sacrifices et que le plaisir est au bout du chemin, dans une réussite scolaire ou professionnelle future : c’est pourquoi ils concèdent des efforts, mais sans enthousiasme et en pensant que c’est un « mauvais moment nécessaire à passer ». Mais les premiers comme les seconds, de toutes façons, ne sont pas équitablement répartis dans le champ social ! C’est une banalité de dire que la motivation pour la grammaire ou la biologie, pour Hésiode ou la loi de Joule n’est pas spontanément partagée par tous les enfants et les adolescents, indépendamment de leur origine sociale ou de leur histoire personnelle… Or, la chose est d’autant plus problématique qu’on cherche aujourd’hui à « refonder l’école », qu’on veut la « démocratiser », lutter contre les injustices sociales et contrecarrer les effets délétères de l’inflation publicitaire comme de la démagogie de certains médias. Si nous ne voulons pas abandonner nos enfants à la sous-culture des « joueurs de flûte » qui les traitent essentiellement comme des « cœurs de cible », il faut bien se reposer la question du « plaisir d’apprendre » et de la manière d’en faire un plaisir véritablement accessible et partagé.
Sans doute un peu tout cela. Mais, plus largement, nous assistons, je crois, à ce que Marcel Gauchet – que j’interroge dans le livre – nomme « l’inversion capitale de notre histoire culturelle récente » : que faire de savoirs qui « prennent la tête » dans une société qui aspire d’abord à « prendre son pied » ? C’est cela qui me frappe fortement aujourd’hui : même les méthodes prônées depuis l’Éducation nouvelle pour « donner du sens aux savoirs » - les « méthodes actives » ou la « pédagogie du projet » - tombent souvent à plat sur des élèves pour lesquels l’ « apprendre » n’est source que d’ennui, de difficultés, voire de souffrances. Certains, bien sûr, parviennent à trouver du plaisir dans tel ou tel exercice, telle ou telle discipline ; d’autres savent qu’il faut faire des sacrifices et que le plaisir est au bout du chemin, dans une réussite scolaire ou professionnelle future : c’est pourquoi ils concèdent des efforts, mais sans enthousiasme et en pensant que c’est un « mauvais moment nécessaire à passer ». Mais les premiers comme les seconds, de toutes façons, ne sont pas équitablement répartis dans le champ social ! C’est une banalité de dire que la motivation pour la grammaire ou la biologie, pour Hésiode ou la loi de Joule n’est pas spontanément partagée par tous les enfants et les adolescents, indépendamment de leur origine sociale ou de leur histoire personnelle… Or, la chose est d’autant plus problématique qu’on cherche aujourd’hui à « refonder l’école », qu’on veut la « démocratiser », lutter contre les injustices sociales et contrecarrer les effets délétères de l’inflation publicitaire comme de la démagogie de certains médias. Si nous ne voulons pas abandonner nos enfants à la sous-culture des « joueurs de flûte » qui les traitent essentiellement comme des « cœurs de cible », il faut bien se reposer la question du « plaisir d’apprendre » et de la manière d’en faire un plaisir véritablement accessible et partagé.








