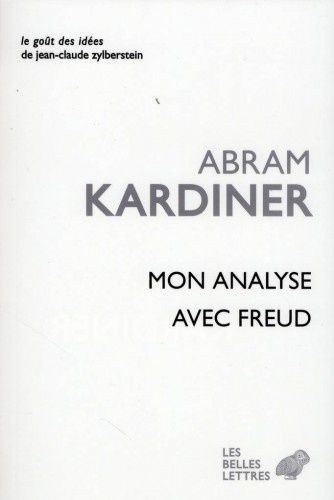" La philosophie n'a, ne peut avoir aucune utilité pratique", peut-on entendre dire après la critique de Nietzsche :
"Si toute pratique moderne de la philosophie est cantonnée dans un faux-semblant érudit, et ce d'une façon politique et policière qui est le fait des gouvernements des Eglises, des Universités, des modes et de la lâcheté humaine, la philosophie a perdu sa justification ; c'est pourquoi l'homme moderne, pour peu qu'il fût courageux et honnête, devrait s'en débarrasser et la bannir à peu près dans les mêmes termes que ceux dont Platon s'est servi pour renvoyer de sa cité les poètes tragiques."

On peut vivre sans philosopher, et la philosophie ne permet pas de vivre, ne promet rien, même si elle apprend tout, pense-t-on. Cela invite à s'interroger sur la question. Pourquoi continuer à faire de la philosophie aujourd'hui ? Ne serait-elle pas une activité culturellement dépassée, sans effet ni portée dans les contextes actuels probablement de plus en plus difficiles de vie ? Qui pourrait alors avoir intérêt à en défendre la cause, et pourquoi, sinon à la faveur d'un certain conservatisme social, en matière éducative en particulier ? La position de celui qui se heurte à une telle question est toujours inconfortable.
La philosophie, il serait parfaitement fondé de l'affirmer, apparaît aujourd'hui au premier abord comme un luxe inutile, ou comme un jeu gratuit pour l'esprit, dans une société par ailleurs pétrie d'efficacité scientifique et technique, ayant depuis longtemps dissocié le savoir de la sagesse pour l'ériger en soutien de pouvoir. Laquelle efficacité, précisément, tendrait à homogénéiser la totalité des pratiques individuelles et collectives d'après ses propres normes, centrées autour d'une prétendument nécessaire adaptation au marché, introduisant ces illusions propres à notre époque de la participation, de la concertation, de la qualité de la vie, cristallisées dans la défense des exclus, des minorités, de la démocratie ou de l'environnement, dont on ne pourra pas ne pas relever le saisissant contraste avec la désaffection présente pour le politique, de manière générale la méfiance de principe à l'égard de tout projet. Elle n'a aucune fonctionnalité qui lui soit propre. De surcroît, en tant qu'ensemble de contenus de penser déterminés, elle se trouve manifestement dévalorisée au même titre que les autres éléments de la culture, ou de la formation traditionnelle de l'esprit.
La philosophie n'est plus aujourd'hui un savoir ou une science, ce qu'elle a désormais renoncé à être, mais sans cesser d'être ce qu'elle est sur le fond: une démarche réflexive et critique d'abord, laquelle, en se débarrassant de ses contenus affectifs sans abandonner l'essentiel, s'est elle-même instituée en discipline spécialisée, par ses méthodes. Il y a sans doute ici une contradiction avec ce qui en constituerait l'élément essentiel: la liberté du penser dont l'esprit libre serait le refuge en même temps que le dernier représentant, par opposition aux savoirs constitués instituant les autres disciplines. Si la philosophie n'est plus elle-même qu'une certaine discipline parmi d'autres, par ailleurs déterminées, elle n'aurait plus en effet qu'à accepter de devenir une science, mais une science sans contenus ni objet, ce qui reviendrait pour elle à accepter sa propre disparition. Au contraire, la philosophie est au centre de toutes les autres disciplines et en est l'élément moteur. Inconsciemment, tout chercheur libre et indépendant est enclin à philosopher, à savoir le comment et à chercher le pourquoi. Sinon sa science ne lui appartient plus et il n'est plus qu'un rouage dans la grande mécanique que personne ne maîtrise réellement. C'est bien le drame de notre société quand le pouvoir tent à séparer les tâches et à collectiviser la responsabilité. C'est donc une science humaine en quête de sens.
La vocation critique de la philosophie
Si la philosophie se refuse à se constituer en un savoir spécialisé, c'est qu'elle s'affirme dans son autonomie propre en face d'une conscience devenue prédominante, exigeant toujours davantage de techniques qui puissent servir à une maîtrise effective du monde, de la vie, ou encore des individus eux-mêmes. La fausse neutralité affirmée de la science la réduit à une pure technique, utilisable pour n'importe quelle fin. Et c'est le pouvoir du chef qui va devenir démesurément grand, dangereusement fort. De simples doctrines on attend qu'elles aient réponse à tout. Devant la difficulté de la discipline, on admet le plus souvent la nécessité d'un apprentissage du travail de la pensée, mais sans éprouver la contradiction avec l'affirmation de l'équivalence des opinions à laquelle elle ne pourrait échapper. Avec la philosophie, on a certes toujours affaire à une pensée personnelle mais reposant sur la raison.
L'interchangeabilité des pensées, à teneur chosale, serait le critère de la science. Et si des incursions dans le concret la font dévier, elle ne se caractérise plus alors comme effort conceptuel, n'est plus une réelle discipline, mais rien d'autre qu'une idéologie périmée dont on pourrait s'abstenir de faire le choix. Toujours subsistent des représentations spontanées particulières liées à la prédominance d'un mode de production au sein d'un secteur déterminé de la vie sociale, des représentations sociales communes en même temps que de plus singulières, doublant les rapports sociaux - la vérité de la société - dans lesquels les individus se trouvent engagés. Comme par contraste, sans méconnaître le caractère social de la conscience, la dialectique s'est voulue la tentative, pour une critique immanente, de dépasser l'arbitraire de la pensée opérant à partir de simples points de vue, d'opinions ou d'idées reçues. C'est le propre d'une pensée technocratique que d'y rester confinée. Et la philosophie ne peut réellement être que dialectique, en admettant que le reste serait construction préphilosophique d'un sens. La légalité de la pensée invite à penser contre soi-même sans se perdre pour autant.
Dissiper l'illusion d'une objectivité constitutive peut être envisagé, paradoxalement, avec la force du sujet individuel. C'est qu'en réalité la subjectivité s'explique, non à partir d'elle-même - le penser -, mais du facticiel - la société, cette dernière correspondant tout autant à un ensemble de sujets individuels qu'à leur négation comme tels. A l'opposé, l'objectivité de la connaissance ne peut quant à elle être envisagée sans penser, c'est-à-dire sans subjectivité. On peut encore affirmer que toute réalité est toujours appréhendée dans une perspective humaine, soit l'impossibilité d'accéder à une connaissance objective des faits, la subjectivité étant toujours socialement préformée. Rien ne se donne à saisir de manière immédiate, tout est construit: l'interprétation, laquelle en est indissociable, oriente la saisie du fait; les éléments du réel ne devenant effectivement compréhensibles qu'à partir du moment où on les isole par la pensée en tant que moments singuliers, où on les singularise du tout, ce qui ne peut être le fait que d'un sujet, individuel ou collectif.
Quel pourrait être alors l'objet propre de la philosophie, sinon la critique des prétendus savoirs, des systèmes de pensée et de l'esprit de système, des attitudes collectivement partagées, dont la naturalité, l'immédiateté ou l'objectivité se trouveraient ordinairement affirmée alors même qu'ils seraient dans la continuité d'une idéologie, ou historiquement et socialement constitués ? " Notre destin, ce sont nos passions ", affirmait déjà Epicure, avec l'esprit de la révolte contre toute tentative de soumettre l'individu à un ordre n'ayant rien de naturel, soumettant les besoins aux lois "naturelles" de la production. En ce sens, toute philosophie ne serait rien d'autre qu'une anthropologie critique. Elle exprimerait cette tension irréductible entre le désir pour la vérité - l'étymologie en fait de manière significative une théorie érotique - et l'attitude fondamentalement subversive de toute vérité possible ouvrant l'espace propre de la réflexion critique. Ce qui ne signifierait rien d'autre que ceci: la philosophie n'a pas d'utilité - à proprement parler, elle ne sert à rien -, ne saurait en avoir une. Mais elle resterait indispensable en tant que critique, force de résistance de la pensée contre la simple volonté de puissance pour toujours rester maîtresse d'elle-même, permettant de dénoncer toute forme d'adhésion irréfléchie ou d'acquiescement aveugle à quelque autorité que ce soit: de la nature, de l'évidence première, de la bienséance, de la morale, de la compétence, etc., ou du discours, celui du Maître.
Négation ou résistance du penser contre ce qui est imposé ou " s'impose ", c'est-à-dire irait de soi. En ce sens, et dans nos sociétés, elle n'apparaît, ni plus ni moins, que comme le dernier refuge de la liberté de l'individu. Elle ne saurait se renouveler qu'en se confrontant constamment à son objet, lui-même en mouvement, ouvertement et de manière cohérente, sans se laisser prescrire les règles d'un savoir organisé, perçant tout ce que la société a recouvert sur cet objet, forgeant pour ce faire ses concepts, sur le fondement d'une expérience toujours singulière. Le fanatisme réducteur, celui de la science, de la logique à tout prix, de la simplicité, de l'élémentaire, ne lui appartient pas. La référence à la science, à ses règles, à la validité exclusive des méthodes qu'elle a développées, réprime la pensée libre, c'est-à-dire non conditionnée. La liberté du penser signifie aussi la possibilité d'expression de sa non liberté, là où émerge davantage que l'expression: une vue-du-monde préformée et imposée.
L'insertion sociale de la critique
Si, tout comme l'individu qui en est sous un certain aspect l'origine, la philosophie est elle-même engagée dans la totalité sociale, son autonomie en tant que réflexion critique ne pourrait être que toute relative. Il est même possible que l'autonomie en question ne soit qu'illusion. Ce qui signifierait peut-être, ici encore, la fin de la philosophie. Quoi qu'on en pense, c'est de la possibilité même d'une telle réflexion dont il serait ici question. La totalité sociale, dont l'objectivité affirmée ne serait rien d'autre qu'un a priori parmi d'autres de la raison subjective connaissante, ne peut être décrite comme s'il s'agissait d'un fait. Elle a cessé d'être effectivement intelligible, au sens où la con-naissance ne peut jamais ici espérer atteindre son objet qui toujours lui échappe. Il convient ici d'admettre, à titre d'hypothèse, qu'essentiellement négative, la société pénètre, réifie, intègre toute opposition comme les rapports entre les individus, produisant, en même temps que ses fausses autonomies, les idéologies par lesquelles elle se protège contre la critique de son irrationalité. Préordonnée aux individus qui en subissent les multiples contraintes en même temps qu'ils la représentent, elle réprimerait par avance ce qui n'est pas semblable à soi, et la possibilité même de la critique par l'affirmation des exigences de la raison. Ses "rationalisations" produites ne seraient pour autant rien d'autre, conformément au sens freudien, que le signe d'un anti-intellectualisme devenu prédominant.
"Être idiot et avoir du travail, voilà le bonheur" (G. Benn). Aller à l'école de la vie, sacrifier aux contraintes du système: la "rationalité" du capital et sa violence se révèlent déterminantes pour la raison de l'individu isolé. En témoigneraient les réalités devenues de l'individualisme et du primat de l'intérêt individuel - normes introjectées -, de la concurrence ou de la compétition sociale aliénantes, dans ces contextes illusoires de vie que sont l'école, l'université, l'entreprise, sous l'apparence d'un souci de respect de pseudo-exigences "démocratiques", "égalitaires" ou "humanitaires"; du principe de l'échange, auxquels les critères d'intelligibilité et de communication sont eux-mêmes pliés; ou encore des exigences de valorisation et de rentabilité. La psychanalyse nous apprend aussi que les attitudes malades peuvent être celles qui se proclament les plus saines. L'extension de "la domination du capital" est indéniable sur la totalité de la sphère d'expansion vitale et d'existence individuelle, venant contredire l'affirmation courante d'une séparation envisageable entre vie professionnelle et vie privée, hiérarchies sociales et égalité privée, consommation et solidarité-partage, exploitation directe de la force de travail et formes plus subtiles de la contrainte idéologique, violence non économique et consentement des individus à la poursuite d'objectifs prétendument communs, etc. L'époque est à un antirationalisme prédominant.
La raison elle-même ne serait un absolu que pour qui entend la relativiser. A cela, la philosophie ne peut que s'opposer, mais sans permettre pour autant d'accéder à cette illusoire conscience qu'elle enseignerait traditionnellement à prendre. Le caractère définitif de la fermeture d'une réelle conscience de soi est signifié par le fait que l'individuation est elle-même une catégorie socialement produite: l'individu, auquel se surimposent les rapports d'échange, entrecroise en lui un particulier historique et un universel social, la distinction entre les deux aspects ne pouvant être que le produit d'une fausse abstraction. Ses formes de pensée ne pourraient dès lors qu'être, tout comme lui, un en soi social. Ce qui signifierait l'existence d'incontournables médiations, socialement produites, véhiculées mais masquées par le langage, entre la connaissance et le processus réel que le mouvement d'objectivation ne contredirait qu'en apparence, soit l'absence de toute vérité concevable au-delà du médiatisé, qui serait séparée des faits. La valeur de la philosophie, comme lieu d'apprentissage de la lucidité critique, serait ainsi sérieusement compromise. Ou alors, il s'agirait de considérer le penser et ce qui est pensé, ce dernier ne bénéficiant d'aucune indépendance par rapport au penser, comme médiatisés l'un par l'autre. La philosophie, sans renoncer à la vérité, ne serait seulement en mesure d'atteindre aucune positivité réelle, ne serait pas même assurée de son objet. Développant sa rigueur en se cherchant dans ce qui lui serait le plus opposé - la totalité sociale -, elle s'efforcerait d'aller à l'être même de la chose - ce qui suffirait à la distinguer d'un savoir superficiel mêlé d'idéologie -, sans parvenir à échapper à l'imposition d'une conscience fausse de la réalité, dont elle reproduirait les catégories.
"Un système philosophique [l'expression est pour le moins malheureuse] n'est pas fait pour être compris [et par là mis en pratique et éprouvé dans et par l'action]: il est fait pour faire comprendre" (J.-F. Revel, Pourquoi des philosophes ? p.22). [Texte original élaboré par Serge Zajac]. En bref : Les raisons de la raison sont de combattre la déraison.
A voir: http://www.webnietzsche.fr/